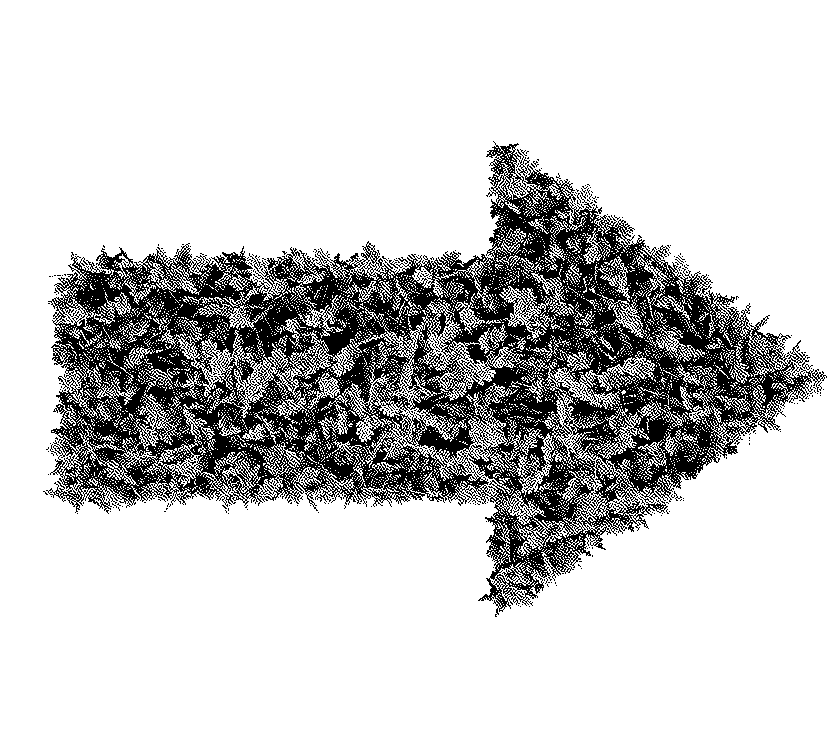On peut en effet distinguer au moins trois imaginaires politiques de la planification dans notre pays, si l’on met de côté les tentations explicitement collectivistes qui n’y ont jusqu’ici jamais vraiment pris racine :
- L’imaginaire des ingénieurs : inspirée par une forme de saint-simonisme1, cette planification se place délibérément à l’ombre de la raison technique et scientifique. Elle attend du décideur qu’il se plie aux lois de la physique. C’est un peu le modèle du « philosophe-roi » transposé à l’âge industriel. De façon très symptomatique, certains de ses défenseurs – dont Jean-Marc Jancovici – ont récemment proposé de soumettre le Président de la République, le Premier ministre (désormais la Première ministre) et l’ensemble du prochain gouvernement à 20h de formation accélérée sur le climat, marquant ainsi la prétention à une magistrature techno-scientifique des politiques de transition écologique et des décideurs publics censés la conduire.
- L’imaginaire des jacobins : Pour eux, planifier signifie d’abord inscrire le changement dans la loi et les règlements de la République. C’est la conception jacobine, légicentrique, souvent centralisée et volontiers coercitive de l’exercice. Le programme écologique de la NUPES se présente ainsi comme un florilège d’interdictions légales d’échelle nationale : interdiction des passoires thermiques, de l’obsolescence programmée, des plastiques à usage unique, des publicités pour les produits émetteurs de GES, des ventes à perte, des pesticides les plus dangereux, des additifs controversés, des coupes rases, des fermes-usines, des élevages de production de fourrures, des dépôts de brevets sur des organismes vivants… Il semble que chaque problème doive s’évanouir dans un simple geste de prohibition légale sans qu’aucune considération économique ou sociale n’y fasse jamais obstacle ou ne recommande une procédure plus progressive et concertée. Certes, la planification écologique de la NUPES est décrite dans le même temps comme un processus « démocratique (…) partant du local et s’appuyant sur la participation des citoyens, des syndicats, des associations, des collectivités et des branches professionnelles ». Mais ce processus trouve lui-même son origine et son premier principe dans une règle préalable qu’il a simplement vocation à mettre en œuvre : la « Règle verte ». Il s’agit d’introduire dans la constitution le respect des limites planétaires, de sorte que le juge constitutionnel pourrait ensuite sanctionner toute loi ou acte règlementaire contraire à ces limites, s’il est toutefois en capacité de mesurer précisément le dépassement de limites planétaires dont certaines sont difficilement évaluables. Il pourrait même être saisi via une QPC par tout citoyen sur l’examen de constitutionnalité de lois passées. Ce mécanisme bien analysé par Marine Braud pour la Grande Conversation repose sur une foi sans limite dans la puissance de la loi et du droit.
- L’imaginaire des modernisateurs nostalgiques : un troisième imaginaire renvoie à ce que fut le Commissariat général au plan de la grande époque, enceinte où se retrouvaient les « forces vives » de la Nation pour s’accorder sur un chemin de « modernisation » et préparer la décision publique en étroite concertation avec les élus et une haute fonction publique identifiée au siège de la raison. Ce modèle de modernisation où les élites faisaient la leçon à la société a certainement vécu. Il a en tout cas beaucoup perdu de sa puissance : les « forces vives » paraissent moins représentatives encore qu’à l’aube de la Ve République ; la décentralisation a beaucoup enlevé au pouvoir de commandement de l’exécutif ; l’Europe lui a retiré en outre certains leviers (politique monétaire, politique commerciale, politique de la concurrence…) ; l’Etat n’est plus aussi omnipotent qu’au sortir des Trente glorieuses ; et ses organes d’expertise sont désormais challengés, voire contestés par une expertise scientifique indépendante qui se fait peu à peu une place dans le paysage. Si le besoin de planification est de plus en plus vivement ressenti par les dirigeants, les moyens d’y parvenir paraissent se dérober.
Derrière chacun de ces imaginaires, ici grossièrement stylisés, se dessine en outre une certaine idée du régime politique souhaité :
- Désireux de remplacer le gouvernement des hommes par l’ « administration des choses », pour reprendre une célèbre formule, les saint-simoniens ne se sont jamais sentis aussi bien que sous le Second empire (l’âge des frères Péreire, de Ferdinand de Lesseps…). A la limite, ils s’accommoderaient fort bien d’un nouveau dictateur bienveillant dans un futur hypothétique. La recherche de compromis, la prise en compte de l’acceptabilité sociale, la délibération collective, la construction du consensus, toutes ces chinoiseries démocratiques ne sont pas vraiment leur affaire : la science parle et, dans ses verdicts, se font entendre d’une seule voix le nécessaire et le souhaitable ;
- De leur côté, les jacobins légicentriques pensent que la démocratie représentative, sous sa forme parlementaire la plus traditionnelle, fait très bien l’affaire. L’autorité du législateur, identifié à la volonté générale dans la puissante fiction électorale-représentative qui prévaut chez nous, suffit à légitimer la conduite du changement. Jean-Luc Mélenchon concède bien quelques exercices participatifs pour que le peuple et les acteurs économiques et sociaux se fassent entendre directement, mais les sujets mêmes sur lesquels il compte convoquer ces citoyens-participants semblent d’ores et déjà arbitrés dans son programme, comme le montre encore Marine Braud ;
- Les nostalgiques du Plan à la française s’accommodent pour leur part d’un régime parlementaire fortement présidentialisé où l’exécutif lui-même impulse le changement, flanqué d’une haute administration sûre d’elle-même et de son jugement sur les affaires du monde, et joue librement sur le clavier des instruments à sa disposition : concertation/négociation, coercition, incitations, responsabilisation…
Derrière ces conceptions se cachent enfin différents rapports entre le savant et le décideur politique :
- Du côté des nouveaux saint-simoniens, la science et la technique ne laissent pour ainsi dire pas de place au décideur politique dont le rôle se résume à celui d’exécutant, voire d’élève à qui le savant fait la leçon et demande de suivre ses préconisations. Le rôle du politique n’est pas ici d’instruire et de délibérer une décision, mais de l’appliquer en mettant en branle les machines législatives et administratives appropriées ;
- Du côté des jacobins et des nostalgiques, c’est le modèle décisionniste wébérien qui s’impose le plus souvent : les savants (qu’ils soient issus de communautés scientifiques indépendantes ou de la technocratie d’Etat) disent le possible, puis les politiques s’occupent du souhaitable et arbitrent, les uns étant invités à ne jamais s’aventurer sur le terrain des autres. On fait alors comme si la science devait apporter son éclairage et sa rationalité, puis se retirer de la discussion et du délibéré de la décision ;
Ces trois imaginaires de la planification sont certainement impropres à donner forme et efficacité à la planification écologique partout revendiquée aujourd’hui : après les Bonnets rouges et les Gilets jaunes, chacun doit en effet se faire à l’idée que non seulement la société n’accepte pas spontanément les supposés décrets de la raison techno-scientifique, mais que la loi peut être renversée ou « gelée » par des mouvements sociaux et que l’exécutif ne suffit pas non plus à entraîner la société dans son ensemble.
Par ailleurs, aucun de ces imaginaires ne permet de situer précisément le rôle des entreprises et du marché dans le mouvement recherché par la planification, laissant planer le doute sur leurs contributions à la fois à l’effort de décarbonation et aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif de la transition. Le programme de la NUPES est emblématique de ce flottement : si tout semble plaider chez eux en faveur d’une planification écologique administrée tournant le dos aux acteurs privés (nationalisations d’entreprise, augmentation des moyens humains, matériels et budgétaires des agences de l’Etat et des administrations, explosion des dépenses publiques, etc.), les partisans de la NUPES ne franchissent jamais le pas d’une claire contestation de l’économie de marché. S’il est clair que la « main invisible du marché » ne saurait tenir lieu d’opérateur de la transition écologique, il est tout aussi clair que l’investissement public ne suffira pas à couvrir l’ensemble des besoins de la transition, laquelle peut être décrite comme la mise au rebut d’une immense quantité de capital brun au profit d’une immense quantité de capital vert. C’est pourquoi, sauf à se projeter dans une économie administrée et à envisager un changement de régime radical, la planification écologique doit trouver les moyens de mobiliser les énergies du secteur privé et de l’industrie financière.
Si l’on veut essayer de donner un contenu opérationnel à l’idée de planification, il faut s’efforcer de la repenser dans chacune de ses dimensions, notamment sa définition propre, son rapport au régime politique et la place qu’elle fait à la science.
En réalité, si « planifier » signifie s’efforcer de suivre un plan détaillé pour atteindre un objectif futur, la planification nécessite pour commencer un horizon à atteindre et un calendrier et des étapes pour y parvenir. Bonne nouvelle, en matière climatique, cet horizon et ce calendrier existent : c’est la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Ce document, régulièrement révisé, fixe en effet les objectifs de la décarbonation, la trajectoire à suivre dans les trois décennies qui viennent et les différentes étapes à franchir pour l’atteindre d’ici 2050. Cette SNBC est elle-même cohérente avec les engagements du Green deal européen.
Mais l’ambition planificatrice ne saurait s’arrêter là. Elle implique également que soient précisément définis les voies et moyens de cette entreprise. C’est là que les choses se compliquent car il faut répondre à plusieurs questions : de quoi avons-nous besoin pour effectuer les changements souhaités ? comment organiser l’Etat pour les orchestrer efficacement ? comment garantir la cohérence d’ensemble des réformes et des investissements à mettre en œuvre pour décarboner l’économie ? qu’attendre du marché et des entreprises et comment les stimuler pour aligner leurs objectifs de performance sur la finalité recherchée ? comment construire les consensus nécessaires autour de cette ambition ? Si certains documents et lois ont balisé ce chemin dans certains secteurs (c’est par exemple le cas dans le domaine de l’énergie avec la Programmation annuelle de l’énergie), force est de constater que ces questions restent souvent largement ouvertes dans de nombreux domaines.
Différentes publications récentes de Terra Nova ont tenté d’y répondre, en particulier « Gouverner la transition écologique » (Pascal Canfin et Thierry Pech, novembre 2021) et « 100 jours pour réorganiser l’Etat afin de réussir la transition écologique » (Marine Braud, février 2022). Je ne vais pas en reprendre ici l’ensemble des analyses et propositions. Mais elles dessinent le chemin d’une planification d’un nouveau type qui conjugue des normes (coercition mais aussi incitations), des technologies (avec un défi d’industrialisation à grande échelle des solutions connues et une nécessaire mobilisation des investissements privés) et différentes formes de contractualisation (avec les citoyens, les territoires, les acteurs économiques, les salariés…). La gouvernance publique doit être adossée à des règles contraignantes de conformité et de cohérence climatique de l’ensemble des actes législatifs, réglementaires et budgétaires. Le gouvernement doit être organisé pour avoir les moyens d’assurer efficacement la transversalité des politiques écologiques. L’exécutif doit être redevable devant la représentation nationale, sur la base d’indicateurs précis de monitoring de l’action publique. Et un effort de formation de grande ampleur de la haute fonction publique doit être mené.
Surtout, cette planification nouvelle se démarque du dirigisme étroit des planificateurs en chambre, en développant des négociations sectorielles et territoriales, pour doter la transition écologique de modèles économiques soutenables (publics et privés) tout en lui donnant une assise démocratique plus large.
On le voit, cette conception de la planification écologique ne fait pas système avec un dictateur bienveillant, une démocratie parlementaire auto-suffisante, ni même avec le retour de l’Etat omnipotent des années 1960 : elle appelle au contraire un approfondissement de la vie démocratique et la recherche des moyens de se gouverner collectivement. Elle appelle également une grande diversité d’instruments de politique publique.
Toutefois, les réflexions conduites jusqu’ici ont laissé ouvertes deux discussions :
- La discussion sur l’usage des différents leviers d’action publique (responsabilisation, incitation, coercition, intervention directe opérationnelle ou budgétaire) pour conduire la transition à court et moyen terme.
- La discussion sur l’évolution des rapports entre le savant et le politique dans le contexte de la transition écologique.
Sur le premier point, nous ne disposons pas en matière climatique d’une typologie des moyens d’agir comparable à ce qui existe en matière de santé publique, par exemple. En revanche, nous avons accumulé des expériences qu’il serait utile d’examiner de façon plus systématique de façon à mieux cerner quand il est légitime de recourir à coercition, quand l’incitation est préférable, quand la mobilisation des bonnes volontés et de la société civile est plus pertinente et enfin quand des instruments de garantie des investissements (comme les contrats pour différence), de financement direct ou de production publique des biens et services doivent être mobilisés… Ce travail de mise en série de nos expériences, à défaut d’une typologie rigoureuse, serait souhaitable à court terme. C’est un chantier de réflexion auquel il faudra s’atteler dans les mois qui viennent. Il permettrait en particulier de mieux calibrer les politiques publiques, de s’interroger sur le modus operandi de l’action publique et de ne pas identifier systématiquement la volonté politique à la quantité de normes produites au cours d’une mandature.
Sur le second point, l’expérience de la pandémie nous a appris qu’au-delà du saint-simonisme et du décisionisme wébérien, une troisième position méritait d’être examinée et expérimentée : celle de la rationalité pragmatique très bien décrite par Mélanie Heard ici même. Le modèle des COP Climat s’en approche empiriquement en mettant en présence, jusqu’à la décision politique, les scientifiques, les décideurs et le public. De sorte qu’il n’y a pas de séparation – ou en tout cas le moins possible – mais un dialogue entre la rationalité scientifique, la décision politique et la justification publique.
Etendre cette philosophie à d’autres décisions que les engagements internationaux des Etats dans le sein des COP supposerait que le décideur politique ne se vive pas comme un arbitre exerçant simplement le pouvoir du dernier mot après que tous les autres ont parlé, mais comme celui à qui revient la charge à la fois de trancher et de justifier sa décision au regard des éléments de connaissance dont il dispose. Il pourrait également être demandé au savant de descendre de temps en temps de sa tour d’ivoire pour s’aventurer sur le terrain des modalités de l’action publique dans une conception élargie de sa mission de conseil. En France, par exemple, il serait sans doute souhaitable qu’un organisme indépendant comme le Haut conseil pour le climat ne se contente pas de formuler des avis sur les résultats constatés ou escomptés de l’action publique, mais qu’il s’intéresse aux différentes solutions politiques envisageables, qu’il développe des comparaisons internationales en la matière et qu’il contribue de cette façon à l’élaboration des instruments de l’action.