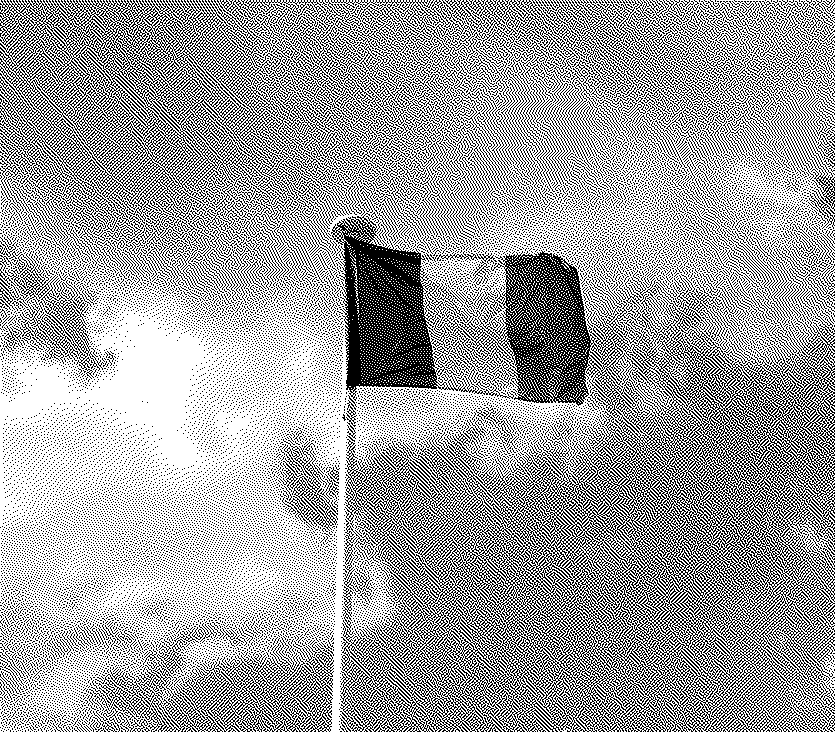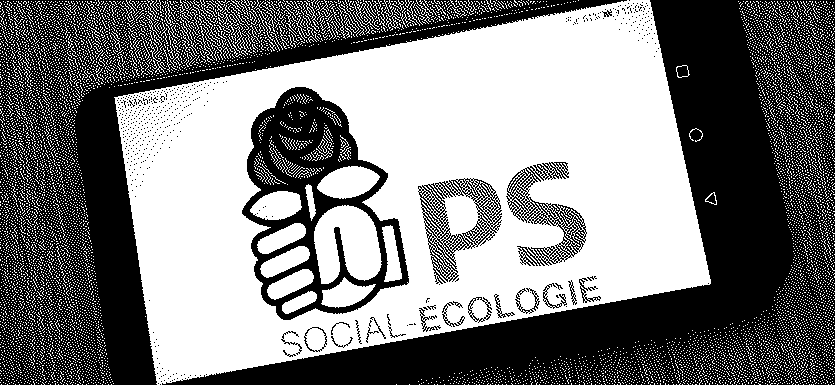C’est à une très large majorité que le gouvernement Barnier s’est trouvé censuré le 5 décembre (331 voix, la majorité requise était à 288). Ainsi se termine une expérience dont la fragilité était inscrite dans les conditions même de sa naissance. A l’issue d’un scrutin législatif dont le seul et unique vainqueur avait été le Front républicain contre le RN, le choix de Michel Barnier comme Premier ministre reposait sur un équilibre extrêmement précaire et qu’il ne fallait pas s’attendre à voir durer : le choix d’un homme issu d’un parti qui non seulement avait réalisé l’un des plus mauvais scores mais s’était brisé en deux après la rocambolesque dissidence d’Éric Ciotti et avait refusé de se joindre au Front républicain, le tout avec la caution implicite du RN, c’est-à-dire du parti dont une majorité de Français venait de dire qu’elle ne voulait pas. Le RN tenait ainsi en permanence un revolver braqué sur la tempe de ce gouvernement : après l’avoir fait « danser » et avoir obtenu de lui de nombreuses concessions, Marine Le Pen a finalement décidé d’appuyer sur la gâchette mercredi dernier. L’évidence est écrite dans les manuels de droit constitutionnel : à défaut de majorité absolue en sa faveur, un gouvernement a au moins besoin de ne pas avoir contre lui une majorité d’élus s’il veut pouvoir imposer son budget, fût-ce au moyen du 49-3. Par la même occasion, les députés ont vérifié par l’expérience ce qu’ils sont censés savoir, mais qu’ils n’ont pas encore intégré : c’est à eux de dessiner les contours d’une majorité parlementaire.
Le vote de censure contre le gouvernement constitue une nouvelle étape de la crise de régime lente qui s’approfondit depuis la dissolution de mai dernier. Jusqu’en 2022, la Ve République n’avait encore jamais fonctionné sans une large majorité au Parlement : à quelques exceptions près, depuis 1962, le « fait majoritaire » s’était toujours imposé. Cette constitution a pourtant été écrite par des juristes qui, fort de l’expérience de la IVe République, avaient justement envisagé le type de situation que nous connaissons aujourd’hui : un parlement divisé dont n’émerge aucune force stable. La présente crise n’est donc pas une impasse institutionnelle ou constitutionnelle : les pouvoirs réguliers sont en place et, par la force de l’arsenal des procédures du « parlementarisme rationnalisé », même un gouvernement appuyé par une faible majorité peut gouverner comme on l’a vu avec le gouvernement Borne, pourvu qu’il n’ait pas contre lui une majorité de censure. Mais, dans la configuration actuelle, l’ensemble des usages et des rapports de force politiques doivent évoluer pour que le pays ne soit pas bloqué. Comme le résume Paul Magnette, en observateur voisin, praticien d’une vieille culture parlementaire : « La principale difficulté tient au décalage entre la règle du jeu, qui est, en France, fondamentalement majoritaire et centrée sur le moment de l’élection présidentielle, et les nécessités imposées par la nouvelle situation politique. Cette règle du jeu ne favorise pas les prérequis d’un bon fonctionnement d’une démocratie parlementaire : une faible personnification du pouvoir, des partis importants qui reposent sur un travail collectif, une culture de la négociation, la recherche de majorités qui dépassent les blocs politiques… »1.
Il était donc vain de penser qu’il suffirait d’un bon négociateur pour naviguer entre les récifs et obtenir des votes sans majorité. Certes, Michel Barnier comptait sur la majorité LR au sénat mais cela ne pouvait suffire à assurer sa survie. La stratégie de Michel Barnier de se placer sous la dépendance d’une abstention bienveillante de l’extrême droite s’est en outre révélée perdante puisque le RN a fait la démonstration, à rebours de sa recherche de respectabilité, qu’il n’est ni un parti fiable ni un parti soucieux de répondre aux difficultés du pays.
Fallait-il aller jusqu’au bout de l’impasse, qu’on apercevait depuis le début de l’été, pour que les acteurs changent d’attitude ? C’est possible mais l’exercice est couteux. Couteux tout d’abord pour le pays dans son ensemble qui risque de voir augmenter le coût des emprunts destinés à financer nos déficits. La confiance des prêteurs est ébranlée et les investisseurs pourraient bien retarder des projets, notamment industriels, dont nous avons grandement besoin. Mêlé à celui des ménages, leur attentisme aura un effet négatif sur la croissance. Et les accords a minima sur le budget – notamment la reconduction des équilibres du budget 2024 – risque de favoriser la dérive, déjà inquiétante, des déficits et de la dette.
Mais le non vote du budget pourrait aussi avoir un coût pour les ménages. En l’état actuel des choses, il faudra passer par une loi « spéciale » (prévue à l’article 47 de la loi organique sur la loi de finances) d’ici fin décembre pour éviter l’absence de recettes. Mais cet expédient n’autorise qu’un strict minimum : il permet de prélever l’impôt en répliquant simplement les recettes de l’année précédente (c’est-à-dire calculées en 2023 pour 2024) et autorise pour « les dépenses absolument nécessaires » des décrets de crédit d’avance. Il faudra donc qu’un nouveau gouvernement reprenne dès le début de l’année 2025, s’il a été formé, la négociation d’un budget en bonne et due forme. En attendant, les agriculteurs qui se sont vu promettre un soutien exceptionnel devront attendre. Tout comme la Nouvelle Calédonie, pour laquelle le projet de loi de finance de fin de gestion 2024, qui n’est pas adopté, prévoyait 1Md€ pour relancer le territoire après les émeutes du printemps dernier. Plus largement, si les parlementaires ne parviennent pas à renégocier un budget, l’impossibilité de réviser le barème de l’impôt sur le revenu, compte tenu de l’inflation de l’année 2024, aura un impact direct sur l’imposition accrue des ménages2. A l’inverse, pour les ménages les plus fortunés, la hausse de la contribution qui avait été prévue dans le budget Barnier n’aura pas lieu. En outre, les revalorisations salariales prévues dans plusieurs ministères (Justice, armée, Education nationale) ne pourront pas intervenir. Les hausses de budget prévues pour les ministères régaliens seront reportées (+3,3 Mds€ pour les armées, +885M€ pour l’Intérieur, +358M€ pour la Justice). Au lieu de choix clairs répondant à l’état de nos finances publiques, on assistera, au mieux, à une adaptation forcée à un déraillement institutionnel.
Le comportement des acteurs ne s’est pas encore ajusté aux nécessités politiques imposées par l’absence de majorité parlementaire. Le Président de la République avait choisi Michel Barnier en espérant maximiser sa position de pouvoir et préserver des points essentiels de son bilan. Mais il doit se résoudre à la réalité institutionnelle : quand il n’a pas de majorité au Parlement, il ne dispose pas des outils de gouvernement. Les parlementaires ont expérimenté un pouvoir négatif avec la motion de censure. Ils doivent désormais explorer le versant positif de leur pouvoir. Pour cela, il faut qu’ils acceptent de discuter ensemble pour former une plateforme de travail permettant de dégager, au moins sur des points minimaux, une majorité. Toute autre solution, quelle que soit la personnalité nommée à Matignon, serait aujourd’hui vouée à l’échec. L’expérience Barnier a montré qu’il était illusoire de chercher une conciliation, même par l’abstention, du côté du Rassemblement national. La seule solution arithmétique viable est entre les mains de la Gauche hors LFI et du bloc central. Les exclusions préalables qui ont fusé cet été ne sont plus de saison. Soit les parlementaires décident du blocage des institutions, soit ils tiennent leur rôle de parlementaires, celui pour lequel ils ont été élus. Une « grande coalition » à la française est un exercice inédit, mais pas irréalisable. Le périmètre de la coalition est d’autant moins impossible à construire qu’il fait ses preuves tous les jours au Parlement européen… Et si l’expérience réussit, le parlementarisme aura triomphé du présidentialisme dans le cadre-même des institutions de la Ve République.