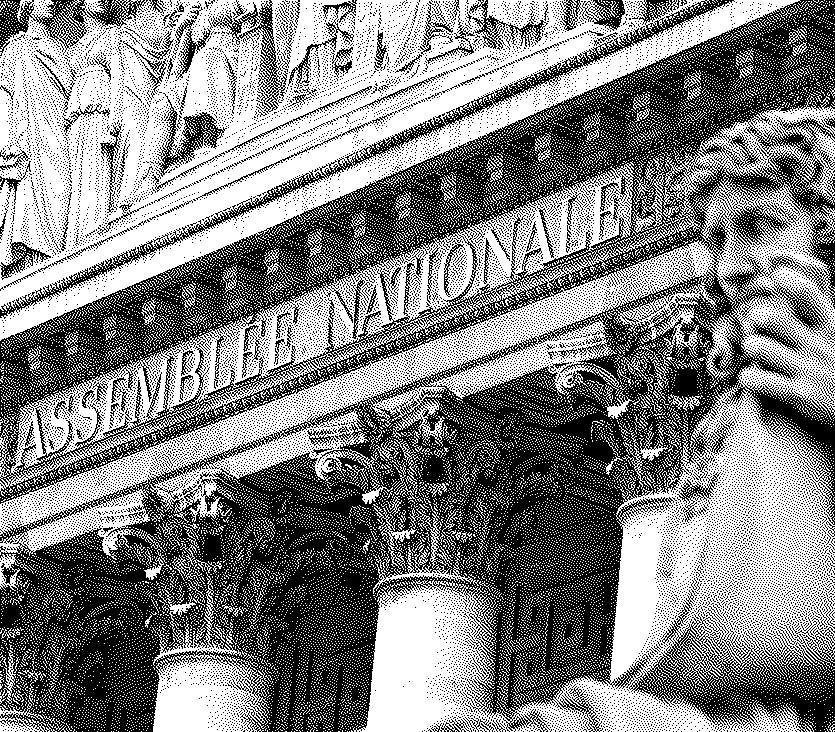Vous venez de publier un billet sur le blog Jus Politicum où vous soulignez, à la lumière des débats récents sur la réforme des retraites, le fait que le Gouvernement a abusé des techniques du “parlementarisme rationalisé”. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
La Grande Conversation
Un point de vocabulaire pour commencer. Le “parlementarisme rationalisé” désigne l’ensemble des mécanismes d’encadrement juridique du régime parlementaire qui ont été inscrits dans la Constitution. Typiquement, on peut penser à l’article 49 alinéa 3, désormais bien connu de tous : si le Gouvernement utilise cet instrument, le texte de loi est adopté sans être voté, sauf si une motion de censure, qui peut être déposée dans les 24h, est adoptée par l’Assemblée nationale.
Au fond, ce que suggère la notion de parlementarisme rationalisé, c’est que le régime parlementaire est par nature chaotique, problématique, porteur d’instabilité, et qu’il faut pour y remédier l’encadrer juridiquement avec des délais, des mécanismes de majorités qualifiées, etc. Le droit est convoqué en vue de le rendre plus rationnel. C’est ce que l’on fait depuis les années 1920, mais spécialement en France, depuis 1958. Derrière le parlementarisme rationalisé, il y a l’idée, commune à Michel Debré et aux grands constitutionnalistes de l’époque, qu’au fond, la politique est mauvaise, toxique, porteuse de conflits, génératrice d’instabilité, et que le droit est appelé à la purifier et à la stabiliser. Avec ces nouvelles règles, elle allait être “saisie par le droit”, comme l’a dit un professeur de droit bien connu, Louis Favoreu, et tout allait s’améliorer.
Ce n’est pas exactement ce qu’on a observé ces derniers temps. Dans le cas de la réforme des retraites, le Gouvernement a fait usage de procédés normaux qui se trouvent tous dans la Constitution. Pris isolément, aucun de ces procédés ne pose problème : on l’a souvent rappelé ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de 49-3 depuis 1958. Ce qui fait problème, ce ne sont pas ces procédés en eux-mêmes, mais leur empilement. Si on additionne tout ce qui a été fait pour limiter les droits du Parlement dans cette réforme, l’effet d’accumulation est spectaculaire et problématique.
Cet empilement commence avec l’usage d’un véhicule législatif particulier : un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale (ou PLFSS rectificatif), et du mécanisme qui l’accompagne depuis 1996 : l’article 47-1 de la Constitution. Inconnu des non spécialistes, cet article permet d’imposer des contraintes procédurales extrêmement lourdes, notamment un délai limité de discussion devant les deux chambres : 20 jours devant l’Assemblée nationale et 15 devant le Sénat. Il faut se souvenir que ce dispositif a été conçu à l’époque Juppé, en 1996, c’est-à-dire juste après la grande crise de 95. La promesse sous-jacente était en quelque sorte, après les mouvements sociaux et le désordre qui s’en est suivi, une forme de « plus jamais ça ».
Le recours à un PLFSS rectificatif permet également de neutraliser l’impact des travaux de la commission des Affaires sociales : dans ce cadre, cette commission peut bien changer le projet autant qu’elle le souhaite, c’est le texte du Gouvernement qui sera ensuite mis en discussion en séance, et non celui adopté en commission comme c’est le principe.
Ces différentes techniques ont permis d’aller très vite à l’Assemblée et d’envoyer au Sénat un texte qui n’avait même pas été voté par elle. Et au Sénat toute une série de dispositifs ont à nouveau été mobilisés, notamment pour limiter les droits de l’opposition : le recours à l’article 38 du règlement du Sénat pour limiter à deux les prises de parole sur un amendement, un amendement gouvernemental en cours de discussion, et pour finir (pour le moment) la réécriture en commission d’un amendement permettant de faire tomber la quasi-totalité des amendements déposés par la gauche sénatoriale, pour faire en sorte que les textes de l’opposition soient mis de côté…
Une fois le texte voté au Sénat, on a enchaîné avec une commission mixte paritaire qui, comme vous le savez, est sous le contrôle du Gouvernement : c’est lui qui décide ou non de la déclencher. Le texte issu de cette CMP devait ensuite repasser devant les deux assemblées. Mais il faut savoir que si, à la fin, les deux chambres n’avaient pas voté définitivement le texte, le Gouvernement aurait pu, passé un délai de 70 jours, procéder directement par ordonnance ! Il en a été autrement puisque, devant le risque d’un vote de rejet à l’Assemblée nationale, il a finalement été décidé de recourir au 49-3. Ce recours au 49-3 concentre aujourd’hui toutes les critiques, mais il n’est au fond, on le voit, que la cerise sur le gâteau.
Toute personne qui a travaillé son Michel Debré et sait comment il a façonné le droit constitutionnel de la Ve République se pose ici une question : Debré, rédacteur de la constitution, avait-il raison de prétendre que tout cet arsenal du parlementarisme rationalisé serait « le corset » grâce auquel on préviendrait la « déformation du régime parlementaire » ? Dans notre cas, cet empilement de procédures porte-t-il vraiment un effet de rationalité supérieure ? Personnellement, j’en doute. En réalité, notre parlementarisme n’est pas « rationalisé ». Nous sommes dans un régime de parlementarisme « réglementé » qui est en train de devenir, je le crains, un régime de parlementarisme déréglé.
Il a suffi que le fait majoritaire s’efface aux élections législatives de 2022 pour que l’on s’en rende compte. Je résume cela en disant : nous avons désormais un Président et un Gouvernement qui vivent en Ve République, et un Parlement qui vit en IIIe ou en IVe République. Nous avons basculé en 2022 du fait majoritaire à la prime majoritaire. Le Gouvernement ne dispose plus d’une majorité qui, même si elle renâclait parfois, finissait par voter ses textes. Sa majorité est relative et l’opposition fractionnée. Eh bien, malgré tout, on continue à utiliser les mêmes instruments parce que l’habitude s’en est prise. Le chirurgien considère la situation et dit : “Je ne peux pas intervenir” (c’est-à-dire faire adopter telle ou telle réforme). Mais l’anesthésiste (un haut fonctionnaire) vient le voir et lui dit : “J’ai une bonne solution, on va mettre la péridurale à ce moment-là, ça va faire moins mal et ça va passer”. Ici, il s’agit d’un PLFSS rectificatif. Mais ça ne passe pas. C’est même pire. Il faut encore et encore des doses supplémentaires, d’autres remèdes (49-3, etc.). Bien sûr, les instruments n’ont pas changé, mais actionnés dans ce nouveau contexte, leur nature diffère considérablement. Le 49-3, par exemple, présente un nouveau visage. Ce n’est plus un outil de consolidation consistant à cimenter une majorité d’humeur frondeuse ou à mettre fin à ses atermoiements, comme si on lui disait : “Maintenant, vous allez vous calmer. Vous voulez vraiment que je m’en aille ? Parce que vous devez me soutenir, vous allez adopter mon texte. La pilule est un peu amère, mais vous allez l’avaler”. C’est en gros ce qui s’est passé avec la loi Macron en 2015 puis la loi El Khomri en 2016, sous le gouvernement de Manuel Valls. Le texte du 49-3 n’a pas changé depuis, mais dans un contexte politique totalement différent, son usage n’a plus du tout la même signification : il devient un outil de contrainte exercée sur des oppositions divisées, c’est-à-dire une arme anti-oppositions.
Bien sûr, l’hostilité au 49-3 ne date pas des dernières législatives. On l’a vu monter depuis dix ans de façon assez continue. Le 49-3 a focalisé l’hostilité pour des raisons un peu mystérieuses. C’est encore sur lui que se concentrent aujourd’hui la majorité des critiques. Ce que dit cette hostilité commune, me semble-t-il, c’est que quelque chose aurait dû être débattu, et peut-être même qu’on aurait dû prendre en compte le fait qu’à peu près 70 % de l’opinion est hostile à ce texte.
Denis Baranger
Dominique Rousseau a exposé récemment dans la presse l’idée d’un défaut de « sincérité » des débats parlementaires sur ce texte. Selon lui, le Conseil constitutionnel pourrait être fondé à le rejeter en bloc au motif qu’il n’est pas issu d’un débat sincère. Qu’en pensez-vous ?
La Grande Conversation
Je partage l’idée qu’il y ait eu une atteinte portée à la sincérité de la discussion. En réalité, il n’y a pas vraiment eu de discussion. Il y a eu conflit, il y a eu des oppositions et il y a eu un effet de mise en étau. Le Gouvernement arrivait avec un dispositif blindé, on l’a vu. Et même avec un déficit culturel et structurel de considération pour le Parlement, qui lui est habituel. En face, dans l’opposition, LFI a adopté une technique conflictuelle très dure et très radicale. C’est une approche très structurée intellectuellement, inspirée des analyses de Chantal Mouffe qui cite elle-même abondamment Carl Schmitt, autour de l’idée que la politique c’est l’antagonisme ami/ennemi. Ce qu’avait dit explicitement aux médias, à son arrivée à l’Assemblée en 2022, l’un des jeunes nouveaux députés LFI : « Nous venons ici pour le combat ». Donc une stratégie d’opposition frontale, sans nuances, dans le registre de ce que Gerald Darmanin a appelé d’un terme déplaisant mais assez parlant : la « bordélisation » du débat.
Pourtant, il y avait évidemment un certain nombre de députés (Charles de Courson, Jérôme Guedj…) qui connaissaient le dossier et qui ont essayé de soulever de façon raisonnable et méthodique des points de débat. Mais leur travail n’a pas suffi à ce qu’un débat ait lieu à proprement parler, au point qu’on n’est jamais arrivé, à l’Assemblée, jusqu’à l’article 7 du projet de loi. Et au Sénat, la situation a été presque pire, du fait de la convergence entre la présidence du Sénat, la majorité LR et le Gouvernement qui souhaitaient que les choses se calment.
Pour autant, peut-on considérer ce défaut de débat comme constitutif d’un défaut de sincérité au sens du Conseil constitutionnel ? Est-ce que, techniquement, cela va conduire à une censure ? Il y a un critère de sincérité qui s’applique aux textes budgétaires ; le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence sur les lois de finances, étudie effectivement les comptes de dépenses et de recettes qui sont présentés et vérifie leur sincérité.
La question serait aujourd’hui d’étendre cette notion de sincérité : peut-on imaginer de sanctionner un texte pour la raison qu’il ne traduirait pas, dans son ensemble, une discussion sincère ? Le Conseil constitutionnel pourrait contrôler, comme il l’a fait pour le budget 2023, le respect du principe de sincérité des débats parlementaires. Je ne sais pas si l’on pourrait parvenir, par ce biais, à une censure, parce qu’il ne va pas de soi que la Première ministre (et le Gouvernement) aient outrepassé les exigences de la Constitution en la matière. Le Conseil constitutionnel pourrait juger que Madame Borne s’est « bornée à faire usage du droit qu’elle tient » de l’article 49 de la Constitution, par exemple. Reste que l’absence de toute adoption effective (par la voie d’un vote) du texte par l’Assemblée nationale (à cause d’abord de la transmission automatique en raison de l’expiration du délai de 20 jours, ensuite du 49-3) va dans le sens de l’insincérité, et donc d’une possible censure.
Denis Baranger
Le Gouvernement fait cependant valoir qu’il a discuté avec les partenaires sociaux. La Première ministre a d’ailleurs obtenu un délai supplémentaire pour cela. Il rappelle en outre qu’il a retenu des amendements. Le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, ce n’est pas son texte initial, mais celui qui est sorti des mains de la commission mixte paritaire. Qu’est-ce que vous répondez à cela ?
La Grande Conversation
C’est factuellement vrai. Mais est-ce que cela change la réalité et la perception ? Concernant la perception, il est clair que cela ne change rien. Les Français semblent de plus en plus en colère. L’opposition sociale à cette loi ne diminue pas. Donc la perception de cette réforme est demeurée la même. Pourquoi ? A mon avis, la perception a été très mauvaise parce que ce texte a été amené de manière frontale avec l’ambition non négociable de reporter l’âge légal à 64 ans. Il n’y a pas besoin d’être un grand spécialiste de la démocratie sociale pour savoir que ce principe était rejeté même par la CFDT. Même quelqu’un d’aussi modéré et disposé à la discussion que Laurent Berger, ne voulait pas des 64 ans. L’exécutif a néanmoins tout joué, ou comme aime à le dire le Président, « pris son risque », sur cet unique paramètre. Dès lors, les choses étaient très mal engagées. Quoi que l’on ait pu ensuite ajouter à la réforme en termes de compensations (par ailleurs très coûteuses), cet affichage-là créait un énorme problème. En outre, d’éminents spécialistes expliquaient qu’il n’était pas certain que le problème se pose en ces termes et que la solution à terme soit apportée par cette réforme.
Denis Baranger
Et lorsque la Première ministre vient expliquer à la tribune de l’Assemblée nationale que ce texte s’est vu allouer un temps de débat parlementaire, certes contraint, mais supérieur à celui qui avait été alloué au texte de Monsieur Woerth en 2010 ou à celui de Madame Touraine en 2014, alors même que ces textes étaient plus longs et qu’ils ont été votés, est-ce qu’elle ne soulève pas un point, là encore factuel, qui plaide en sa faveur ?
La Grande Conversation
Les rapports de force majorité/oppositions à l’Assemblée nationale n’étaient pas du tout les mêmes en 2010 et 2014. Et quoi qu’il en soit, je vais risquer une petite parabole : quand un petit garçon dans la cour de récréation se fait prendre parce qu’il a volé les billes du petit copain et qu’il déclare pour sa défense : ”Mais il y a plusieurs élèves qui l’ont déjà fait la semaine dernière”, est-ce qu’il ne va pas être puni quand même ? On a toujours corseté le Parlement. On l’a toujours mis dans l’étouffoir du parlementarisme dit rationalisé. Celui qui le fait pour la énième fois et qui perd la partie, ou du moins se délégitime fortement, crie à l’injustice. Moi, ce que je vois, c’est que le Gouvernement pouvait s’épargner de déclencher la procédure accélérée sur ce texte. Qu’il pouvait s’épargner le PLFSS et le procédé de l’article 47-1. Qu’il pouvait s’épargner les phrases qui, à mon avis, vont gagner le concours de l’humour politique de l’année prochaine, du type “nous avons laissé toute sa place au débat”. On peut dire ce qu’on veut, qu’on a discuté avec les partenaires sociaux, qu’on a débattu plus longtemps au Parlement, etc., structurellement, nous avons des gouvernements de tous bords qui ont, je vais le dire un peu abruptement, étouffé le Parlement en se disant : “ce n’est pas bien grave, nous sommes en Ve République”. Mais voilà, il arrive un jour où quelqu’un se fait prendre la main dans le sac, si je puis dire. Il se trouve qu’aujourd’hui, c’est ce gouvernement. Mais c’est lié, je pense, à une culture plus large et plus ancienne.
Qu’est-ce en effet que la Ve République ? C’est le mariage du gaullisme et de l’ENA. L’entourage du général De Gaulle lui avait fait comprendre qu’il fallait ajouter une strate technocratique fiable pour que l’Etat et l’exécutif soient stables. Ça a fonctionné à merveille grâce à la Ve République qui a été écrite, comme on sait, par des gens du Conseil d’Etat extrêmement compétents. Ils ont placé à l’intérieur de la machinerie les verrous adaptés pour que l’exécutif soit fort et pour que, grâce à lui, l’Etat le soit aussi. Jusqu’à un certain point, la machine a fonctionné et fonctionne encore. Mais avec les élections de 2022 et la perte du fait majoritaire, les gens qui étaient habitués à gouverner comme ça, et je dirais même la strate technocratique qui était habituée à procéder ainsi, ont été pris par surprise. Ils étaient habitués à « administrer », si l’on me pardonne l’expression, le travail parlementaire à coups de pratiques de ce genre, devenues si habituelles qu’on ne les remarquait même plus. Bien sûr, du point de vue du Secrétariat général du Gouvernement, de l’Hôtel Matignon ou de l’entourage du Président, la brutalité de ces procédés n’apparaissait pas : ça consistait juste à appuyer sur un bouton. Le coup de marteau était donné à l’autre bout de la chaîne, au Palais-Bourbon ou au Sénat. Il s’abattait sur une majorité consentante, qui le supportait sans (trop) regimber. A présent, ça ne peut plus se passer comme ça.
Je ne suis pas hostile à la Ve République. Je pense d’ailleurs que les gens qui voudraient mettre en place une VIe République se retrouveraient à nouveau sur la case départ du Monopoly : devoir trouver la nouvelle formule magique propre à stabiliser le régime, à lui éviter l’instabilité permanente du passé. Une récente enquête du Cevipof montrait qu’une majorité de Français veulent un Président solide. Si on en revenait à un dispositif de type IIIe ou Ive République, les anciens défauts reviendraient et on déplorerait la perte des avantages qu’a apporté la constitution de 1958. J’ai écrit comme d’autres sur le 49-3 pour dire que c’était un instrument de gouvernement indispensable. Mais je n’avais pas prévu le nouveau contexte électoral (la majorité relative du gouvernement, notamment) qui dévoile tout à coup des problèmes structurels.
Denis Baranger
Au fond, ce qui ressort de vos analyses, c’est que, dans notre culture institutionnelle, le Parlement ne sert qu’à une seule et unique chose : soutenir le gouvernement ou s’y opposer. On n’attend rien d’autre de lui finalement et surtout pas de délibérer… Et les oppositions semblent l’avoir compris aussi.
La Grande Conversation
Le Parlement est une chambre d’enregistrement au sein d’un dispositif normatif et politique qui le surplombe. Vous avez des idées politiques, vous les inscrivez dans un programme électoral, vous êtes élu et une haute administration très compétente vous dit comment on va mettre tout ça en musique à travers différents textes. Et puis voilà, c’est bouclé. Quel est alors le rôle du Parlement ? Dans les lois qui régissent le Parlement britannique, il est écrit depuis le XVe ou le XVIᵉ siècle que le monarque adopte les lois “avec l’avis et le consentement” de sa Chambre des lords et de sa Chambre des communes. Le Parlement ne fait pas autre chose aujourd’hui : il vote la loi au titre de l’article 24 de la Constitution, mais cela se ramène peu ou prou à manifester son consentement. C’est arrivé à un tel degré que, quand Jean-François Copé était le chef du groupe UMP à l’Assemblée, il était allé jusqu’à parler de “ coproduction législative” : le Parlement était ainsi gentiment admis à participer à la fabrication de la loi. Les députés eux-mêmes et les institutions parlementaires plus largement ont intégré cette idée que le Parlement n’a plus du tout ce rôle de discussion – je veux dire : de délibération politique propre à influencer l’économie même du texte de loi – qui devait être le sien. Certes, il continue à discuter, mais cela n’opère qu’à la marge. Le texte est déjà bouclé pour l’essentiel.
Ensuite, est-ce que les oppositions l’ont compris comme vous le suggérez ? Je n’en suis pas certain, y compris en termes purement tactiques. Est-ce que c’était une bonne idée de la part de la France insoumise de déposer 13 000 amendements ? Etait-ce aussi habile que cela ? Je ne le crois pas. Je crois que la bonne stratégie, ce serait de déposer quelques amendements, mais pertinents ou qui mettent sérieusement en difficulté le Gouvernement. En déposer 13 000, c’est du contre-étouffement, si on me pardonne cette expression. Face à l’étouffement organisé par l’exécutif, on oppose une autre stratégie d’étouffement, un contre-feu. Si le but était le brouhaha et les insultes, il a été atteint. Mais si c’était de mettre le gouvernement en difficulté, c’est moins sûr : ça lui a presque redonné de l’oxygène.
Denis Baranger
Vous iriez jusqu’à dire qu’il y a eu une sorte d’entente objective entre des forces contraires pour empêcher une délibération parlementaire digne de ce nom ?
La Grande Conversation
Non, je ne dirais pas cela. Je parlerais plutôt d’un double aveuglement. D’un côté, un gouvernement qui n’est plus habitué à la discussion et qui ne sait même plus ce que c’est qu’une discussion parlementaire. En outre, beaucoup de ministres ne sont plus des parlementaires et ne viennent plus vraiment pour discuter. Je me rappelle d’un sénateur qui m’avait dit à propos du président Macron : “Il ne sait même pas que nous existons”. C’est une phrase qui m’avait énormément marqué. Face à un problème social, le Président invente le Grand Débat national ou le Conseil national de la refondation, c’est-à-dire des initiatives qui permettent de parler directement aux Français et qui contournent ces institutions parlementaires jugées plus ou moins périmées. Au fond, vu comme cela, le Parlement, pour reprendre une formule ancienne de Philippe Sollers, c’est un peu « la France moisie », ça ne sert plus à grand-chose.
Et de l’autre côté, on a des députes LFI, avec leur logique propre qui est une logique de combat. Simplement, ce qu’aurait dû apprendre la gauche aujourd’hui, c’est que le Parlement, ce n’est pas un ring de MMA. Les députés sont là pour utiliser, dans un contexte de civilité, des outils de débat pour essayer de gagner la partie. Ça a été très bien dit par Laurent Berger ou encore par Pierre Rosanvallon dans son interview au Monde : les opposants deviennent une opposition légitime quand ils s’opposent avec les outils institutionnels dans le cadre d’un débat relativement apaisé.
Je pense que, s’il y a une chose positive dans la discussion actuelle, c’est de montrer en creux ce que devrait être une démocratie saine : une démocratie où on aurait eu sur les retraites le vrai débat au Parlement que l’on n’a pas eu. Les outils pour cela sont pourtant disponibles. Regardez ce qu’a fait Jérôme Guedj en tant que co-président de la mission d’évaluation des comptes de la Sécurité sociale: il a utilisé une disposition du code de la Sécurité sociale pour aller effectuer une investigation sur pièce et sur place à la direction de la Sécurité sociale où il a trouvé la preuve que la désormais fameuse affirmation selon laquelle 40.000 retraités seraient éligibles à la retraite à 1200 euros n’était, a minima, pas établie. Voilà une opposition efficace qui utilise les outils que, depuis 2008, on a donné aux oppositions. Cet exemple démontre qu’on peut construire une opposition qui n’a pas besoin de diminuer sa frontalité politique pour augmenter son efficacité technique.
Denis Baranger
Avez-vous le sentiment que les oppositions, ou en tout cas l’opposition LFI, aient abusé de leur droit d’amendements ?
La Grande Conversation
L’abus du droit d’amendement est une question très délicate. Le droit d’amendement est consacré par la Constitution et c’est prérogative extrêmement importante pour les parlementaires. En 2018, le premier projet de réforme constitutionnelle du président de la République a fait l’objet de discussions entre les assemblées et le gouvernement à ce sujet. Le texte préparatoire proposait en effet une diminution très significative du droit d’amendement : on parlait de contingenter le nombre d’amendements et de limiter les hypothèses dans lesquelles on pouvait en déposer, avec une augmentation de ce qu’on appelle les irrecevabilités. Heureusement, ce type de restriction n’a pas été retenu. Autrement, nous risquions de basculer dans un régime qui, politiquement et constitutionnellement, ne serait plus un régime libéral. Les oppositions ont le droit de s’opposer. Elles ne sont pas dans les institutions au sens où elles y jouiraient d’une sorte de tolérance : elles sont une institution, et l’une des plus importantes. C’est une chance infinie pour nous, un bien commun. En conséquence, si on se dit : “il y a 20 000 amendements, c’est trop. Il faut empêcher ça”, eh bien, c’est très difficile techniquement de le faire. La seule chose qu’on puisse espérer, c’est une forme de self restraint. Mais pour cela, il faudrait faire sortir de l’esprit des députés, des assistants parlementaires, des présidents de groupe parlementaire que c’est une bonne technique d’opposition. Il leur suffirait de comprendre qu’elle n’est pas payante pour eux.
Denis Baranger
Il y a des gens qui disent, y compris à l’Assemblée nationale, que le débat parlementaire sur les retraites a donné un spectacle absolument désolant et lamentable et qu’il a caché une activité parlementaire qui, par ailleurs, était revenue à un niveau correct par rapport aux années passées.
La Grande Conversation
Ça me paraît très vraisemblable. Il y a eu en début de session un effet de reparlementarisation grâce, si je puis dire, à l’effacement du fait majoritaire au profit de la cohabitation d’une majorité relative avec des oppositions fortes. Le gouvernement a bien été obligé de “faire avec” au quotidien, de travailler avec ce qu’il avait. Et je pense que si on regarde les différents textes qui ont été votés jusqu’à maintenant, il y a eu la prise en compte de certains arguments ou amendements des oppositions. Justement, parce qu’il n’y a pas une opposition, mais des oppositions. Certes l’opposition LFI n’a pas tellement joué le jeu de la discussion au quotidien, mais d’autres ont su le faire. J’ai été frappé qu’il y ait par exemple chez les socialistes des parlementaires comme Boris Vallaud ou Laurence Rossignol qui sont des gens accoutumés au travail parlementaire et qui savent faire passer des amendements et, si on me pardonne ce terme un peu trivial, “dealer” des choses. Malheureusement, il y a eu en quelque sorte une remise à zéro des compteurs avec cette réforme des retraites. Et on n’en a pas complètement fini. J’ai quand même été très frappé par le résultat du vote sur la motion de censure de LIOT : à 9 voix près, le Gouvernement était renversé. C’est extrêmement frappant. La première victime de ce “bal tragique au Parlement”, ce sont Les Républicains : ils ne sont plus vivants, en tout cas leur parti est devenu un club d’élus qui n’est plus cimenté par une cohérence politique. Messieurs Ciotti, Retailleau, Marleix, Pradier, et aussi en arrière-plan, Laurent Wauquiez, n’ont manifestement pas la même vision de ce que doit être leur parti. Ils auraient pu apparaître pour la majorité Renaissance comme des alliés raisonnables, voire conclure une sorte d’accord de coalition avec elle, mais ils n’ont pas réussi à le faire. Ça traduit assez bien ce qu’est devenu ce qu’on appelait autrefois la droite républicaine. Il y a une sorte de fatalité qui frappe les anciens partis de gouvernement du moment qu’ils ne gouvernent plus…Leur vide idéologique et programmatique devient flagrant et il les ronge de l’intérieur.
Denis Baranger
Face à ce tableau, on serait tenté de se dire qu’il faut corriger nos institutions. Mais en même temps, on se demande si le problème ne vient pas des acteurs eux-mêmes. Comment pondérez-vous ce qui revient à la décomposition du système politique et ce qui revient aux institutions de la Ve République ?
La Grande Conversation
Je ne suis pas un ardent partisan du réformisme constitutionnel permanent. C’est un peu comme ces lois qu’on adopte à la suite d’un fait divers. Je ne suis pas certain que réformer la Constitution à tout bout-de-champ, ce soit la solution, parce qu’il y a des équilibres structurels à prendre en compte. La Constitution, c’est aussi ce que Montesquieu appelait une “disposition des choses”. Il y a une certaine structure institutionnelle, et il y a aussi une logique qui est celle du régime politique lui-même. Et ça, c’est extrêmement difficile à manipuler par des textes.
L’infrastructure de notre régime remonte au « moment 58 » avec la vérité qui était la sienne, et qu’il ne faut pas non plus oublier. La France avait besoin d’en finir avec des Parlements qui n’avaient pour force que d’être faibles, c’est-à-dire d’être une puissance paralysante et le lieu de coalitions négatives. Un exécutif fort et une administration forte apparaissaient alors comme un bien d’une grande valeur, le gage d’un régime stable. On a trouvé une sorte de martingale en 1958. Pour le moment, il n’y a pas d’alternative à cette puissance de stabilisation qu’apporte la constitution de 1958. Je pense que 58 nous a apporté la solution à laquelle les Français adhèrent parce qu’il y a cette idée, qui nous rappelle l’Ancien Régime, d’un président fort : cela rassure les Français…quand ça ne les irrite pas au plus au point. Cela les rassure dans les grandes crises (crise financière de 2008, Covid, …). Cela les irrite quand ils ont le sentiment, en particulier dans le pilotage de l’Etat-providence, qu’on ne les entend pas et qu’on porte atteinte à leurs droits.
Bien sûr, depuis 1958, on a changé certaines choses. Il y a quand même eu la réforme de 2008 qui va dans le bon sens avec une augmentation des droits de l’opposition, peut-être pas suffisante mais significative. En 2007, on a introduit à l’article 68 de la Constitution la possibilité de destitution d’un président s’il commet un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. J’ai préconisé pour ma part, sans être jamais entendu, qu’on adopte une disposition comparable pour les parlementaires qui se comporteraient d’une façon tellement inacceptable qu’il ne s’agirait pas d’engager leur responsabilité pénale mais de leur faire quitter l’enceinte parlementaire.
Faut-il aujourd’hui changer les institutions ? Je l’ignore. On pourrait au moins viser à repenser la question de la légitimité. Je pense en particulier à la façon dont nous concevons les deux piliers d’une autorité politique légitime, à savoir les deux grandes questions que sont la place de la représentation politique et la responsabilité politique dans la constitution. On pourrait aussi espérer voir se forger une entente sur la façon, si je puis dire, de « ne pas s’entendre », c’est-à-dire parvenir à un consensus sur le dissensus. C’est à ce prix que pourra s’installer ce qui, précisément, a manqué dans la séquence qui vient de se dérouler : un gouvernement capable de se modérer dans l’exercice du pouvoir et une opposition capable d’agir de façon responsable. Peut-être qu’il y aura un sursaut de compréhension de la situation du côté de l’exécutif après s’être autant penché au-dessus de la falaise. Pour tout vous dire, je n’y crois pas beaucoup. Peut-être, du côté de LFI, va-t-il y avoir un rééquilibrage avec des responsables moins frontaux dans leur opposition, des personnes aussi qui ne goûtent pas le centralisme démocratique qui prévaut dans leur mouvement et qui voudraient le rendre – pourquoi pas ? – un peu moins centralisé et un peu plus démocratique. Je ne suis pas sûr d’y croire beaucoup plus…Des acteurs syndicaux raisonnables du mouvement social comme Laurent Berger ont pesé dans la discussion en contrôlant les manifestations, en faisant en sorte que la voix du mouvement social s’exprime comme une voix de raison. Dans un contexte où, désormais, s’expriment des formes de contestation moins modérées, on ne peut qu’espérer qu’ils continueront à œuvrer dans le bon sens. Le refus du président de recevoir les responsables syndicaux a été à mon sens un moment important de cette crise, en ce sens qu’il a traduit de sa part un refus d’agir de manière modérée, pour ne pas dire de façon responsable. Quant à changer les textes, on peut toujours le faire à la marge. Toutefois, il a été démontré qu’on pouvait avoir une restriction apportée au 49-3 en 2008 et voir cet outil être tout de même employé dix fois en trois mois pour l’adoption du budget 2023. Modifier l’architecture du régime est une autre affaire et, comme je l’ai dit, il n’est pas si simple que cela de remplacer un type d’équilibre par un autre.
Denis Baranger
Est-ce que cette position a un lien avec ce que vous appelez le droit politique ?
La Grande Conversation
En quelque sorte, oui. Une large majorité des professeurs de droit constitutionnel sont des gens qui pensent que le texte doit déterminer la pratique politique. C’est la culture de Georges Vedel, de gens qui ont dominé la matière et qui se disent : “Ainsi est la loi constitutionnelle adoptée par le peuple, ainsi doit être la pratique dans les institutions”. Et quand il y a modification de la pratique, éloignement par rapport au sens qu’ils attribuent au texte, c’est une dénaturation, une déviation, etc. Après, il y a des gens un peu plus minoritaires, dont je fais partie, et qui ont une approche réaliste du pouvoir politique. A leurs yeux, il y a toujours du pouvoir politique, même lorsqu’il n’est pas habilité juridiquement. Il est premier dans l’ordre de « ce qui arrive ». La politique est phénoménologiquement première, elle “arrive” et après, éventuellement, on peut espérer faire du droit. Je fais une comparaison avec un pré dans lequel il y aurait un troupeau de moutons qui se promènent librement. A un endroit, ils vont rencontrer une barrière. Le droit, c’est la barrière. Les moutons ont beaucoup de liberté, ils peuvent courir dans tous les sens. Mais il y a quand même des choses qu’ils ne peuvent pas faire. L’idée du droit politique, ce n’est pas du tout de faire de la science politique en droit. C’est de se dire que la compréhension des mécanismes juridiques implique une connaissance empirique de la réalité du pouvoir politique. Ici, typiquement, je pense qu’on a un exécutif qui a usé et abusé du parlementarisme que j’appelle réglementé et qui est maintenant déréglé. Et on a une frange de l’opposition qui a usé et abusé de ses prérogatives constitutionnelles. Notre constitution en a pâti.
Denis Baranger
Propos recueillis par Thierry Pech et Mélanie Heard.