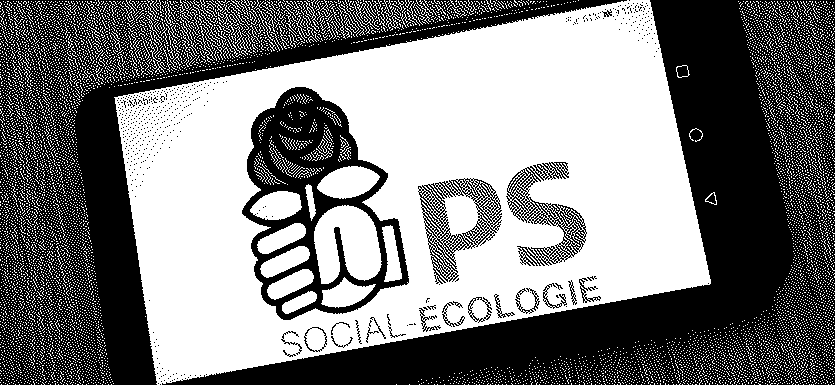Voici la coalition du centre et de la droite enfin portée sur les fonts baptismaux par le nouveau Premier ministre Michel Barnier. On peut naturellement s’étonner de voir ainsi les deux principaux perdants de la dissolution se donner la main pour gouverner le pays. Lors des élections législatives du 7 juillet dernier, le bloc central a perdu la bagatelle d’un tiers de ses sièges par rapport à 2022 (dont plus de 40% pour le seul groupe Renaissance). Quant aux Républicains (devenus La Droite républicaine), ils en ont abandonné un quart, poursuivant une chute vertigineuse depuis dix-sept ans (320 en 2007, 199 en 2012, 103 en 2017, 62 en 2022, 47 en 2024…). A elles deux, ces familles politiques ont perdu 99 sièges en l’espace de deux années. Il est singulier, après une telle saignée électorale, de voir se maintenir aux affaires ceux que les électeurs ont sanctionnés, et y revenir ceux qu’ils en avaient constamment bannis depuis douze ans.
Mais la surprise s’arrête là. Les plus découragés observeront qu’il fallait bien que le Président de la République trouve une solution à la crise qu’il avait lui-même créée et, qu’au bout du compte, il vaut mieux cet étrange attelage gouvernemental que pas d’attelage du tout et le chaos. Surtout, les plus avisés noteront que cette alliance consacre une convergence croissante entre ces deux familles de sensibilité ces dernières années. Et, s’il y a lieu de s’étonner de quelque chose, c’est surtout du fait que ces noces n’aient pas été célébrées plus tôt.
C’est en effet au lendemain des élections législatives de 2022 qu’elles étaient le plus attendues. A cette époque, Emmanuel Macron n’avait pas recherché cette alliance alors qu’elle aurait permis de franchir la barre de la majorité absolue et d’assumer ce qui n’allait cesser de s’affirmer dans les mois suivants : la droitisation accélérée de la famille macroniste. Au sein de cette famille, les composantes progressistes parurent de plus en plus cantonnées à un rôle de figuration tandis que les composantes les plus conservatrices se firent toujours plus vocales et plus influentes, comme en témoigne la trajectoire d’un Gérald Darmanin. A la fin (précipitée) de la législature, la dérive avait été si franche que le Modem de François Bayrou dont la moitié des élus avait refusé de voter la loi Immigration et dont certains avaient œuvré en faveur de la taxation des « superprofits » apparaissait comme la véritable aile gauche du bloc central !
De leur côté, en dépit de leur statut d’opposants, Les Républicains apportèrent un soutien presque constant à la majorité présidentielle : comme nous l’avions montré ici même, de juin 2022 à septembre 2023, dans 63% des votes en séance publique à l’Assemblée nationale, les collègues de MM. Ciotti et Marleix votèrent avec les représentants du camp présidentiel (contre 35% seulement sous la précédente législature). Et si l’on se concentre sur les 14 scrutins solennels portant sur des projets de loi dans leur ensemble sur la même période, les LR ne s’y opposèrent que dans 12% des cas (53% de soutien à la majorité, 3% d’abstention et 32%… d’absence le jour du vote !). Les députés LR furent de fait, et en dépit de leurs protestations, des partenaires contrariés de la majorité présidentielle tout au long de cette période. Et c’est pour des raisons strictement politiciennes qu’ils se divisèrent ensuite sur la réforme des retraites – pourtant en tous points conforme à leurs vœux – avant de se retrouver aux côtés des macronistes sur la loi Immigration, adoptant de conserve un texte dont les uns et les autres savaient pourtant pertinemment qu’il était, pour une bonne part, entaché d’inconstitutionnalité. A présent débarrassé des ciottistes, le groupe de la Droite républicaine à l’Assemblée abrite sans doute une majorité d’élus coopératifs. Cette famille n’est pas pour autant expurgée de ses passions conservatrices, singulièrement bien représentées dans le gouvernement : Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l’Intérieur passé par l’école Philippe de Villiers, incarne au contraire une droite dure et souvent réactionnaire. Il ne fait pas mystère de ses opinions sur l’immigration – à la tête de la majorité sénatoriale, il fut l’un des artisans de l’adoption de la loi Immigration. Et on imagine aisément que ses conceptions en matière de maintien de l’ordre ne seront guère progressistes – comme le RN, il est favorable à une présomption de légitime défense pour les policiers ayant fait usage de leur arme… Si le passé récent a montré que les macronistes étaient capables de s’accommoder de beaucoup moyennant la sécurisation de quelques acquis, les choix de Michel Barnier vont de fait les contraindre à frayer avec les plus réactionnaires : si l’on prend, parmi d’autres possibles, l’exemple récent de la constitutionnalisation de l’IVG, on compte dans le Gouvernement deux anciens députés et une sénatrice qui l’ont combattue, à rebours même de la majorité de leur groupe dans les deux assemblées (72 LR pour et 41 contre au Sénat ; 40 pour et 15 contre à l’Assemblée). Pourvu qu’ils laissent au vestiaire les oripeaux de la Manif pour tous, sur tout le reste, on peut discuter, semblent espérer les proches de Gabriel Attal.
Autre signe de cette convergence croissante, le nombre de transfuges LR – anciens ou récents – au sein des gouvernements d’Elisabeth Borne puis de Gabriel Attal, le plus souvent à des postes clés : Bruno Le Maire (Economie), Gérald Darmanin (Intérieur), Sébastien Le Cornu (Défense), Rachida Dati (Culture), Catherine Vautrin (Travail)… Ceux-ci s’ajoutant aux nombreux ministres de centre-droite : Marc Fesneau, Jean-Noël Barrot, Christophe Béchu, Aurore Bergé, etc. De ce point de vue, le casting du gouvernement Barnier parachève cette évolution : ce sont désormais les ministres issus des rangs de la gauche macroniste que l’on recherche désespérément – à l’exception d’Agnès Pannier-Runacher et d’Astrid Panosyan-Bouvet.
Organiser aujourd’hui la coalition du centre et de la droite, c’est donc opter pour la continuité, notamment en matière de politique économique, modulo les efforts de consolidation budgétaire qu’il va falloir fournir après sept années de baisses d’impôts non financées et de gestion imprudente des finances publiques. Et c’est opter dans le même temps pour une droitisation encore plus nette des politiques publiques dans le champ régalien. Depuis la calamiteuse dissolution de juin dernier, la vie politique nationale semble donc avoir fait simplement un tour sur elle-même pour poursuivre sa route à peu près sur la même trajectoire.
Naturellement, l’alliance de 2024 rassemble péniblement un tiers des sièges de l’Assemblée nationale quand celle de 2022 aurait réuni une confortable majorité absolue (312 sièges). Le total des sièges du bloc central et de la Droite républicaine (213) ne dépasse même que de 20 petites unités celui du Nouveau Front Populaire (193) à qui la possibilité de former un gouvernement a pourtant été refusée. L’écart pourrait d’ailleurs se resserrer si, comme quelques cas isolés l’ont suggéré ces derniers jours, des élus de ce qui reste de l’aile gauche de Renaissance devaient se mettre en marge de leur groupe parlementaire et reprendre leur liberté.
Cela justifie-t-il pour autant les accusations de « déni démocratique » ? Pas du point de vue de la lettre de nos institutions : la Ve République n’exige pas que le gouvernement s’appuie sur une majorité absolue à l’Assemblée nationale, ni même qu’il y dispose d’une forte majorité relative, mais simplement qu’il n’y ait pas contre lui une majorité d’empêchement pour voter une motion de censure et le renverser. Or, de ce point de vue, la « coalition Barnier » semblait présenter des garanties que ne présentait pas l’option du NFP. C’est du moins de cette façon que le Président de la République a justifié son choix : au nom de la « stabilité institutionnelle ».
C’est pourtant dans cette garantie supposée que réside le vrai problème démocratique. Pour conjurer une motion de censure, un trade off a été manifestement passé avec le Rassemblement national. Le contenu de cet accord n’est pas public ni même peut-être clairement formalisé par les intéressés. Marine Le Pen aurait, dit-on, exigé une réforme du mode de scrutin législatif en faveur de la proportionnelle en échange de son silence. Peut-être d’autres conditions ont-elles été posées. Mais, à la limite, peu importe : un pacte de non-agression semble bien avoir été scellé avec le Rassemblement national, c’est-à-dire avec la force politique contre laquelle ont voté deux tiers des électeurs en juillet dernier.
Car c’était peut-être la seule signification claire d’un scrutin dont le second tour avait été transformé en référendum sur la question : « voulez-vous d’un gouvernement RN ? » Et la réponse avait été clairement « non », à une écrasante majorité. Sceller une telle entente avec cette force politique-là à l’issue de ce scrutin-là relève bien d’une manipulation démocratique, a fortiori de la part d’un Président deux fois élu contre Marine Le Pen et qui avait promis de faire reculer durablement l’extrême-droite.
L’histoire montre cependant que les pactes de non-agression ne durent jamais très longtemps. Ils lient des forces rivales qui ont intérêt à suspendre provisoirement leurs hostilités mais conservent toutes les raisons de vouloir en découdre. Sitôt que l’une se sent prête ou que l’autre montre un signe de faiblesse, elle déchire le papier de l’accord et ouvre le feu. Dans le cas présent, le RN tiendra la « coalition Barnier » au bout de son fusil et la fera danser à loisir. Et, quand il le jugera bon, il mettra un terme au pacte faustien par lequel le nouveau gouvernement s’est lié à lui.