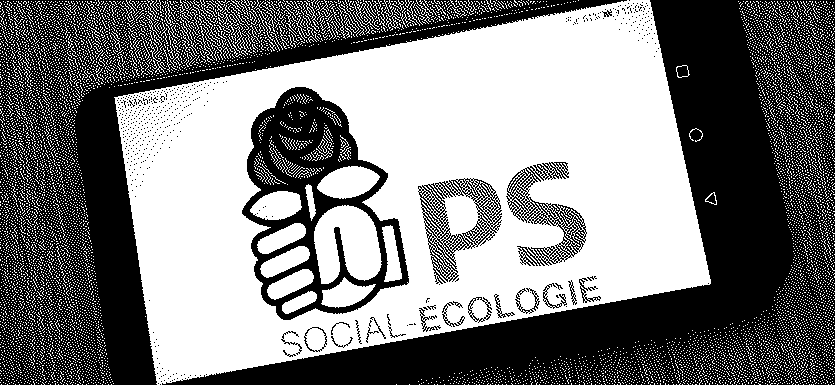Sylvain Kahn a accepté pour La Grande conversation, de présenter ces problématiques et d’en débattre avec Pierre Sellal, Pierre Buhler, Anne Bucher et Jean-Louis Missika.
Sylvain Kahn :
Depuis le 23 juin 2022, l’Union européenne est entrée dans un nouveau cycle d’élargissement, qui mérite la plus grande attention. A cette date, le Conseil européen a pris plusieurs mesures décisives. Il s’est prononcé en faveur de la Communauté politique européenne (CPE), visant à renforcer les liens entre l’UE et ceux qui en partagent les valeurs sans y appartenir, et a accordé le statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie. Dans ce même mouvement, le projet d’une UE élargie aux Balkans occidentaux déjà candidats (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie) a été réaffirmé de manière plus ferme. Le Conseil européen n’a pas exclu que d’autres pays s’ajoutent à cette liste, comme la Géorgie et la Bosnie- Herzégovine, qui ont récemment déposé leur candidature. Ce tournant, suscité par l’invasion russe, vient relancer le processus d’intégration des pays de la périphérie orientale de l’Europe, gelé depuis la fin de la dernière vague d’élargissement en 2013. Celle-ci avait commencé avec la chute du mur de Berlin, puis s’était propagée aux Républiques de l’ex-Yougoslavie. Dix pays ont rejoint l’UE en 2004 (dont Malte et Chypre), suivis par la Roumanie et la Bulgarie (2007), et enfin par la Croatie en 2013, qui a clos le processus. Depuis, l’élargissement n’était plus vraiment à l’ordre du jour de l’UE. D’autant, que, dans le même temps, les négociations d’adhésion avec la Turquie avaient été gelées.
Par rapport à toutes les autres vagues d’intégration, celle qui s’annonce a une nette spécificité. Car les six pays qui pourraient potentiellement adhérer à l’Union ne partagent pas les valeurs qui, depuis 1950, sont au cœur du projet européen. Dans les années 1950, avec la CECA puis la CEE, tous les pays de l’UE se sont prononcés en faveur de la supranationalité, et du même coup, en faveur l’abandon de la hiérarchie entre les nations. Le nationalisme a été répudié, tout comme son corollaire – la possibilité d’influencer, de conquérir et d’asservir d’autres nations et d’autres peuples. Les Européens se sont définis à rebours du principe de souveraineté nationale issu de l’ordre westphalien et ont accepté de s’unir, lors des quatre vagues précédentes, avec les pays qui adoptaient la même attitude. En revanche, avec la cinquième vague, pour la première fois, l’UE envisage d’intégrer des sociétés travaillées par le nationalisme, la conflictualité, les sorties de guerre mal réglées, et dont le territoire est partiellement occupé. Elle l’accepte car elle mesure la capacité de perturbation du système poutinien et préfère avoir les six pays candidats avec elle que sous influence russe.
Comment préparer dès lors l’intégration des pays concernés, au vu de cette radicale nouveauté ? Il convient, au préalable, d’écarter un faux-problème : celui de l’accroissement du nombre de membres, sur le plan démographique, politique et institutionnel. Le débat revient à chaque vague d’élargissement et ne me paraît pas si pertinent. L’histoire de l’UE le montre : il n’y a jamais eu autant de blocage que dans les années 1960, lorsque l’Union comportait six membre. On se souvient de la politique de la chaise vide de Charles de Gaulle.
Premièrement, il faudrait achever de généraliser le conditionnement de l’accès au financement européen au respect de l’État de droit. Deuxièmement, je propose de changer la politique d’élargissement au profit d’une adhésion graduelle – c’est-à-dire d’une participation des pays aux institutions de l’UE proportionnelle à leur intégration aux politiques publiques européennes. Ma troisième proposition est, dans les domaines qui se décident à l’unanimité, de maintenir le droit de veto, qui a une charge symbolique importante et apparaît comme une garantie de souveraineté aux yeux des dirigeants. Il pourrait être refondé sous le nom de veto « plus », c’est-à-dire d’un veto conditionné. On pourrait, par exemple, autoriser seulement un certain nombre de veto par an ou bien poser la nécessité d’être deux pays minimum (n’ayant pas adhéré à l’UE la même année) pour faire barrage. Ces dispositifs auraient l’avantage de rendre le droit de veto d’autant plus précieux et rare, tout en consolidant sa fonction initiale : dissuader et rassurer. Dernière proposition : demander aux pays candidats d’élire des eurodéputés qui auraient des rôles d’observateurs dans les institutions européennes dès 2024.
Pierre Sellal :
Ce ne sont pas les Européens, mais plutôt la France qui a changé d’avis sur le gel de l’élargissement de l’UE à d’autres pays. La France est l’une des seules nations – appuyée parfois par les Pays-Bas et l’Allemagne – qui s’est opposée fermement à la reprise d’un cycle d’élargissement de l’UE. Souvenons-nous qu’en 2017, Emmanuel Macron avait été le seul à refuser l’ouverture des négociations avec l’Albanie et la Macédoine. De même, lors de la préparation du sommet du Partenariat oriental (2021), la France avait refusé toute perspective d’adhésion à la Géorgie et à l’Ukraine. La proposition d’Emmanuel Macron d’instituer une Communauté politique européenne (CPE) s’inscrivait parfaitement dans cette ligne. C’était la reprise de la Confédération européenne de Mitterrand, visant à freiner le processus d’adhésion de nouveaux États en y préférant une politique de coopération et de voisinage. Mais Emmanuel Macron s’est aperçu que cette position pouvait être coûteuse, comme elle l’avait été à Jacques Chirac, qui avait manifesté sa mauvaise humeur quand les pays de la « nouvelle Europe » s’étaient alignés sur les Etats-Unis au moment de la guerre d’Irak. Macron n’a eu d’autre choix que d’accepter le principe de la relance de l’élargissement devant la guerre en Ukraine et il a eu raison. Il a changé de position, à tel point qu’il va désormais plus loin que ses partenaires, en prenant par exemple position pour une ouverture des négociations avec l’Ukraine dès la fin de l’année. Mais il tient toujours à ce que l’élargissement de l’UE soit accompagné, sinon précédé, de réformes internes. Or, il estime probablement maintenant que c’est en engageant effectivement le mouvement d’adhésion que l’on forcera une discussion entre les États membres sur les adaptations nécessaires de l’organisation institutionnelle de l’Union. Je pense que deux conceptions sur l’avenir de l’UE vont s’affronter. Il y a d’un côté la vision défendue par la France, d’une intégration à géométrie variable, avec des États membres impliqués de manière différenciée dans les politiques de l’UE. D’un autre côté, le chancelier allemand défend (discours de Prague) une autre vision, plaidant pour une indifférenciation des futurs 35 États membres et pour la généralisation du vote à majorité qualifiée. L’Allemagne espère, implicitement, pouvoir rallier la majorité des membres à ses positions.
Il me semble également que la réforme institutionnelle est un faux-problème. Ou plutôt qu’elle n’est pas plus nécessaire aujourd’hui qu’elle ne l’était avant l’élargissement consécutif à la disparition de l’URSS (2004-2007). Les institutions ont démontré leur plasticité et leur adaptabilité dans une Europe passée de 6 à 28 membres. Inversement, le bilan des réformes institutionnelles introduites, au nom de la préparation de l’élargissement, par le Traité de Nice, globalement mal inspiré, apparait aujourd’hui très discutable. En outre, je ne pense pas qu’il soit ni urgent, ni réaliste, de s’attaquer au droit de veto, qui n’a jamais empêché l’Union de fonctionner. Et pour cause : la règle de l’unanimité ne concerne qu’une part infime des décisions prises par l’UE chaque semaine. Lorsqu’une pression politique est suffisamment forte, il n’y a pas de veto qui y résiste – que ce soit en matière de fiscalité ou de politique étrangère, pour parler des rares domaines qui restent gouvernés par la règle de l’unanimité. Nous venons d’en faire l’expérience concrète au cours de ces dix-huit derniers mois : sur le sujet qui était considéré comme l’un des plus diviseurs entre les États membres, la relation avec la Russie, le Conseil a adopté, à l’unanimité, dans des conditions exceptionnelles de rapidité, onze trains de sanctions dont la sévérité et l’ampleur dépassent de très loin tout ce que l’UE avait pu décider dans le passé dans ces domaines. Et nous savons par ailleurs que plusieurs ratifications d’États membres manqueraient au rendez-vous si devait être entreprise une modification du traité pour abroger la règle de l’unanimité là où elle demeure.
Je suis assez sceptique, par ailleurs, sur le concept d’adhésion graduelle. Certes, il est admis depuis longtemps que l’adhésion à l’UE ne signifie pas un accès immédiat à l’espace Schengen ou une pleine participation à la zone euro. En outre, l’Union a toujours accordé, ou imposé, à ses nouveaux membres des périodes de transition dans certains domaines. Cependant, la matrice européenne, fondée sur l’indivisibilité des quatre libertés, a été réaffirmée avec une telle force, notamment dans le contexte du Brexit, que je vois mal comment concevoir des participations à la carte au marché intérieur et à ses principes constitutifs (non-discrimination, égalité de traitement, pleine application du droit de l’UE, droit de la concurrence, politique commerciale unifiée…). S’agissant de la participation aux institutions enfin : comment imaginer qu’un État membre participe aux institutions, c’est-à-dire à la prise de décision, au Conseil, par ses députés au Parlement, par « son » commissaire dans la définition de règles dont il serait exonéré de l’application ensuite ? Ceci est très problématique.
Un point essentiel me semble insuffisamment évoqué dans le débat. Je pense que la véritable question concernant l’avenir de l’UE pourrait être la suivante : comment intégrer dans l’Union un pays comme Ukraine, dont le revenu par habitant représente moins de la moitié du plus pauvre des États membres actuels, la Bulgarie ? Et comment concevoir des mécanismes, qui lui permettront de ne pas voir son économie s’effondrer ? Et comment faire accepter à tous les États membres bénéficiaires aujourd’hui des transferts de la politique de cohésion ou de la PAC de devoir y renoncer de manière quasi complète ?
Pierre Buhler :
Je souhaiterais revenir sur le droit de veto, c’est-à-dire l’obligation du vote à l’unanimité, qui constitue tout de même un problème de taille. Il est appliqué par le Conseil européen et pour certaines procédures spéciales du Conseil de l’UE. A savoir les votes touchant à la politique étrangère et à la défense, à la justice et aux affaires intérieures, à la fiscalité et à l’harmonisation des législations nationales, à l’adhésion à l’UE, au budget, à la politique sociale, à la citoyenneté et aux modifications apportées aux traités. Les pays les plus attachés au principe de souveraineté nationale souhaitent le conserver, et ont déjà du mal à accepter que le vote à majorité qualifiée s’applique à la plupart des sujets. En 2015, après la victoire du PiS, la Pologne avait ainsi rejoint ses trois partenaires du groupe de Visegrad (Hongrie, Tchéquie, Slovaquie) et la Roumanie dans leur opposition à la décision du Conseil de l’UE de répartir, par quotas, 120 000 demandeurs d’asile entre les États membres. Et lorsque les ministres de l’Intérieur de l’UE avaient, début juin 2023, adopté à la majorité qualifiée, malgré l’opposition de la Hongrie et de la Pologne, un projet de règlement relatif aux demandeurs d’asile, prévoyant leur répartition entre les États-membres, Jaroslaw Kaczynski, le président du PiS, avait aussitôt appelé à un référendum en Pologne sur ce sujet. Le débat autour de la suppression du vote à l’unanimité est un vrai sujet politique, hautement sensible. Le 9 mai 2022, le jour même de la publication des conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, qui s’était prononcée dans ce sens, 13 pays (Europe septentrionale et orientale) ont endossé une déclaration pour s’y opposer. Ils souhaitent clairement conserver le système actuel, arguant de la capacité de l’Union à maintenir son unité dans le cadre des traités existants, ainsi que l’a démontré son action dans la crise ukrainienne. De l’autre côté, après que le Parlement européen a voté, le 9 juin 2022, une résolution aux fins de convoquer une convention chargée de discuter de la généralisation du vote à majorité qualifiée, et que la Commission –von der Leyen et Borrell – s’est prononcée dans ce sens, l’Allemagne a pris l’initiative de créer un groupe d’« amis du vote à la majorité qualifiée pour la politique étrangère et de sécurité commune ». Fort de 8 États-membres, ce groupe inclut la France, qui l’a rejoint de façon assez tiède, cependant. C’est un sujet qui fait débat dans les pays concernés, les pays baltes, la Pologne et la Hongrie, mais aussi en Europe du Nord. La question est de savoir comment passer au vote à majorité qualifiée sur le terrain de la politique extérieure et de sécurité (PESC) et sur le terrain fiscal. Est-ce qu’on peut le faire de façon progressive – par la clause dite de « passerelle », qui requiert cependant un accord à l’unanimité du Conseil européen – ou faut-il en passer par une révision des traités – ce qui impliquerait l’ouverture d’une conférence intergouvernementale, une entreprise complexe et risquée ?
Anne Bucher :
Je ne suis pas d’accord avec Sylvain au sujet de la cinquième vague d’élargissement. Elle ne semble pas si différente de la précédente. Il y avait déjà, après la chute de l’URSS, cet élément de conflit, avec des États fortement nationalistes (séparation de la Tchécoslovaquie). Les pays candidats étaient aussi loin de coller parfaitement aux normes européennes, même si l’on a finalement trouvé le moyen d’intégrer la Bulgarie et la Roumanie avec des conditions sur la justice et sur l’État de droit. L’UE n’a toujours pas digéré cet élargissement, ce qui cause encore de nombreux problèmes en interne, liés aux cas de la Pologne et de la Hongrie notamment. C’est pourquoi les débats concernant la cinquième vague d’élargissement sont aussi complexes : être membre ne s’accompagne plus d’une adhésion sans réserve aux grands principes de l’UE et d’une progression des nouveaux États vers le modèle économique et social des États membres historiques. Le dilemme me paraît être le suivant : faut-il se réformer avant de s’élargir ou bien inventer un autre statut que celui d’État membre ? Treize États membres ont déjà déclaré qu’ils ne voulaient pas de changement des traités, puisque tout fonctionnait très bien dans la situation actuelle. Les scandinaves l’ont fait pour protéger les petits pays, et les pays de l’est par peur de la conditionnalité à l’État de droit en matière budgétaire et sur un certain nombre d’avantages et de participations. La première solution que vous mettez en avant – élargir la conditionnalité des financements à l’État de droit – exige un changement de traité auquel nous ne sommes pas préparés. Je ne pense pas qu’il sera possible d’élargir la conditionnalité à l’État de droit (appliquée pour les fonds européens et pour les fonds de relance) à tout le budget européen. Je ne peux pas imaginer, par exemple, que la PAC devienne conditionnée à l’État de droit. On est dans une situation difficile à l’heure actuelle. Est-on dans un « purgatoire des pays candidats » (expression de Pierre Mirel au sujet des Balkans) qui sera rapidement dépassé si on redynamise le processus ? Doit-on au contraire inventer un statut de nouveau membre ? Macron a été très ambigu sur la CPE et a laissé penser qu’il pourrait s’agir d’une alternative à l’intégration. Certains ont inventé des statuts, comme celui de membres affiliés d’Andrew Duff, qui donnerait accès aux bénéfices de l’intégration et de la convergence, un accès partiel au budget, et un statut d’observateur au Conseil ou un droit de vote sans droit de veto.
A l’heure actuelle, le débat se focalise sur comment redynamiser le processus d’élargissement avec des réformes institutionnelles permettant une participation plus importante aux décisions politiques dans la phase de pré-adhésion. Mais il y a un appétit limité à ouvrir la boîte de Pandore de ce que sera l’UE avec ces nouveaux États. Si on se concentre sur la question de la réforme du processus d’élargissement, je ne suis pas aussi pessimiste que Pierre Sellal : la théorie de l’intégration par cercles concentriques fonctionne relativement bien. L’Union monétaire joue un rôle important pour les pays qui choisissent de la rejoindre. Les discussions sur le marché intérieur ont par ailleurs passé sous silence un élément important : l’Union douanière. Or, une question est de savoir si l’on s’intègre d’abord sur le marché des services ou le marché des biens. L’Union douanière permet une intégration du marché des biens assez rapidement, ce qui est tout de même encourageant. Il y a certains services où l’on peut procéder à une intégration, comme les télécommunications ou l’énergie, voire les services financiers. Certains accords d’association ont déjà des dispositions allant dans ce sens. Ceci pourrait s’appuyer sur une participation des pays candidats aux agences régulatrices en tant qu’observateurs. Les experts et régulateurs de ces pays pourraient ainsi se familiariser avec les mécanismes de décision et bénéficier de la mutualisation et des échanges de connaissances entre régulateurs nationaux. Il y a encore des réflexions à avoir sur ce que l’on peut ouvrir comme avantages économiques, mais les dispositifs d’intégration progressive fonctionnent plutôt bien à mon sens et leur potentiel n’est pas totalement exploité.
En revanche, je trouve que le débat est très pauvre sur la question du financement des dispositifs. Il n’existe pas de mécanisme d’intégration budgétaire progressive. Il existe les programmes de pré-adhésion, avec les programmes de voisinage. Les pays candidats peuvent également participer aux programmes de l’Union (ERASMUS ou programme de recherche) en contribuant au prorata. Mais ces mécanismes restent limités et sans commune mesure avec les transferts budgétaires à l’intérieur de l’UE. Il n’y a pas un vrai modèle de solidarité avec les pays candidats pour développer le gradualisme. Je pense par exemple à la question de la PAC pour l’Ukraine : si l’Ukraine est à l’extérieur elle ne bénéficie pas de la PAC, et ce ne sont pas les mécanismes qui existent à l’heure actuelle dans la politique de voisinage qui permettent de financer la modernisation de l’agriculture ukrainienne. Je ne sais pas très bien comment cela se mettrait en place et je trouve que c’est un élément qui est passé sous silence dans le débat.
Au-delà des questions budgétaires et d’un besoin d’un mécanisme de solidarité dans la phase de pré-adhésion, le débat sur l’élargissement souffre d’une autre faiblesse, à avoir une réflexion de fond sur ce que serait une Union avec l’ensemble de ces États membres, à la fois institutionnellement, politiquement et économiquement. On intègre des États de plus en plus faibles. Or, la manière dont l’UE fonctionne dépend de la qualité des administrations nationales pour la mise en œuvre du marché intérieur. C’est un modèle qui ne résiste pas si on a une majorité de pays dont les administrations sont trop faibles. Il y a un ensemble de réflexion sur ce que serait cette union – avant même de parler de l’élargissement – qui n’a pas vraiment débuté.
Sylvain Kahn :
Il me semble, Pierre Sellal, que votre position est minoritaire dans le débat sur le droit de veto aujourd’hui. Je suis tout à fait d’accord pour considérer qu’il s’agit d’un faux problème pratique, mais il reste qu’il a une charge symbolique très forte. Le débat sur le sujet est en plein essor en ce moment, et les Européens font part chacun de leur point de vue. La vitalité de cette discussion me paraît bon signe pour l’Europe politique, elle montre que les États s’intéressent aux institutions supranationales et ne prennent pas leur réforme à la légère. Le débat en lui-même est un facteur d’européanisation et d’unité : Pascal Lamy (ancien commissaire de la Commission européenne) dit que les discussions menées dans les institutions européennes sont des « réducteurs de différences » entre les pays l’UE.
Anne Bucher, vous faites une objection importante à mon raisonnement. Mais il me semble que la Tchécoslovaquie est justement l’exemple qui, loin d’infirmer mon hypothèse, la valide. Les modalités du divorce entre la République tchèque et la Slovaquie sont un témoignage du changement de paradigme de l’Europe post-1950. La partition entre les deux territoires s’est faite dans la discussion, la concertation, personne n’a mis de chars à la frontière ou menacé d’envahir. Ce divorce à l’amiable s’inscrit dans l’état d’esprit politique qui est celui de la construction européenne. Le Brexit s’est fait dans des conditions apaisées également, dans la discussion. La 4e vague d’adhésions, celles des années 2000, ne paraît pas plus difficile à digérer pour l’UE que les précédentes. Rappelons-nous l’état d’esprit des agriculteurs français révoltés quand nous nous sommes élargis à l’Espagne ou au Portugal (1986). Par ailleurs, lorsque la Pologne et la Hongrie ont adhéré à l’UE, elles n’étaient pas dirigées par des gouvernements illibéraux et nationalistes. Encore aujourd’hui, ni Orban, ni le Fidesz ne mettent en avant l’irrédentisme ; d’autre part les sociétés de ces pays-là restent très majoritairement pro-européenne. Cela peut paraître très paradoxal : dans ces deux États, quasiment 50% de la population votent pour un gouvernement nationaliste et illibéral ; mais en même temps tout le monde s’accorde pour rester dans l’UE qui est un régime politique dont la supranationalité est le caractère distinctif.
Je suis d’accord avec la réponse d’Anne Bucher à Pierre Sellal sur l’adhésion graduelle. Celle- ci ne peut fonctionner que si les administrations nationales des pays candidats sont efficaces et sérieuses. Il est intéressant de réfléchir à de nouvelles manières « d’achever d’approfondir » l’UE, et de réussir à faire participer à des degrés divers et progressifs les candidats aux institutions. Le premier problème auquel nous allons être confrontés, c’est le niveau de vie en Ukraine. J’ai tendance à être optimiste : l’Ukraine est une grande puissance agricole du monde – une des cinq plus grandes puissances mondiales en exportation de céréales. Par conséquent, il y a une marge de progression très forte pour ce pays sur le plan économique. En actionnant différents leviers, y compris les investissements européens, je crois que l’UE parviendra à avoir un effet positif sur l’économie ukrainienne. J’ai été très frappé quand Pierre Mirel m’a expliqué qu’en temporisant avec les pays Balkans occidentaux, l’UE se débrouillait pour avoir une balance commerciale très excédentaire avec eux et de la main-d’œuvre bon marché, sans trop les intégrer. Pour intégrer l’Ukraine il faut se refuser à ce type de demi- mesures et réfléchir concrètement aux meilleurs moyens de faire rentrer ce pays dans l’Union.
Jean-Louis Missika :
Le phénomène nationaliste, illibéral et antieuropéen n’est pas réservé aux pays qui frappent à la porte. C’est un phénomène qui se déploie au nord de l’Europe, qui peut advenir dès le mois de juillet en Espagne, dès 2027 en France, ou encore en Allemagne, où l’extrême-droite progresse. Ce phénomène de transformation des partis conservateurs en partis anti-européens me paraît problématique et peut bouleverser l’UE dans les années qui viennent.
Sylvain Kahn :
L’extrême-droite en Europe ne me paraît pas capable, pour l’heure, de remodeler l’UE. D’abord parce qu’il n’y a presque plus de partis que l’on désignait, avant, comme europhobes. Les partis que vous appelez anti-européens sont des partis qu’il convient de définir comme eurosceptiques ou souverainistes. Ce qui ne veut pas dire que la situation de l’UE serait simple s’ils arrivaient au pouvoir dans une majorité de pays européens. Aujourd’hui, au Parlement européen, plus aucun parti n’affirme que l’UE est la seule responsable des problèmes nationaux et que l’urgence est de la dynamiter ou d’en sortir. Certaines positions, comme celle de Marine Le Pen qui propose de ne pas respecter certains traités européens peuvent inquiéter. Mais de fait cela n’arrive pas, ou déclenche des bras de fer, comme on le voit actuellement sur certaines décisions avec le gouvernement hongrois ou polonais dont les réformes judiciaires sont condamnées par la CJUE et la Commission qui a depuis peu le pouvoir de conditionner l’accès aux financements européens au respect de l’État de droit. Cette nouvelle compétence lui a été donnée par les États membres avec le soutien du Parlement européen. Jusqu’à preuve du contraire, lorsqu’un gouvernement eurosceptique est au pouvoir, le rapport de force est plutôt en sa défaveur. Quand un pays tente de se réformer de l’intérieur et de ne pas respecter certains traités, cela ne marche pas vraiment. Depuis 25 ans qu’il y a maintenant au sein de l’UE des partis eurosceptiques qui parviennent au pouvoir, on voit que par le jeu des calendriers électoraux et des alternances aux élections nationales, des changements de majorité permettent d’endiguer les tentatives de déroger aux traités européens. Je ne dis pas que cela ne pourrait pas arriver mais, pour l’heure, l’Italie, la Hongrie ou la Pologne ne parviennent pas à se défaire des traités européens qui leur posent problème. Par ailleurs, il n’y a pas dans leur population de soutien europhobe massif, au contraire. Enfin les partis de droite radicale et extrême sont divisés en deux eurogroupes parlementaires, dont l’un, celui des Conservateurs et réformistes européens (dont Fratelli d’Italia de Meloni et le PiS polonais de Kaczinski et Morawiecki) est atlantiste, et l’autre, Identité et Démocratie (dont la Lega de Salvini et le RN de Le Pen) est russophile. Il est par ailleurs très improbable qu’une fraction du PPE (dont font partie LR, Forza Italia, Plateforme civique, la CDU, entre autres) rejoigne CRE à l’issue des élections de 2024. Leur identité de vues sur les flux migratoires, l’intégration et l’islamisme sont réelles et influentes, mais les différences politiques d’ensemble sont plus grandes. Dans les faits, les partis souverainistes sont noyés au Conseil de l’UE et au Parlement européen.