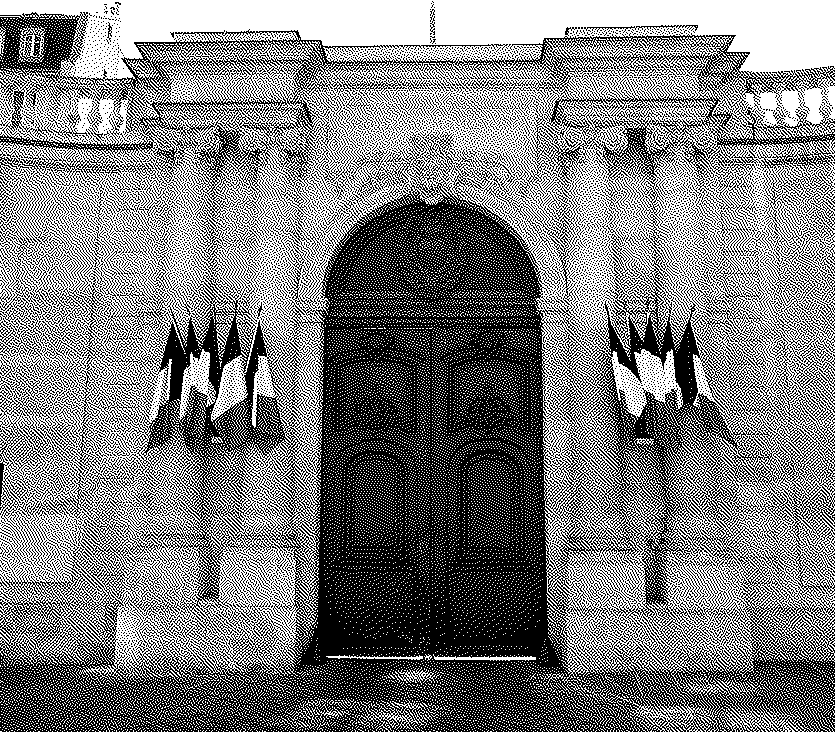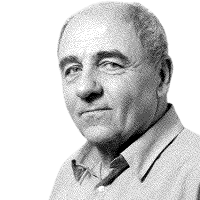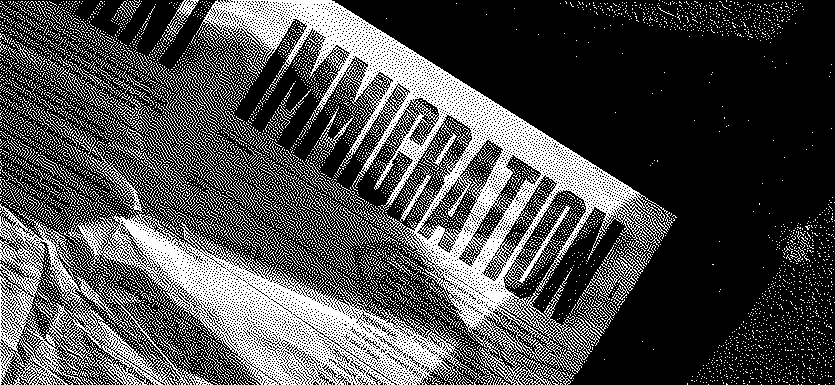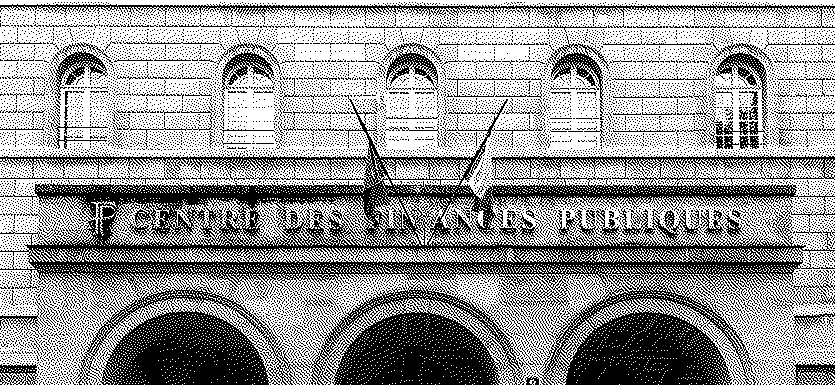« Never let a good crisis go to waste »
Winston Churchill
Le Président a choisi de nommer à Matignon un responsable perçu comme son double. Sans doute espère-t-il une nouvelle fois reprendre la main de cette façon. Mais, ce faisant, il s’expose en première ligne, au risque de subir la pression de ceux qui voudraient le voir démissionner avant la fin de son mandat pour rapprocher le rendez-vous de l’élection présidentielle. Son choix alimente en tout cas l’exaspération d’un mouvement social uni et renforcé : si l’appel de « Bloquons tout » n’a pas atteint ses objectifs de mobilisation, celui de l’intersyndicale le 18 septembre dernier a été en revanche beaucoup plus suivi, menaçant d’ajouter une crise sociale à la crise parlementaire et budgétaire.
Seul signe que l’exécutif se résout à tirer des leçons des précédents échecs de Michel Barnier et de François Bayrou, tous deux vieux routiers de la politique nationale, Sébastien Lecornu a été chargé de « consulter » en vue de la formation d’un gouvernement, dans un rôle qu’on appellerait en Belgique de « formateur », c’est-à-dire en explorant d’abord les intentions des groupes parlementaires susceptibles de soutenir un futur gouvernement. Une prudence bienvenue mais qui doit aller au-delà de l’effet d’affichage.
La mission de Sébastien Lecornu est à la fois extrêmement simple et presque impossible à mener à bien. Simple, parce que les données parlementaires sont limpides : pour faire voter des lois, et en premier lieu un budget, il faut trouver une majorité au parlement ou, a minima, dissuader toute majorité d’empêchement. Dans la composition actuelle de l’Assemblée nationale, celle-ci ne peut consister que dans une large coalition allant au-delà du fragile équipage que forment aujourd’hui le bloc central (Ensemble, Les Démocates, Horizons) et les LR (Droite républicaine). C’est-à-dire que le parti socialiste, enfin émancipé, au moins verbalement, de son alliance avec les Insoumis, devrait être sérieusement pris en compte par Sébastien Lecornu et, dans un esprit de responsabilité, devrait renoncer à faire croire qu’il est en position de rallier des « majorités d’idées ». L’option d’une « grande coalition », seule réaliste, mériterait d’être enfin discutée, même si les socialistes ne concédaient au bout du compte qu’un soutien sans participation ou une abstention constructive.
Mais cette logique de coalition parlementaire reste en même temps hors de portée parce que, à 6 mois des prochaines élections municipales et à 20 mois des prochaines présidentielles, les partis pensent qu’ils ont davantage à perdre qu’à gagner à se montrer conciliants. Ils misent en réalité, en se projetant déjà dans la prochaine élection présidentielle, sur un hypothétique retour aux équilibres institutionnels traditionnels de la Ve République, c’est-à-dire une large majorité parlementaire alignée sur le résultat de l’élection présidentielle qui aura précédé les législatives. Leur pari implicite est que le miracle qui a opéré en 2002, 2007, 2012 et 2017, se produise à nouveau en 2027. Dans cette série, 2022 ne serait en somme qu’un accident de l’histoire électorale de la Ve République. Cette hypothèse est pourtant largement improbable dans l’état actuel de fragmentation et de polarisation de l’opinion. A mode de scrutin inchangé pour les législatives, tout laisse imaginer au contraire un résultat en ligne avec celui des deux précédentes élections (2022 et 2024) qui ont mis un terme à la longue prédominance du « fait majoritaire ». Fait paradoxal de la situation, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours qui était censé favoriser la formation de majorités larges, homogènes et stables a abouti en 2024 à une représentation presque parfaitement proportionnelle et, du même coup, à une chambre fragmentée. Mais, en même temps, le maintien de ce mode de scrutin et de sa terrible règle de qualification au second tour (12.5% des inscrits) suscite des anticipations de « retour à l’ordre » qui bloquent la recherche des compromis transpartisans dont nous avons besoin du fait de la fragmentation de l’Assemblée et des urgences de l’heure (budget, défense, etc.). La réalité institutionnelle – c’est-à-dire la nécessité de trouver de tels compromis et, dans l’idéal, de constituer un accord de coalition explicite, transparent et stable – reste ainsi déniée par des acteurs politiques, autant à l’Elysée qu’au Palais Bourbon, qui croient toujours possible, contre toute évidence, de jouer la vieille partition de la Ve République dotée d’une majorité absolue.
Sébastien Lecornu, discret mais fidèle appui du Président depuis 2017, est présenté dans la presse comme un homme de dialogue, pragmatique et conciliateur. Ce ne sont pas les qualités dont il a fait preuve comme ministre des Outre-mer (2020-2022), en particulier en Nouvelle Calédonie où les efforts récents de Manuel Valls ont permis de rétablir un dialogue et un esprit de responsabilité encore très fragiles. Pour sécuriser une majorité, au moins relative avec une abstention constructive des socialistes, le nouveau Premier ministre devra résoudre l’équation budgétaire, qui semble aujourd’hui insoluble.
L’effort nécessaire ne serait-ce que pour stabiliser notre dette et l’empêcher d’entrer dans une spirale incontrôlable, est d’environ 120 milliards, soit près de trois fois les 44 milliards d’économies que proposait François Bayrou. Naturellement, une consolidation de cette envergure doit se déployer sur plusieurs années. Où trouver de telles économies ? D’abord du côté de l’impôt, répond la gauche qui souligne que, depuis 2017, les gouvernements successifs ont baissé les prélèvements obligatoires de 63 milliards – soit la moitié des économies aujourd’hui recherchées. Pour autant, les diverses formules de taxation des très riches mises en avant aujourd’hui sont très loin de faire la distance : comme l’avaient montré Guillaume Hannezo et Fipaddict pour Terra Nova, même dans les hypothèses les plus audacieuses, il apparaît difficile de tabler sur des recettes supérieures à 15 milliards d’euros par an, soit 12 à 13% des économies recherchées. Certaines de ces formules soulèvent en outre de sérieux problèmes de compétitivité des entreprises et de risque d’exil fiscal.
La droite, elle, met l’accent sur les dépenses et le « train de vie de l’Etat ». En réalité, là encore, les différentes propositions en circulation sont très loin de faire la distance. Même en prenant des hypothèses hautes, la suppression de postes de fonctionnaires ne « rapporte » que très médiocrement : lors de la dernière campagne présidentielle, le projet de suppression de 150 000 postes dans le programme de Valérie Pécresse présentait ainsi un rendement pour les caisses de l’Etat estimé à 5,9 milliards d’euros, soit 5% des économies recherchées… Même en doublant cet objectif, on arriverait péniblement à 10% de l’effort requis. Inutile de faire le même exercice sur les mesures les plus emblématiques du « train de vie » de l’Etat et des ministres (chauffeurs, indemnités, etc.) car, si importantes soient-elles symboliquement, elles présentent des rendements souvent inférieurs à la dizaine de millions.
Ces ordres de grandeur montrent à la fois l’inadaptation des propositions de gauche et de droite, et la difficulté du problème qu’il s’agit de résoudre. Problème d’autant plus délicat que sa gestion macro-économique exige beaucoup de doigté : on sait qu’une consolidation budgétaire trop rapide et brutale s’accompagnerait d’un choc récessif qui pourrait ajouter à nos difficultés. C’est pourquoi c’est une trajectoire crédible qu’il faut construire sur plusieurs années, une trajectoire susceptible de convaincre nos partenaires européens et de redonner des anticipations positives aux acteurs économiques dont l’attentisme, provoqué par le spectacle de l’instabilité politique, pèse sur les perspectives de croissance. Une trajectoire qui accompagne un récit politique partagé, c’est-à-dire un projet qui fait sens dans la situation historique du pays. Mais, naturellement, pour cela, il faut un gouvernement qui puisse lui-même se projeter dans l’avenir, au moins à deux ou trois ans et si possible à l’échelle d’une mandature complète. Dans la situation institutionnelle et politique qui est la nôtre, c’est évidemment hors de portée. Retour à la case départ, en somme.
Aucun des grands problèmes du moment – et ils ne manquent pas – ne pourra être résolu sans un gouvernement adossé à une majorité parlementaire stable. Faute de savoir la construire, il faudra sans doute, dans l’immédiat, se contenter d’expédients et de demi-mesures. Combien de temps cela peut-il durer ? Alors que le spectacle de notre impuissance politique entame notre crédibilité internationale, la route jusqu’à 2027 paraît tout à coup très longue.