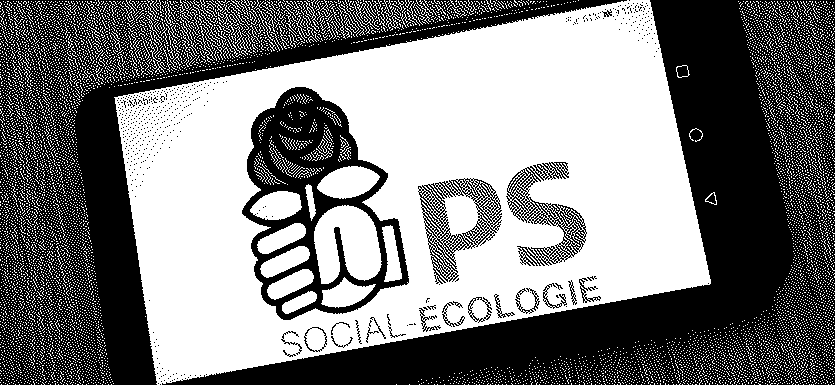Comment la stratégie de « dédiabolisation » de Marine Le Pen a-t-elle transformé sa position concernant l’Union européenne ? Le slogan de « sortie de l’euro » s’était révélé catastrophique pour la candidate du Rassemblement national en 2017. Outre ses dimensions techniques non maîtrisées par la candidate1, la proposition était apparue trop anxiogène aux électeurs : l’abandon de l’euro s’apparentait à un saut dans l’inconnu plutôt qu’à une mesure protégeant le pouvoir d’achat et restaurant une souveraineté supposée perdue. Elle a finalement renoncé à cette idée mais elle n’a pas pour autant cessé de cibler « la dictature de Bruxelles2. D’où un nouvel axe stratégique, en apparence moins frontal dans son opposition à l’Union européenne, mais en réalité plus sournois dans le procédé et tout aussi déterminé dans son objectif final : faire advenir une « Alliance Européenne des Nations qui a vocation à se substituer progressivement à l’Union Européenne »3.
« Nul besoin de renier nos signatures » : en apparence, Marine Le Pen ne s’engagerait pas dans une opération à la Britannique. Voilà pour le versant « rassurant » de son programme. La vision qu’elle développe se démarque donc d’une monomanie anti-européenne. Elle choisit en effet un point de départ d’abord affirmatif : le choix de la souveraineté nationale, présenté comme l’expression du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », du « droit du peuple français à rester lui-même » ou encore du « droit de chaque Etat de faire valoir son intérêt national et sa liberté de décision ». Elle oppose ce principe premier à une série d’« instances », mises sur le même plan, dans un système d’équivalence approximative, qui va au-delà de la « dictature technocratique folle » des institutions européennes : il s’agit des institutions multilatérales, des « juges internationaux » (et pas seulement européens), du commandement intégré de l’OTAN, des « gigantesques monopoles privés que sont les GAFAM » et même des ONG qui « s’érigent en autorités morales et bientôt en autorité de contrôle des Etats ». L’Union européenne n’apparaît donc d’abord que comme un adversaire parmi d’autres, une variété de supranationalisme parmi d’autres, au sein d’une série d’acteurs venant limiter et contraindre le « pouvoir des nations ».
Première étape de la nouvelle rhétorique : transformer le débat sur l’Europe en alignant l’Union européenne sur le même plan que toute une série d’instances supranationales, envisagées sous l’angle d’une potentielle contradiction avec l’expression de la volonté nationale. Deuxième étape : au lieu de contester ou de se retirer, ne plus prendre en compte. « Les décisions internationales contraires à un principe constitutionnel resteront simplement inappliquées ». On passe, en d’autres termes, d’une stratégie britannique (la sortie de l’UE) à une stratégie polonaise (le refus d’appliquer le droit européen). Concrètement, sa proposition centrale sur ce sujet consiste dans l’organisation d’un référendum sur l’immigration visant à « réaffirmer la supériorité de notre Constitution, de graver dans notre texte suprême qu’aucune décision internationale ou étrangère ne pourra imposer aux Français des mesures contraires à leur volonté souveraine ». La voie proposée semble donc à la fois simple et démocratique : il s’agit de redonner la parole au peuple par un référendum dont le thème sera l’immigration mais dont la portée sera beaucoup plus large puisqu’elle reviendra à contester la hiérarchie des normes selon laquelle des traités internationaux et le droit européen s’imposent au droit national. On comprend, à ce stade, qu’on s’extrait du débat technique de 2017 sur la sortie de l’euro pour s’aventurer dans un débat non moins technique… sur la hiérarchie des normes juridiques.
Avant d’essayer de clarifier les aspects juridiques de cette proposition, une remarque préalable s’impose. Marine Le Pen construit une opposition largement factice entre volonté nationale et instances internationales. Quand elle décrit les menaces qui pèsent sur notre pays (« la dilution de la France par déconstruction et submersion »), elle évite le plus souvent de désigner l’agent de tous nos malheurs en multipliant les tournures impersonnelles (« l’héritage de nos aïeux est bradé », « le pays semble échapper à tout contrôle ») ou des collectifs non spécifiés (« les dirigeants », « les élites autoproclamées », « quelques féodalités, quelques pouvoirs, quelques volontés autoritaires »). La France semble confrontée à des volontés extérieures qui s’opposent à ses aspirations propres dans un rapport d’adversité binaire. Jamais elle n’envisage la réalité juridique telle qu’elle est : si le France doit respecter des textes européens ou internationaux, c’est d’abord et exclusivement parce qu’elle les a signés et ratifiés, parce qu’elle a souscrit à ces textes de manière parfaitement libre et souveraine. Il ne s’agit donc que de respecter sa propre parole et ses propres engagements, d’être fidèle à elle-même, ce qui est un aspect essentiel de la souveraineté nationale, c’est-à-dire la continuité juridique de l’Etat, par-delà les vicissitudes politiques et les aléas de la conjoncture intérieure. L’affirmation de la volonté nationale tient lieu de nouvelle stratégie anti-européenne. Il s’agirait tout simplement de refuser d’appliquer le droit européen de manière discrétionnaire, en fonction des intérêts français, tels que définis par une majorité politique, au mépris des engagements antérieurs de la France, et donc en rupture avec la continuité juridique et morale de la nation. Une telle stratégie de souverainisme querelleur peut-elle mener autre part qu’au désordre et à un monde encore plus dangereux ?
Revenons au projet de référendum lui-même. Comment le lien est-il établi entre le thème de l’immigration et le résultat attendu, à savoir une réaffirmation de la primauté du droit national sur le droit européen et les conventions internationales ? En effet, le projet n’est pas de poser aux citoyens la question de fond qui est de savoir si la France doit continuer à respecter sa parole et sa signature. La question posée porterait sur une série de mesures concernant la « priorité nationale », l’accès à la nationalité, le regroupement familial, le droit d’asile etc. Or, pour cela, il faut dénoncer des traités internationaux comme le traité de New York sur les droits de l’enfant (qui affirme le droit de vivre en famille et protège par conséquent le regroupement familial) ou la convention de Genève sur le statut des réfugiés. Comme l’indique le programme de la candidate : « Il est indispensable de modifier la Constitution pour y intégrer des dispositions portant sur le statut des étrangers et la nationalité pour y faire prévaloir le droit national sur le droit international »4. Le projet est donc de proposer aux Français de se prononcer sur une série de mesures (priorité nationale, abolition du droit du sol, déchéance de nationalité…) tout en imposant un principe nouveau, « la sauvegarde de l’identité et du patrimoine de la France ». Le projet de loi qui serait soumis au référendum est présenté en entier (il fait 23 pages) en annexe du livret thématique sur l’immigration. Le titre III de la loi porterait sur « La primauté de la Constitution et du droit national ». En cas de vote positif, le programme compte sur le fait que le Conseil constitutionnel s’abstiendrait d’examiner une loi adoptée par référendum et la Présidente pourrait en tirer les conséquences en arrêtant d’appliquer les textes européens ou internationaux, dont la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
Ce scénario rencontre en principe deux obstacles. Le premier est d’ordre constitutionnel interne. Le second concerne l’Europe. Obstacle interne : un référendum est encadré par un certain nombre de garde-fous. Le premier concerne la nature des questions qui peuvent être soumises au vote des citoyens, lesquelles ne peuvent porter que « sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » (article 11 de la constitution française). Il apparaît clairement que les Français ne pourraient être appelés à se prononcer sur des traités anciens ni sur la question générale de la hiérarchie des normes. D’où l’idée de les faire se prononcer sur l’immigration. Ce sujet entre-t-il cependant dans le champ prévu par la Constitution ? Il semble que non car la question régalienne de la maîtrise de l’immigration ne relève pas des domaines énumérés. Il faut donc supposer que la conception plébiscitaire de la souveraineté populaire défendue par Marine Le Pen la pousserait à passer outre une censure du Conseil constitutionnel au nom de la « volonté populaire ». Si elle était élue présidente de la République et si elle menait ce projet de référendum en outrepassant l’avis du Conseil constitutionnel, ce serait certes un coup de force, mais qui pourrait l’en empêcher ? La référence à la « souveraineté populaire » serait bien sûr mobilisée pour justifier cet abus de pouvoir.
La même notion de « volonté souveraine » conduirait à un conflit avec les instances européennes. En effet, le droit européen ne serait, selon la proposition de Marine Le Pen, « plus appliqué ». Sans sortir de l’UE, la France se mettrait délibérément en infraction par rapport au droit de l’Union européenne et ne suivrait les normes européennes qu’en fonction de son intérêt immédiat, déterminé par la Présidente et sa majorité, soutenu par le résultat de son référendum. Le précédent polonais a pavé la voie de cette stratégie, en montrant qu’une série de reculs majeurs de l’Etat de droit n’impliquait pas, jusqu’à ce jour, une sortie de l’Union.
Le cas polonais a en effet rappelé la complexité de la relation juridique entre les Etats membres et l’Union. D’un côté, l’Union, puisqu’elle n’est pas une fédération, respecte l’identité constitutionnelle des Etats membres. La constitution nationale reste donc au sommet de la hiérarchie des normes de chaque Etat européen. Mais, d’un autre côté, un arrêt fondateur de la Cour de justice européenne datant de 1964 énonce la nécessité de la supériorité du droit européen sur le droit national, pour une raison plus fonctionnelle que substantielle : si chaque Etat interprétait les textes européens à sa façon, ceux-ci ne seraient pas homogènes, ce qui ouvrirait la voie à des inégalités de droits et de traitements entre les Etats membres et les citoyens de l’UE si bien que le projet même de convergence européenne en serait gravement compromis et, dans les faits, dépourvu de portée. Le président de la Cour de Justice de l’Union européenne, Koen Lenaerts, a ainsi récemment rappelé que la primauté du droit européen a été reconnue dans une déclaration signée par l’ensemble des Etats membres, dite « déclaration 17 », annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a abouti au traité de Lisbonne5.
Cette primauté ne concerne bien sûr que les domaines pour lesquels l’Union européenne a reçu une compétence (c’est-à-dire qu’elle ne concerne pas des sujets comme l’éducation, l’organisation de la justice, les politiques sociales, etc.) Elle ne signifie aucune « poussée fédérale » mais découle de la nature du projet européen lui-même, dans lequel tous les Etats sont égaux. Le droit européen n’est pas celui d’un super-Etat fédéral en gestation, destiné à absorber les entités nationales, comme le craint la candidate d’extrême-droite. Au contraire, c’est précisément parce que l’Union n’est pas fédérale que c’est au droit de garantir l’égalité de tous les membres et donc de prévaloir sur la diversité des droits nationaux. L’attitude des cours européennes, qui remplissent la mission qui leur a été assignée par les textes, montre l’équilibre inventif et inédit d’un projet de souveraineté partagée, intermédiaire entre une simple association d’Etats souverains et une union fédérale. En effet, dans un Etat fédéral le principe de souveraineté absolue des Etats serait remis en cause par la primauté du droit de l’UE sur la Constitution des Etats membres. Et dans une simple association, il n’y aurait pas de mécanisme contraignant interférant avec les droits nationaux.
Mais qu’en est-il quand un texte européen entre en conflit avec un principe constitutionnel ? Cette question devrait rester parfaitement théorique dans la mesure où l’on ne relève pas de contradiction entre les valeurs fondamentales affirmées par l’UE et celles reconnues par les Etats membres. Ce sont en effet les mêmes valeurs qui sont proclamées par les textes de référence et qui font partie des conditions exigées des prétendants à l’intégration. Cela s’explique parfaitement : le projet européen est issu de la volonté des Etats qui ont choisi de mettre en commun une série de compétences, sur la base d’une reconnaissance mutuelle de valeurs partagées. D’autre part, comme l’adhésion à l’UE est volontaire et approuvée démocratiquement, tous les Etats ayant fait le choix de l’Europe l’ont fait sur la base d’un ordre juridique clairement énoncé et de valeurs explicitement affirmées à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne6. Pourtant, cet accord présumé sur les valeurs apparaît de moins en moins évident d’un point de vue politique comme le montre l’arrivée de groupes parlementaires ouvertement anti-européens au Parlement européen depuis le début des années 2000.
Pour les juristes, les divergences d’interprétation résiduelles relèvent d’un « dialogue des juges », aussi apaisé que technique : le juge national s’adresse au juge européen, en posant une question dite « préjudicielle », lui demandant de clarifier un point de droit7. L’interprétation de la Cour de Justice européenne s’impose aux 27 Etats membres, ainsi qu’à leurs cours, y compris constitutionnelle, et aboutit à une « jurisprudence consolidée ». Ce processus est parfaitement cadré et n’a jamais provoqué de controverses débordant le cadre normé des arrêts de justice. La situation pourrait prendre une tournure différente, dès lors que le sujet devient l’otage d’un conflit politique, où certains partis jugent le débat comme existentiel pour l’identité de leur pays. Les évolutions politiques antilibérales récentes de la Pologne et de la Hongrie ont d’ailleurs donné consistance à cette possibilité de contradictions profondes.
Rappelons les faits concernant la Pologne : le gouvernement conservateur anti-européen du PIS mène depuis plusieurs années une campagne de politisation de l’instance judiciaire. Dans son viseur : l’indépendance des magistrats, c’est-à-dire la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Une série de réformes structurelles ont été engagées pour réduire l’indépendance de la justice à l’égard du pouvoir exécutif et législatif. Elles ont affecté systématiquement l’ensemble de la chaine d’autorités qui composent le système de justice polonais : le Tribunal constitutionnel, le Conseil de la magistrature, la Cour Suprême, les cours ordinaires, le procureur général et les présidents de juridiction. En particulier, le manque d’indépendance du Conseil de la magistrature (dont les membres sont désormais directement élus par la Diète) a eu pour conséquence d’entacher la légalité de la nomination des nouveaux juges (proposés par ce conseil). La Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme ont rendu une série d’arrêts soulignant le manque d’indépendance du Conseil de la magistrature et que l’exigence d’avoir un « tribunal indépendant et impartial établi par loi » n’est plus remplie par certaines chambres de la Cour suprême composées des nouveaux juges. De même, le Tribunal constitutionnel, qui a été recomposé en dérogeant aux procédures normales, n’est plus indépendant et est désormais activé uniquement à la demande du gouvernent ou du parti au pouvoir8.
La réplique polonaise se joue sur le terrain de la souveraineté nationale. Le jeudi 7 octobre 2021, la plus haute juridiction polonaise a élargi la polémique et s’est prononcée contre la suprématie absolue du droit communautaire européen sur le droit polonais. Elle a estimé que certains articles du traité de l’Union européenne étaient « incompatibles » avec la Constitution et a enjoint les institutions européennes à ne pas « agir au-delà du champ de leurs compétences » en interférant avec le système judiciaire polonais9. L’attitude polonaise est à la fois foncièrement anti-européenne et contraire au droit de l’Union : le 22 décembre 2021 la Commission a lancé une procédure d’infraction contre la Pologne car le Tribunal constitutionnel met en cause le principe de primauté du droit de l’Union et ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi10.
Parmi les mesures prises par l’Union en réaction au refus de la Pologne de se plier aux décisions de la Cour de justice européenne, une sanction particulièrement pressante consiste dans la mise sous condition des fonds du plan de relance européen post-crise sanitaire. L’argument européen est que l’Union peut légitimement conditionner le versement de fonds européens à la possibilité de vérifier que ceux-ci ne sont pas détournés de leur usage, ce qui suppose l’existence d’un contrôle indépendant. En l’absence d’indépendance de la justice, garantissant par exemple la régularité des appels d’offre, Bruxelles est fondé à refuser de débloquer les fonds. Mais le plus inquiétant réside dans le risque de contagion de l’attitude polonaise.
Au-delà du cas polonais, plusieurs cours constitutionnelles nationales, dont la Cour de Karlsruhe en Allemagne et le Conseil constitutionnel français, considèrent qu’il existe, en raison de l’identité constitutionnelle nationale des « clauses de sauvegardes »11. Un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne est venu clarifier la situation. L’Union européenne reconnaît « l’identité constitutionnelle » des Etats membres. Cependant, cette reconnaissance n’implique pas la faculté pour l’Etat membre de refuser d’appliquer de son propre mouvement une loi européenne. C’est le processus de question préjudicielle qui doit se dérouler, au terme de laquelle c’est à la Cour de Justice de l’Union, saisie par un juge national, qu’il revient, in fine, de constater l’invalidité éventuelle d’un acte de l’Union ou d’en donner une interprétation uniforme. Une cour constitutionnelle nationale ne peut donc pas, au motif que la Cour de justice de l’Union européenne aurait outrepassé sa compétence, rejeter de son propre chef une norme européenne12. Qu’arriverait-il, en effet, si chaque cour suprême avait le dernier mot sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union? Ce serait la fin du principe de l’égalité entre Etats membres de l’Union et le retour aux rapports de force qui ont divisé et dévasté l’Europe au siècle dernier. C’est la raison pour laquelle la Cour de Justice de l’Union doit toujours avoir le dernier mot quand il s’agit du droit de l’Union.
Revenons pour finir au projet de référendum de Marine Le Pen. Elle suppose qu’elle gagnerait son référendum malgré son inconstitutionnalité, c’est-à-dire au prix d’un coup de force. Elle se sentirait dès lors fondée à rejeter un certain nombre de décisions européennes au motif que les choix souverains du peuple français seraient supérieurs à ses engagements européens (qui ne sont rien d’autre, redisons-le, que les engagements antérieurs de la France). Elle prévoit également, dans l’exercice de chiffrage de son programme, de réduire de façon unilatérale la contribution française au budget européen de 5 milliards €13. Or, dans la partie « recettes » du programme, aucune baisse des fonds européens n’est envisagée. Ce qui signifie que la candidate imagine qu’elle pourrait continuer à bénéficier des financements européens sans respecter les engagements de la France et en se plaçant en infraction avec les règles européennes alors même que l’Union a désormais acté la possibilité de conditionner l’attribution de fonds au respect de l’Etat de droit.
Le point aveugle ultime de ce projet est qu’il méconnaît la réaction de nos partenaires. Ceux-ci ne resteraient pas inertes devant la crise majeure provoquée par la France. On l’a vu : le cas polonais a contraint l’Union européenne à préciser sa doctrine. D’un point de vue juridique, la position française, unilatérale, ne serait pas reconnue par les autres Etats. La Commission pourrait arrêter le versement de fonds européens en considérant que la situation juridique ne serait plus fiable dans le pays. La voix de la France ne porterait plus dans les instances européennes. De facto, la France serait en rupture avec l’Union, sans pour autant partir sur une voie d’indépendance comme les Britanniques. Une insécurité juridique majeure en résulterait pour tous les acteurs économiques. Elle aurait créé une situation de crise durable, dont elle ne tirerait aucun bénéfice tangible. Une réalité très éloignée de la promesse lénifiante de « coopération étroite » entre « Etats nations libres et égaux » que Marine Le Pen rêve de reconstruire avec ses alliés des extrême-droites européennes14.
Un autre scénario pourrait aussi se dessiner : la France pesant d’un poids plus élevé que la Pologne ou la Hongrie, l’insoumission française pourrait agir comme un dissolvant de l’édifice juridique et réglementaire européen en incitant certains autres pays à suivre le même chemin. De loin en loin, la dynamique de déliaison mise en place par notre pays pourrait conduire à une destruction rapide de l’Union européenne telle que nous la connaissons alors même que toutes les crises récentes (crise de l’euro, crise du Covid, crise ukrainienne) plaident en faveur d’une Europe plus solidaire, plus unie et collectivement plus souveraine. La pente sur laquelle Marine Le Pen cherche à entraîner notre pays n’est en apparence pas aussi anxiogène que celle d’une brutale sortie de l’euro comme en 2017, mais elle pourrait correspondre à une stratégie de « Frexit » caché par démantèlement de l’œuvre européenne.