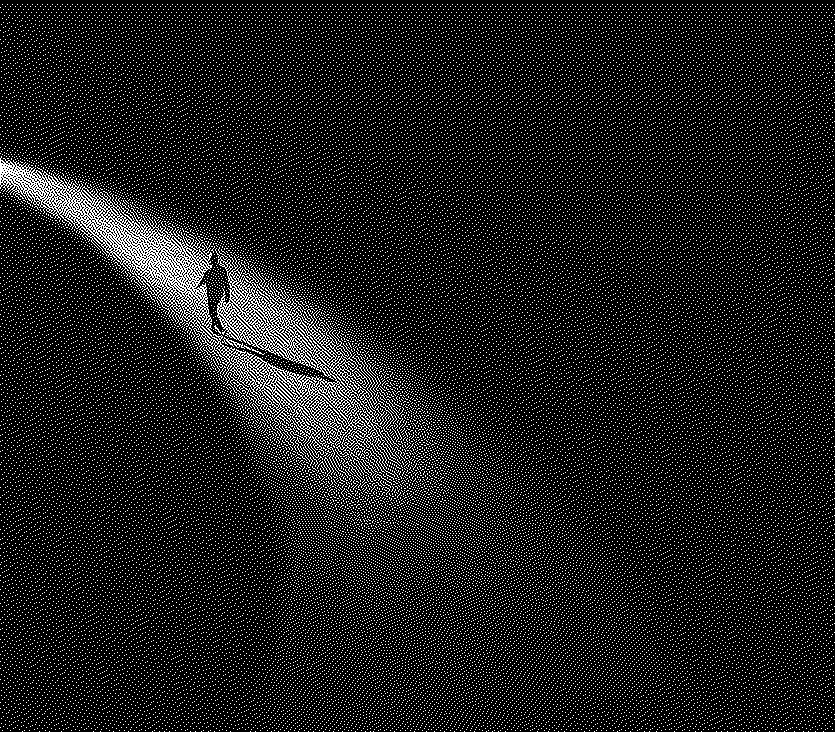Accédez au dossier complet : Fin de vie : quel cadre juridique ?
Je ne veux pas aller en Suisse. Je ne veux pas mourir seul, dans une chambre anonyme, dans une banlieue industrielle d’un pays que je ne connais pas.
C’est pourtant à ça que vous me condamnez, vous qui voulez interdire le suicide assisté en France. De quel droit pouvez-vous m’empêcher de maitriser ma fin de vie, de quel droit voulez-vous m’imposer ce que vous appelez vos valeurs qui ignorent les miennes ?
Beaucoup d’entre vous croient le faire par générosité, par souci éthique, par considération pour ceux que vous appelez « les plus vulnérables. » Vos questions, quand elles sont de bonne foi, méritent d’être prises au sérieux et il faut y répondre sans inutiles polémiques. Mais il n’y a pas de réponse simple car il n’est pas facile de regarder la mort en face.
De quoi parlons-nous ? Essentiellement du suicide assisté, où un patient demande de l’aide médicale pour pouvoir se suicider, pratique qu’il faut distinguer de l’euthanasie, dans laquelle ce patient demande une aide médicale qui inclue aussi le geste létal lui-même. Nous ne parlerons donc que du suicide des personnes en fin de vie ou en trop grande souffrance physique ou psychologique, pas du suicide « romantique » ou dépressif de sujets par ailleurs bien portants.
Celui qui croit au Ciel et celui qui n’y croit pas
Si la question du suicide assisté et celle de l’euthanasie s’imposent dans l’agenda des sociétés occidentales, c’est notamment parce que les religions et les croyances en l’au-delà ont largement reculé sous nos cieux démocratiques, en particulier en Europe.
La philosophe catholique Chantal Delsol constate – pour le déplorer – qu’un changement culturel « s’accomplit sous nos yeux depuis un demi-siècle qui correspond à l’effacement de la morale de culture juive et chrétienne
1 ». En Occident, ajoute-t-elle, pendant longtemps, « l’être humain a tenu son sacre de son créateur, et par là, sa mort ne lui appartenait pas
» ; mais, aujourd’hui, admet-elle, cette vision du monde s’est largement effacée.
Celui qui croit encore au Ciel est bien sûr fondé à respecter l’interdit religieux du suicide et à accepter l’injonction qu’il ne peut pas disposer de sa vie qui ne dépend que de Dieu. Il peut légitimement estimer qu’il doit faire l’expérience d’une mort qu’il ne choisit pas. Puisque selon la Bible « nul ne sait ni le jour ni l’heure
», le croyant peut rechercher « la riche pédagogie que porte la mort
»2. Même si c’est au prix de grandes douleurs.
Mais celui qui ne croit pas au Ciel, celui qui n’imagine pas d’au-delà de sa mort, est fondé non seulement à choisir de ne pas souffrir inutilement, mais aussi libre d’organiser sa fin de vie comme il l’entend. Pourquoi devrait-il râler, étouffer, délirer, rester des heures à attendre d’être lavé, avoir mal ou même s’éteindre au bout d’une longue sédation terminale qui l’aura déjà coupé des siens ?
Depuis 1905, en France, la séparation de l’Eglise et de l’Etat a été actée et la croyance religieuse relève d’un choix personnel. Du moins, nous l’espérons. Notre société respecte la liberté de croyance mais elle n’est plus organisée selon la religion. Dans le monde de l’hétéronomie, le suicide était interdit car il portait atteinte soit à la volonté divine soit aux intérêts de l’État. Dans le monde de l’autonomie, l’individu revendique le droit à disposer de sa vie comme il l’entend.
L’opposition au suicide assisté est une nouvelle illustration de l’angoisse que suscitent la démocratie et la liberté. Certains, comme Michel Houellebecq, pensent même, sans trop d’illusions, que nos sociétés ne peuvent pas survivre qu’en étant soumises à un ordre transcendant. « Sans ancrage par le haut, l’être humain n’a plus conscience de vivre en société
»3, lui fait écho l’essayiste Kévin Boucaud-Victoire. Comme s’ils réclamaient une nouvelle servitude volontaire à un ordre transcendant pour conjurer les angoisses qu’engendre le libre-arbitre.
Chantal Delsol en vient elle-même à se demander « comment et pourquoi voudrait-on empêcher la loi sur le suicide assisté et l’euthanasie si la plupart de nos concitoyens ont abandonné les croyances qui les rendaient impossibles ?
». La philosophe a le mérite de pousser son raisonnement au bout, même si c’est pour en regretter les conséquences. « Nous n’allons pas convaincre nos contemporains de renoncer à la souveraineté totale de l’individu qui constitue désormais l’architecture de nos sociétés, conclut-elle. Mais nous pouvons lui rappeler que ses convictions profondes rejettent malgré tout le destin inéluctable de ce genre de loi : un eugénisme libéral- le tri des humains par le caprice individuel, la mode, le confort et l’argent
». Est-ce si sûr ? Nous allons montrer qu’il ne s’agit pas d’un caprice libéral.
Une revendication utilitariste ?
La philosophe catholique semble considérer qu’une nouvelle loi parachèverait le triomphe des revendications individualistes qu’ont déjà illustrées le mariage pour tous ou l’IVG, auxquels elle a été fermement opposée. Pourtant, si cette évolution des sociétés contemporaines vers la souveraineté des droits individuels est indéniable, le droit à choisir les conditions de sa fin de vie ne peut être réduit à un caprice de consommateur égoïste.
S’il est vrai que nous sommes entrés dans une ère de la domination des droits individuels, le choix de sa fin de vie ne relève pas de la même catégorie utilitariste, ultra-libérale et ultra-individualiste. Choisir les conditions de sa mort n’a rien à voir avec la liberté de choisir son sexe, son genre, son nom ou son enfant via la gestation pour autrui (GPA).
Vouloir décider les conditions de sa fin de vie ne relève pas du consumérisme, du « droit à » si cher aux individus contemporains. Car, si on peut prétendre choisir son sexe, son enfant, sa conjugalité, on ne peut pas choisir de ne pas mourir, quoi qu’en pensent les illuminés transhumanistes.
Le suicide assisté c’est la volonté de contrôler sa mort, pas de l’effacer. Ce n’est pas un choix « consumériste » ni utilitariste, pas même un nouveau droit, mais une ultime liberté. Ce qu’on choisit dans la mort délibérée, ce n’est pas la mort elle-même, de toutes façons inéluctable, c’est la façon de mourir, ce qui est différent. La liberté de décider quand et comment mourir aide à vivre. « Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts
», dit Hadrien chez Marguerite Yourcenar.
Libre de se suicider ?
Accepter le suicide assisté, c’est reconnaître la réalité du monde contemporain et des transformations qu’il a connus. Pourquoi donc interdire à celui qui a fait ce choix une aide extérieure, qu’elle soit médicale ou bénévole ?
Quand Luc Ferry dit que « hors les cas infimes où c’est physiquement impossible
», l’individu peut se suicider « tout simplement sans faire appel à autrui »4, de quoi parle-t-il ? Nous sommes libres de nous suicider depuis la décriminalisation du XIXe siècle, mais comment faire ? Sauter du haut d’un immeuble comme Gilles Deleuze, plonger sous un train, se remplir les poches en entrant dans l’eau glacée comme Virginia Woolf, s’enfoncer un pistolet dans la bouche comme Montherlant ou Romain Gary, se pendre au milieu de son appartement, précipiter sa voiture contre un mur, s’étouffer sous un sac en plastic comme Bruno Bettelheim, se trancher les veines ou, pourquoi pas, faire seppuku comme Mishima ?
Le septuagénaire retrouvé à Ivry un matin de février 2019, un couteau planté dans le cœur au pied de son immeuble, avait demandé une aide médicale pour partir car son cancer le faisait trop souffrir.
Selon le rapport 2020 de l’Observatoire national du suicide, les décès par suicide des personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 20 % de l’ensemble des décès par suicide, alors que cette tranche d’âge ne constitue que 9 % de l’ensemble de la population. Sur près de 10.000 suicides enregistrés chaque année en France, on compte 52% de pendaisons et 13% de décès par arme à feu.
Luc Ferry n’a pas peur d’exercer sa casuistique en soutenant que, si on a besoin d’aide, cela signifie qu’on est « essentiellement dépendant (…) sans quoi on se suiciderait simplement sans faire appel à autrui
». Refuser l’assistance au suicide, équivaut à l’interdire. Pourquoi alors ne pas revenir à son interdiction lege artis, monsieur le philosophe ?
La comparaison a ses limites, mais rappelons-nous l’époque où les Françaises devaient – quand elles le pouvaient – partir à l’étranger pour interrompre une grossesse. Rappelons-nous que Marie-Louise Giraud, une « faiseuse d’anges », avait été guillotinée en 1943. Rappelons-nous qu’il a fallu attendre 1975 pour que la loi Veil soit adoptée. Et si on refuse le suicide assisté au nom de la sacralité de la vie humaine, pourquoi ne pas interdire l’IVG ?
La médecine a changé la mort
Les progrès immenses de la médecine ont transformé les conditions de l’agonie et de la mort. Mais souvent ils fabriquent aussi du handicap. Avec les avancées constantes des techniques, notamment en réanimation, on maintient en vie, et on maintiendra toujours plus, des gens qu’on ne peut plus guérir. Jusqu’où doit-on prolonger un coma dépassé ? Quand et qui doit décider de « débrancher » ?
En permettant à de plus en plus de gens de vivre vieux, voire très vieux, la médecine a ouvert la voie aux longues agonies. Elle est capable de prolonger indéfiniment des vies qui n’en sont plus. La définition même de la mort est devenue incertaine.
Certes l’acharnement thérapeutique, rebaptisé obstination déraisonnable, a été défini et interdit par la loi Leonetti de 2005 ; mais comment qualifier la situation d’un malade qui n’est maintenu en vie que grâce à des machines ?
Les limites de la loi Claeys-Leonetti
La loi Claeys-Leonetti a rendu les directives anticipées plus contraignantes et a autorisé une sédation profonde et continue jusqu’au décès si le pronostic vital est menacé à court terme, c’est-à-dire sous quelques heures ou, au plus, quelques jours. Non seulement elle ne garantit pas une fin de vie apaisée ni n’empêche les longues agonies des cancéreux dont le décès n’est pas prévu à court terme, mais elle ne dit rien des cas des maladies neuro-dégénératives, maladie de Charcot, Alzheimer, Parkinson, etc. Quand la maladie de Charcot est diagnostiquée, le malade sait qu’il a au plus quelques années de survie et qu’il va connaître progressivement une paralysie de toutes ses fonctions et une perte totale d’autonomie dans sa phase finale. C’est généralement l’incapacité de respirer qui provoque le décès. Un malade qui ne veut pas atteindre ce stade ne pourra pas être aidé à mourir car le pronostic vital sera plus long que ce que prévoit la loi.
Pour les autres, l’agonie est accélérée par l’interruption des moyens artificiels de survie, assistance respiratoire, nourriture artificielle, etc. Le malade meurt le plus souvent d’insuffisance rénale qui peut accompagner une agonie prolongée et être, dans certains cas, douloureuse.
Le Conseil d’Etat, en juin 2018, a donc logiquement estimé que « s’en tenir à l’évolution naturelle de la maladie risque d’aboutir à une situation dans laquelle le patient, dont les traitements ont été arrêtés et qui s’est vu administrer une sédation profonde et continue, décède au terme d’un délai indéterminé et qui s’avère parfois déraisonnable
».
Le choix de recourir à la sédation terminale plonge l’agonisant dans une profonde inconscience. S’il montre encore des signes de souffrance, on peut augmenter les doses de sédatifs, ce qui peut accélérer le décès « sans intention de le provoquer
».
C’est ce qu’on a appelé le « double effet ». Un principe théorisé par Thomas d’Aquin qui posait plusieurs conditions pour qu’une action puisse ou non être moralement autorisée. Dans ce cas, cela veut dire que le « mauvais effet » prévisible, la mort du patient, devient acceptable s’il n’est pas intentionnel. Donc si la sédation profonde entraîne une accélération du décès, pour qu’elle soit morale, il suffit que ce ne soit pas ce qui était recherché. Regardons ailleurs ! Cachez cette mort que je ne saurais voir. Une tartufferie.
Le professeur Didier Sicard, dont les positions sont toujours prudentes, en est bien conscient lorsqu’il déclare : « quand on endort quelqu’un pour qu’il ne se réveille pas, c’est une hypocrisie de dire qu’on vise le soulagement et non la mort
»5.
Par ailleurs, au-delà de ces acrobaties morales et sémantiques, il faut bien se rendre compte qu’en agissant ainsi les médecins transgressent effectivement l’injonction de ne pas tuer. Il en va de même lorsqu’on défend, comme Axel Kahn, une « exception d’euthanasie ».
Il faut parler vrai : soit la sédation ne vise qu’à « atténuer » les douleurs du mourant au risque qu’il souffre quand même, soit elle est vraiment profonde et définitive et ne se distingue plus d’un geste euthanasique. Mais peut-on décemment parler, dans ce cas, de « processus naturel », comme le fait la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs ?
Paradoxalement, ce sont les plus farouches adversaires de l’aide à mourir qui font la critique la plus conséquente de la loi Claeys-Leonetti. Ainsi Jean-Marie Le Méné, de la Fondation Jérôme Lejeune. Avec une grande cohérence, puisqu’il est radicalement opposé à toute intervention qui peut faire mourir, il dénonce la sédation profonde et continue jusqu’au décès, prévue par la loi de 2016, puisqu’elle peut avoir pour conséquence d’accélérer la mort. Ce qui, à ses yeux, revient à tuer le patient. « Les partisans de l’euthanasie, écrit le haut magistrat de la Cour des comptes, ont beau jeu de dénoncer l’hypocrisie d’un système qui conduit à faire mourir une personne consentante (…) Quel est l’intérêt d’un protocole de prolongation d’agonie qui passe manifestement pour inhumain ? (…) Au nom de quoi refuser le suicide assisté à une personne éligible à l’arrêt des soins ?
»6. C’est à ce titre qu’il considère qu’on ne peut s’opposer à l’euthanasie au nom des soins palliatifs, si ceux-ci contribuent à hâter le décès. Ils ne sont défendables, à ses yeux, que « s’ils excluent clairement l’arrêt des soins
».
« En notre âme et conscience
, reconnaissait Axel Kahn, nous médecins pouvons transgresser la loi. Nous l’avons souvent fait
». Mais il se disait « épouvanté devant l’élargissement du domaine d’application de l’euthanasie
»7, préférant à toute nouvelle loi s’en remettre à une attitude indulgente, notamment des tribunaux, devant des cas exceptionnels. Une attitude semblable à celle de Bernard Debré qui reconnaissait avoir pratiqué des euthanasies mais voulait « être en transgression ». N’est-ce pas, sous prétexte d’éviter des dérives, une manière de justifier la toute puissance médicale ?
C’est l’incohérence de ces dispositions qui a amené le Comité consultatif national d’éthique à envisager une modification de la loi de 2016 et à admettre pour la première fois et à de « strictes » conditions, « la possibilité d’un accès légal à une assistance au suicide
».
Jusqu’à présent, la demande de suicide assisté a été traitée de manière cruelle et profondément inégalitaire. L’immense majorité des malades a été abandonnée à elle-même quand ceux qui en avaient les moyens ou les connexions allaient mourir à l’étranger ou se faisaient aider clandestinement.
Ainsi tout laisse à penser que François Mitterrand a été « aidé » dans ses derniers moments. Il était officiellement opposé à l’euthanasie, mais les confidences d’Anne Pingeot indiquent qu’il avait choisi d’abréger son agonie. Outre ceux qui vont à l’étranger, d’autres bénéficient de l’aide, clandestine, de médecins amis. Françoise Giroud reconnaissait qu’elle avait aidé son mari à mourir, Françoise Fabian avait fait de même avec son père. Paulette Guinchard, ex-secrétaire d’Etat de Lionel Jospin qui s’était publiquement opposé à l’aide médicale à mourir, elle, est allée se suicider en Suisse.
« Chacun devrait pouvoir être identiquement respecté dans ses choix existentiels et avoir accès, pour cela, à une mort la plus conforme possible à ce qu’il souhaite
», écrit la cardiologue Véronique Fournier, fondatrice du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin8.
Tu ne tueras point
Depuis l’Antiquité, le commandement de ne pas tuer divise. Il demeure une affaire complexe qui ne supporte que nuance et subtilité. Mais est-il vrai que la soi-disant transgression de l’injonction « tu ne tueras point » marque un « changement anthropologique », comme le soutiennent les adversaires du suicide assisté ?
Au-delà de l’injonction qui souffrait quand même diverses exceptions – il suffit de se rappeler la Saint-Barthélémy – c’était, jusqu’à une époque récente, la possibilité du salut qui dominait la mort, un moment où les douleurs de l’agonie pouvaient constituer une forme de rachat.
Cette approche n’a pas complètement disparu de l’inconscient de certains, comme le montrent les propos du docteur Marin, un médecin spécialisé dans les soins palliatifs : « Mourir est un long travail parfois, il fait peur mais il est aussi, comme tout travail, porteur de grandes richesses
»9.
Quant au suicidé, auteur d’un crime sans rachat possible, il ne pouvait pas recevoir les derniers sacrements et il était voué à la damnation.
Mais pourquoi prétendre aujourd’hui que le suicide assisté enfreint l’interdiction de tuer ? Certes, qui se suicide se tue. Mais l’injonction biblique correspond à l’interdiction de l’assassinat, au meurtre d’autrui. Or, le suicide n’est pas un meurtre. Et l’assistance au suicide n’est pas un assassinat. Sinon il faudrait incriminer les marchands de pistolets et pourquoi pas les vendeurs de corde.
Le philosophe François Galichet nous fournit une autre interprétation des commandements divins. Il rappelle la phrase de Jésus : « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne
». Si chaque chrétien doit imiter le Christ, ajoute-t-il, cela signifie que lui aussi est appelé à « donner » sa vie s’il l’estime, en conscience et dans des circonstances extrêmes, « digne et juste
»10. « La conception de la vie comme « don de Dieu », poursuit-il, justifie en réalité la légitimité de la mort réfléchie (…) Exclure la mort du champ de notre liberté, c’est faire injure à Dieu, le considérer non comme un Dieu d’amour mais comme un Dieu jaloux, possessif, imposant des interdits et des restrictions à ce qu’il donne
»11.
Le serment d’Hippocrate tel qu’amendé en 2012 par l’Ordre des médecins, et sa formule « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément
» souvent invoquée pour condamner le suicide assisté, sont tout sauf un texte sacré. Depuis l’origine, ce qu’on a convenu d’appeler le serment d’Hippocrate a subi de nombreuses modifications et ne comporte pas cet interdit dans plusieurs pays. Le « serment de Genève » adopté par l’Association médicale mondiale se contente par exemple d’une formule vague – « Je veillerai au plus grand respect de la vie humaine » – qui laisse beaucoup de liberté d’interprétation.
Mais surtout ce texte est aujourd’hui en décalage avec les évolutions rapides de la médecine. Comme on l’a vu, la théorie du « double effet » transgresse déjà l’interdit mais encore plus la possibilité d’ « exception d’euthanasie » défendue par ceux qui ne veulent pas qu’on légifère.
Avec la loi Claeys-Leonetti « pour la première fois, on accepte que la médecine donne la mort même par effraction (double effet)
, explique Didier Sicard. Il y a un renoncement au fait que le médecin ne doit pas donner la mort. Si le malade souffre et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’atténuer sa souffrance qu’en donnant la mort, alors on la donne
»12.
Tuer c’est supprimer quelqu’un contre sa volonté, c’est une violence qui recherche l’anéantissement de l’autre et dont le paroxysme est le génocide. Se suicider, même en se faisant assister, est un rapport à soi-même, on pourrait même dire un choix de vie qui ne peut être assimilé au meurtre.
En quoi la possibilité d’aider à mourir quelqu’un qui, arrivé au bout de son existence, le souhaite en toute conscience serait-elle la transgression d’un tabou, voire un « changement anthropologique » ?
Refuser le droit de choisir sa mort revient à considérer la vie comme une prison dont on n’a pas le droit de s’échapper.
Mourir parmi les siens
Pourquoi dire que celui qui choisit de se suicider ne fait plus l’expérience de la relation avec les siens ? Le malade plongé dans le coma médicamenteux des ultimes soins palliatifs fait-il l’expérience d’une relation avec les autres que le suicide empêcherait ?
Au contraire, celui qui, en toute conscience, décide du jour et de l’heure, celui-là peut organiser ses adieux à ceux qu’il aime alors que beaucoup d’agonies douloureuses pour finir dans le coma traumatisent bien plus les familles que ne l’aurait fait un suicide assisté.
Alors, pourquoi le condamner, comme c’est toujours le cas, à aller mourir dans un pays étranger, dans une chambre étrangère, accompagné de bénévoles étrangers et dans une atroce solitude ?
La « sédation terminale », c’est-à-dire un sommeil précédant la mort, est aux antipodes de la conception ancienne qui voulait qu’on meure en toute lucidité, au milieu de ses proches. Le suicide assisté, lui, permet de partir quand un adieu est encore possible.
Un de mes amis, qui avait l’avantage d’être suisse, atteint d’une tumeur au cerveau qui le condamnait à court terme, a profité de ses dernières forces pour mettre en ordre ses affaires, visiter les lieux qu’il aimait avec ceux qu’il aimait, parler encore un peu avec les siens, avant d’appuyer sur la molette qui l’a fait mourir dans l’instant. Son mal était déjà avancé, son autonomie se réduisait très vite. Il ne voulait pas perdre tout contrôle de son corps, de sa tête ni, oui, de sa dignité. A ses propres yeux. Il me l’avait dit.
Ne pas opposer suicide assisté et soins palliatifs
Le chantage fait par certains soignants, qui menacent d’abandonner les soins palliatifs si une loi autorisant l’euthanasie active est votée, est très choquant. Ceux-là ne devraient plus nous parler d’éthique. Une association comme la Sfap (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs), très active dans les médias, ne se contente pas de promouvoir les soins palliatifs mais lutte aussi contre toute forme d’aide à mourir. Une position militante qui ne poserait pas de problème si les pouvoirs publics ne lui avaient accordé un rôle central. Au point souvent que, dans les médias, la Sfap, et notamment sa présidente Claire Fourcade, apparaissent comme la voix de tous les soignants (une enquête de l’INSERM montrait pourtant, en 2003, que 45% des médecins généralistes étaient favorables à une dépénalisation de l’euthanasie comparable à celle des Pays-Bas).
De même, dire que l’autorisation du suicide assisté priverait les soins palliatifs de financements, est tout à fait spécieux. Actuellement, une vingtaine de départements sont dépourvus de services de soins palliatifs et, là où ils existent, ils sont insuffisants. Seuls 30% des Français qui en auraient besoin en bénéficient. Si tout le monde est d’accord pour que l’accès aux soins palliatifs soit généralisé, ne nous racontons pas d’histoires : les urgences sont débordées, le système hospitalier menace de s’effondrer et cela n’a rien à voir avec une loi sur le suicide assisté qui n’existe pas.
Ecartons aussi une mauvaise polémique sémantique. Les adversaires de la mort choisie soutiennent que la formule « mourir dans la dignité » employée par certains partisans de l’euthanasie, signifierait qu’ils considéreraient les autres morts comme indignes. C’est un faux procès.
« La dignité est une qualité intrinsèque et inaliénable de la personne humaine
», écrit le professeur belge François Damas13. Refuser au malade de faire des choix pour ce qui le concerne, poursuit-il, « c’est le déposséder de ses prérogatives essentielles d’individu à définir les conditions de sa dignité
». Ce n’est ni à l’Etat ni même à la société de définir ce qu’est ma dignité. Il s’agit de l’autonomie de l’individu libre de choisir les conditions de sa fin de vie.
Il n’y a pas de mort indigne mais il peut y avoir des conditions de mort indignes, dégradantes ou cruelles. Je veux avoir le droit de refuser qu’on m’alimente par sonde, qu’on m’aide à respirer avec une trachéotomie, qu’on me torche, qu’on me manipule, même avec délicatesse, comme un objet… Qu’est-ce que ça apporte aux autres si je meurs lentement ?
Arrêtons aussi de faire croire que les soins palliatifs sont une solution facile. L’agonisant qu’on cesse d’alimenter, d’aider à respirer, parfois de s’hydrater peut mourir en donnant, devant les siens, le spectacle d’une agonie douloureuse. Il y a parfois un acharnement palliatif.
Risque de « dérives » ?
A court d’arguments, les adversaires du suicide assisté invoquent souvent des risques de « dérive », l’adoption d’une loi sur l’aide à mourir ouvrant, selon eux, la porte à la barbarie. A les entendre ce serait un premier pas vers l’eugénisme quand ce n’est pas le génocide des plus fragiles.
Un des principaux arguments des opposants est qu’une loi provoquerait une augmentation des suicides parmi « les plus faibles et les plus vulnérables ». Ces derniers risqueraient de se laisser convaincre de s’ôter la vie pour ne pas déranger, parce qu’ils se sentiront « en trop », ce qui risquerait d’aboutir à une « soumission librement consentie ». On nous parle des vieux qui seraient, implicitement, poussés au suicide. On nous parle moins des vieux qu’on ne soigne plus, surtout quand les hôpitaux ne peuvent déjà plus prendre en charge tous les patients.
L’offre créerait la demande ? Mais les mêmes qui utilisent cet argument, sont souvent ceux qui soulignent que, parfois, les demandes d’euthanasie formulées au début d’une maladie sont abandonnées par certains patients qui s’accrochent à la vie et préfèrent les soins palliatifs.
On dit aussi qu’une loi ferait dramatiquement augmenter le nombre de suicides. Si on regarde l’expérience des pays qui ont dépénalisé le suicide assisté et/ou l’euthanasie, on constate certes une augmentation, mais c’est le contraire qui aurait été étonnant, et les chiffres restent très limités, en général 2 à 3% des décès.
On accuse aussi les partisans d’une nouvelle législation de préparer des euthanasies pour des raisons économiques. Outre le fait que le nombre de suicides assistés dans les pays qui l’autorisent est marginal et que, donc, leur impact sur les équilibres financiers de la santé est très faible, il ne faut pas ignorer que la crise du secteur en France est la source de vraies dérives. « Vous savez, en réanimation, j’ai fait comme tous mes collègues, j’ai arrêté des respirateurs. Souvent sous la pression car il fallait libérer des lits. C’était illégal
»14, reconnaissait ainsi le professeur Jean Leonetti.
Enfin, avoir la possibilité de mettre fin à ses jours en étant accompagné, aidé, entouré des siens ne veut pas dire que tous passeront à l’acte.
Mais cela n’ôte rien à la sérénité qu’octroie la liberté de se suicider. Ceux qui savent, lorsqu’une maladie mortelle leur est diagnostiquée, qu’ils ont ce choix à leur portée, abordent leurs épreuves avec plus de force. Là aussi, les témoignages sont nombreux. « Je suis rassuré d’avoir la pilule dans le tiroir
», est une phrase que les médecins ont souvent entendue. En Belgique, où suicide assisté et euthanasie sont accessibles, 2,5% des gens demandent l’aide médicale à mourir, mais 80% des gens sont pour le maintien de la loi en l’état. Au Canada, pays accusé de « laxisme » par les adversaires d’une nouvelle loi, si les cas d’aide médicale à mourir représentaient seulement 2,5% des décès en 2020, 86% des Canadiens se disaient favorables au maintien de la législation actuelle.
Le débat est trop souvent entaché de mauvaise foi. Ainsi, nous a-t-on présenté dans de nombreux médias un universitaire hollandais, Théo Boer, comme une espèce de repenti qui, après avoir été favorable à l’euthanasie, aurait changé de position et s’y opposerait désormais.
Mais on nous dit rarement que Théo Boer est un théologien protestant, on ne précise pas que le comité dont il était membre était un comité régional et non pas national, et surtout on évite de citer ses propos plus nuancés. Car, interrogé sur son « opposition » actuelle à l’euthanasie il répond : « Je n’étais pas enthousiaste hier et je ne suis pas frontalement opposé à l’euthanasie aujourd’hui
».
Quelques rares chrétiens défendent l’euthanasie. Hans Kung écrivait ainsi en 2015 : « pour moi, refuser de prolonger indéfiniment ma vie temporelle fait partie de l’art de vivre et de ma foi dans une vie éternelle
»15. Il y a aussi cette médecin belge Corinne van Oost, auteur du livre « Médecin catholique, je pratique l’euthanasie
»16 : « En tant que médecin, je ne suis qu’un témoin,
écrit-elle. Seuls les malades peuvent juger des conditions dans lesquelles le temps qui leur reste à vivre n’est plus que souffrance. Donner une chance sans rien imposer est un équilibre subtil. C’est toute la tension que je vis en accompagnant les patients en demande d’euthanasie (…) Comment abandonner, au nom d’un Dieu aimant, quelqu’un qui vit une telle détresse ?
».
Déjà en 1925, peu avant de mettre fin à ses jours, l’écrivain libertaire Henri Roorda affirmait : « Je vais peut-être me rater. Si les lois étaient faites par des hommes charitables, on faciliterait le suicide de ceux qui veulent s’en aller
»17.
Les expériences à l’étranger
Comment croire qu’il y aurait une « voie française » différente de toutes les autres pour la gestion de la fin de vie quand de plus en plus – bientôt tous ? – de pays occidentaux développés autorisent, sous diverses conditions, le recours au suicide assisté et à l’euthanasie.
N’est-il pas étrange que cette évolution s’arrête aux frontières de l’hexagone ?
Il y a plus de vingt ans que les Pays-Bas ont modifié leur législation, presque autant que la Belgique a autorisé l’euthanasie. Beaucoup plus encore que la Suisse accepte le suicide assisté.
Le Canada, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, la Colombie, plusieurs Etats américains et australiens, ont des législations comparables. Les pays ayant adopté ces législations accordent en général une grande importance à la liberté individuelle.
L’Espagne a légalisé l’euthanasie début 2021, le Parlement portugais a fait de même (mais le Président de la République a opposé un veto), en Allemagne la Cour Constitutionnelle a souhaité une législation et le Conseil de l’ordre des médecins a voté en faveur de la suppression de l’interdiction de l’aide au suicide. Même dans la très catholique Italie, un premier cas de suicide assisté a été autorisé en juin 2022.
Conclusion(s)
Jusqu’à présent, le débat sur l’euthanasie et le suicide assisté a été escamoté dans notre pays. Chaque fois, on nous a dit qu’il était trop tôt, qu’il fallait laisser le temps aux lois déjà votées, qu’il ne fallait pas céder aux pressions « militantes », etc.
Cinq propositions de loi ont été enterrés depuis 2017.
Par deux fois, des conférences citoyennes, en 2013 et en 2018, se sont prononcées à une large majorité pour l’ouverture au suicide assisté. Par deux fois, ses voix ont été étouffées sous le concert conservateur des institutions officielles consultées (Ordre des médecins, Académie de médecine, etc.). Encore en 2021, sur la proposition du député Olivier Falorni, les députés ont voté à la majorité l’article 1 autorisant l’euthanasie, mais un quarteron de députés républicains a déposé tant d’amendements que les articles suivants n’ont pu être votés dans les temps, rendant caduc le texte qui, faute d’avoir été voté en totalité avant la fin de la législature, a fait long feu. Et le gouvernement de Jean Castex a estimé que la question n’était « pas opportune ».
Aucun gouvernement, aucun parlement n’avait eu le courage d’aborder une question pourtant approuvée par près de 90% de nos concitoyens. En ouvrant ce débat essentiel, Emmanuel Macron a respecté ses engagements.
Beaucoup de problèmes mériteront une réflexion approfondie. Quels garde-fous faut-il ériger ? Comment encadrer l’autorisation ? Contrôler a priori ou a posteriori ? Légaliser implique-t-il un « droit » à être assisté, notamment par les soignants ? L’assistance au suicide doit-elle être médicalisée, comme en Belgique, ou confiée à des associations, comme en Suisse ? Mais la présence d’un médecin ne sera-t-elle pas nécessaire pour garantir que tout se passera bien ?
Comme pour l’IVG, une clause de conscience est obligatoire pour les soignants (individuellement mais pas pour les institutions médicales). Donner la mort, même comme un acte compassionnel, peut être psychologiquement trop difficile à porter. On peut comprendre que des soignants veuillent se protéger d’une charge trop lourde pour eux.
Est-il plus sage, comme l’affirment certains, de maintenir certaines ambiguïtés, éviter de légiférer et s’en remettre à la jurisprudence ? Une telle attitude qui semble prudente et même raisonnable, n’est-elle pas plutôt une manière d’esquiver nos responsabilités, sinon de tenter, une dernière fois, de bloquer le libre choix de fin de vie ?
Légiférer c’est encadrer des pratiques qui ont lieu dans la clandestinité. Plutôt qu’une loi inapplicable, et inappliquée, une loi qui prend en compte les pratiques réelles des soignants et les volontés des patients, permettra de bien nommer les choses et d’encadrer rigoureusement des pratiques qui ne disaient pas leur nom. Encore une fois, c’est la loi qui libère et une fausse liberté qui opprime.
Dès lors, il faut laisser nos élus légiférer comme ils l’ont fait pour la loi Veil sur l’avortement. Cette loi n’a en aucune manière résolu complètement le problème éthique. Cette loi ne dit pas si l’avortement est bien ou mal. Mais elle permet d’indiquer où se situent les rives du légal par rapport à celles de l’illégal, au-delà des croyances ou convictions personnelles. La solution qui revient au législateur consiste à mettre en place une loi encadrée par des garde-fous stricts.
Les adversaires du suicide assisté ont conscience de mener un combat d’arrière-garde, mais ont-ils pour autant le droit de retarder, rendre le plus difficile possible ce que souhaitent la majorité de nos concitoyens ?
Vouloir préparer sa mort n’est pas condamnable, « c’est une courtoisie vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres
» dit justement le docteur Anne Fagot-Largeault pour qui la volonté de conserver un interdit absolu avec des « exceptions » gérées par des professionnels « crée deux poids, deux mesures entre ceux qui ont des relations, et qui peuvent bénéficier d’une amitié médicale, et les autres
».
On ne parviendra jamais à un consensus, mais chacun devrait être assuré de faire respecter ses choix, respecter la liberté de l’autre, sans nuire à autrui.
Cependant, rien n’est encore garanti et on a de bonnes raisons de s’inquiéter sur les conclusions qui seront tirées du débat actuel. Comme le souligne la juriste Martine Lombard « l’avis du CCNE reste étrangement muet sur la situation des personnes qui subissent des souffrances réfractaires du fait de maladies graves et incurables, mais sans que leur pronostic vital soit engagé « à moyen terme »
»18.
Emmanuel Macron, après avoir confié, non officiellement, qu’il penchait pour le modèle belge, semble faire machine arrière. Après avoir dit qu’il « soumettrait, sur la base des conclusions de la convention citoyenne, ou à la représentation nationale ou au peuple le choix d’aller au bout du chemin qui sera préconisé
», il a déjà écarté le recours au référendum et semble hésiter.
Le danger est qu’on fasse encore une fois semblant, avec une demi-mesure, comme par exemple avancer le moment où la sédation commencerait à être possible, passant de quelques jours à quelques semaines. Ou, en cas de légalisation du suicide assisté, en y mettant de telles conditions qu’il serait de facto interdit à la majorité des gens.
Or, la possibilité du suicide assisté, parce qu’elle contribue à la maîtrise de son destin, rend l’approche de la fin de vie moins angoissante. Elle ne cache pas la mort, elle la place même sur le devant, et permet de s’y préparer.
On ne choisit pas de naître, mais on peut décider en toute lucidité de choisir comment quitter le monde. C’est là sans doute notre ultime liberté.
Encore une fois, il n’est pas honnête d’opposer le suicide assisté aux soins palliatifs. Pire, les présenter comme incompatibles pourrait détourner des soins palliatifs une partie de ceux qui veulent rester maîtres de leur destin.
Si vous me garantissez que je pourrai être aidé à me suicider quand je ne pourrai ou ne voudrai plus continuer à vivre, je serai prêt à essayer les soins palliatifs. Je ne tiens pas à me suicider mais je veux partir sans trop de douleurs, avant de perdre ce que je considère ma dignité, avant d’être trop dépendant, en prenant le temps de dire adieu à ceux j’aime. A condition d’être exprimée librement et consciemment, la demande d’être aidé à mourir doit être entendue.