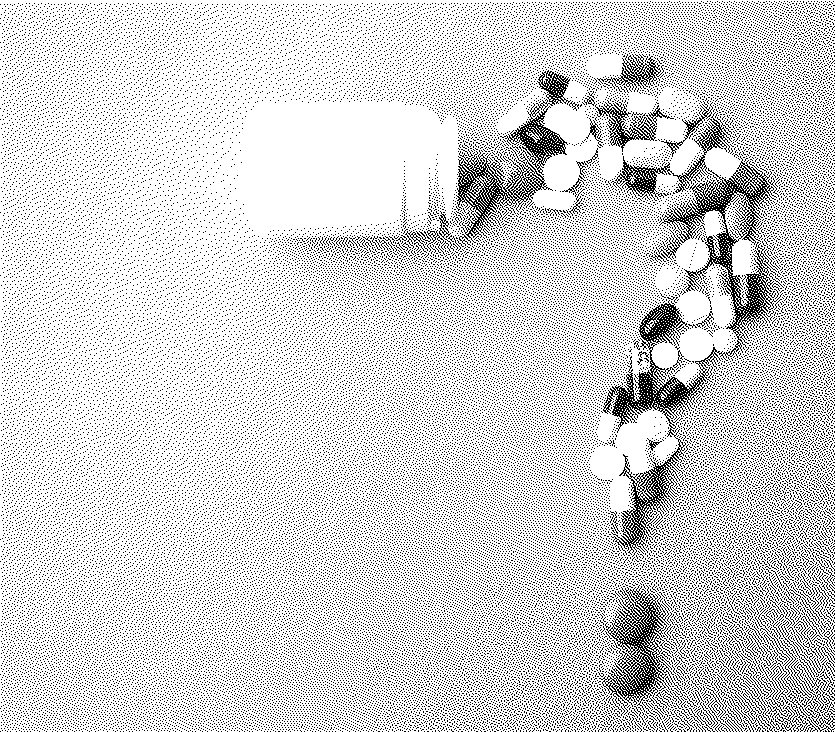Accédez au dossier complet : Fin de vie : quel cadre juridique ?
Sur la dépénalisation de l’aide médicale à mourir, la Grande Conversation a donné récemment la parole à deux voix qui émergent particulièrement par la résonance de leurs arguments, l’écho qu’elles trouvent dans le débat citoyen, et la constance de leurs propos. Claire Fourcade, présidente de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP), est médecin, et opposée à toute légalisation. Elle a répondu sur ce site à Martine Lombard qui est juriste, et qui y est favorable. Ces deux voix sortent du lot en cela qu’elles ne sont pas seulement militantes, mais qu’elles expriment l’une, un point de vue de praticien confrontée au quotidien à la fin de vie, l’autre celui de la juriste qui cherche un chemin de progrès par la loi. La lecture de leurs textes, comme leurs auditions en public, sont de prime abord également convaincantes. Pourtant, on reste parfois sur sa faim, pas tellement par ce qui est dit ou écrit, mais par ce qui manque. Difficile en effet de trouver un plaidoyer qui examine, d’un regard circulaire, tous les enjeux de la légalisation de l’aide médicale active à mourir et de la fin de vie. Quitte à conclure pour ou contre, mais au moins considérer les valeurs en tension, et expliquer pourquoi telles valeurs ou tels principes peuvent être sacrifiés au bénéfice de tels ou tels autres, supérieurs.
Le 10 janvier 2023, un article de Claire Fourcade répond dans les colonnes de La Grande Conversation1 à celui de Martine Lombard du 3 novembre 20222, et plus généralement à son livre L’ultime demande3. L’angle d’attaque et le leitmotiv sont basés sur la responsabilité collective de tout acte individuel, ses répercussions sur une société entière. Dimension qui est affrontée de manière mons centrale dans les textes de Martine Lombard, qui reprend même les mots de Anne Bert demandant en quoi son acte serait nuisible à autrui. Sans parler de l’oubli de la dimension du jeu de représentation(s) et d’interaction, bien repris par Eric Fourneret à propos du maintien de la face : « Ces demandes […] sont souvent un moyen de réinvestir le monde, de vérifier ou réactiver l’appartenance à une communauté, bref une façon de se relier à soi-même et aux autres.
»4 Chez Claire Fourcade à l’inverse, Sartre (« Notre responsabilité engage l’humanité entière. [Non seulement] l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais […] de tous les hommes…
»), déjà cité, aurait sa place dans un plaidoyer certes d’une grande sensibilité, et au ton souvent littéraire (« habiter ensemble le tragique*5 », « penser l’impensable et le tragique
* »). En plus d’être médical, l’abord y est essentiellement philosophique et sociologique. Hélas, il en oublie une forme de concrétude (oubli forcément volontaire, politique même, puisqu’il s’agit d’une des personnes en France les plus proches du quotidien de la fin de vie).
Point aveugle ? Ou aveuglement ?
Car un point est passé sous silence par la présidente de la SFAP, comme s’il était soluble dans le reste de l’énoncé : des personnes, physiques, existantes, nombrables, demandent une aide active à mourir, dans des conditions que la loi ne permet actuellement pas. Porteuses de maladies neurodégénératives motrices, elles perdent leur autonomie physique et bientôt respiratoire en toute conscience (Maladie de Charcot, 5000 cas par an ; mais aussi autres formes d’atteintes neurologiques évoluant par poussées) ; victimes d’accidents vasculaires cérébraux ou de traumatismes crâniens (ou de la moelle épinière), elles perdent tout ou partie de leur autonomie motrice et parfois cognitive ; touchées par des maladies neurodégénératives mixtes comme l’aphasie primaire progressive (perte de la parole) pouvant se compliquer d’apraxie (incapacité totale à coordonner ses mouvements), l’une et l’autre pouvant devenir totales, elles perdent autonomie motrice et capacité à exprimer toute volonté ; atteintes d’un cancer qui dégrade fortement la qualité de vie ou occasionne des douleurs rebelles à tout traitement, elles attendent une mort inéluctable, non lointaine mais pas assez proche non plus. La liste n’est pas exhaustive. La question, pudiquement passée sous silence, est donc : que répond-on à ces personnes-là ? Reste-t-on figé sur la capacité de la médecine à venir à bout de toute douleur (ce qui est faux) ? Sur son pouvoir de résoudre toute souffrance psychique et d’annuler toute demande de mort (ce qui est faut aussi) ? Leur dit-on qu’ils sont « forts », eux (« seuls des gens forts en sont capables*
»), ne font pas partie des plus vulnérables, et qu’à ce titre ils n’ont qu’à se débrouiller (voire, que c’est « un problème de nantis », comme l’a dit une spécialiste des soins palliatifs sur les ondes le 13 septembre dernier) ? Leur objecte-t-on que leur « réflexion [est] brouillée par l’impact émotionnel fort
* », reprenant le vieux cheval de bataille paternaliste chevauché par les médecins français depuis toujours ?
Questionner l’autonomie
Le point de l’autonomie n’est réellement questionné ni par les partisans, ni par les adversaires de l’aide active à mourir. Ou bien très évasivement. Martine Lombard oppose à une possible hétéronomie du malade, à son ambivalence en situation de vulnérabilité, un premier puis un autre entretien par deux médecins, parfois trois, parfois un psychiatre… Il faut pourtant avoir l’expérience de ces longues heures de discussions, d’allées et venues psychiques, avec des patients demandant tour à tour qu’on abrège leurs souffrances, qu’on reprenne une chimiothérapie, à nouveau qu’on arrête tout, pour savoir que ce long travail de recherche d’un reste-à-vivre et à-aimer donne lieu à bien des surprises. Certes, la posture du soignant et l’abord rhétorique utilisé (qu’il soit d’ailleurs en faveur de, ou opposé à, l’aide active à mourir) peuvent influencer de façon majeure la demande du patient : un médecin convaincu qu’il peut encore contrôler tel symptôme parviendra plus aisément à convaincre un patient qu’il pourrait, pour aujourd’hui au moins, taire ou différer sa demande, voire qu’elle est irrecevable. Mais il reste également vrai que les patients qui font toutes les démarches en vue d’une aide active à mourir font ainsi preuve d’une volonté persistante, solidement assumée, et que les entretiens finaux viennent surtout valider une démarche déjà très aboutie.
A l’inverse, Claire Fourcade, et avec elle une certaine partie du corps médical en France, n’examine pas davantage (mais dans le sens opposé) la question de l’autonomie potentielle de la personne malade : celle-ci est, de ce point de vue, toujours contestable pour peu qu’une bonne argumentation sache faire revenir la personne sur son choix, par définition non ou mal éclairé, de mourir. Ce n’est pas dit comme dans la sentence légendaire qui suit, mais peu s’en faut : « [le patient] ne voit plus clair en lui-même, car entre lui-même observant son mal et lui-même souffrant de son mal, s’est glissée une opacité et parfois même une obscurité totale ; tous ses pas dans sa connaissance de lui-même sont devenus trébuchants comme ceux d’un enfant.
», écrivait le président de l’Ordre des Médecins en 19506. Trente ans plus tard, le philosophe Vladimir Jankélévitch affirmait le devoir de mentir au mourant et au malade atteint d’une maladie grave, « le mensonge-par-amour [étant une] « sur-vérité » paradoxalement plus vraie que la vérité vraie.
»7 Ce n’est pas faute pourtant d’avoir proclamé (et inscrit dans la loi depuis vingt et un ans !8) l’autonomie de la personne malade : la relation médecin-malade, relation d’agence dans laquelle le second (le patient) délègue au premier (le sachant) le pouvoir de décision, reste bien dans nos consciences médicales profondément asymétrique. Il y a donc en effet une « redoutable complexité
* », mais celle-ci est immédiatement résolue dans un procès en incompétence et en hétéronomie vieux comme le monde. Claire Fourcade admet pourtant, dès l’entame de son article, que de notre souffrance, « personne d’autre ne peut juger
* » : comment résoudre cette apparente contradiction ?
La puissance médicale
« Les soins palliatifs sont une retenue de puissance
* », dit encore Claire Fourcade. Il est certain que le soin apporté à chaque personne malade fait appel à une humanité dont ses mots, dans un paragraphe intitulé Les soins palliatifs, un choix profondément politique, sont un vibrant reflet. Permettons-nous cependant de questionner, à rebours de l’idée dominante, le rôle presque ontologique de chaque médecin dans sa spécialité. La philosophe et médecin Marie-Jo Thiel fait observer que « ce que l’homme moderne craint plus que la maladie et la mort, c’est la panne technique, « que l’on ne puisse plus rien faire ». […] Désespérer d’un faire encore possible. […] Contrevenir au règne du faire biotechnologique.
»9 Or, n’est-il pas dans le domaine d’un faire encore possible, pour le chirurgien d’opérer, pour le cancérologue de prescrire une chimiothérapie, pour le réanimateur d’intuber, et… pour le praticien de soins palliatifs de présumer que sa science médicale lui permettra de soulager, « quoi qu’il en coûte
* » ? La signification de ce « quoi qu’il en coûte » mériterait d’ailleurs d’être précisée : un prix serait donc à payer, un sacrifice à consentir. Mais lequel, et pour qui ? C’est tout le paradoxe : les deux postures (pour la personne malade comme pour le médecin), maintenir la vie au prix d’une fin qui se prolonge, ou bien interrompre volontairement et l’agonie et la vie, ne sont-elles pas deux formes d’une même recherche de maîtrise ? Face à la mort, ou face à l’agonie.
La citation par Claire Fourcade de la phrase « puisque la médecine n’a pas su me guérir, c’est à elle de me faire mourir*
», entendue sur un plateau de télévision, pose d’ailleurs question sur le sens réel d’une telle revendication. Le sens n’est-il pas plutôt : « puisque la médecine et la technologie ont abouti à une hyper-médicalisation de l’existence, fait perdre le sens de la vie par la segmentation des prises en charge allant parfois jusqu’à un acharnement jugé indigne, qu’elle assume maintenant la responsabilité de ses excès » ? (Et non de ses échecs !) Sinon, il y a bien longtemps que l’euthanasie serait réclamée, la médecine ayant jusque récemment connu surtout une majorité d’échecs. Or c’est aujourd’hui, à l’ère de la toute-puissance revendiquée par une médecine forte de ses exploits, que la demande émerge ! Et de cela, la société tout entière, dans sa relégation de la mort au rang de point aveugle de l’existence, est tout autant responsable que la médecine elle-même.
Une pratique empreinte de religiosité ?
La critique est récurrente d’une imprégnation, sans doute même d’une connivence, entre soins palliatifs et religion. Entre Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs et religion catholique, pour être précis. Distinguons cependant le procès collectif, politique, en collusion entre SFAP et église catholique, voire lobbies tels que le site Génèthique, démontrée par Martine Lombard, et un étiquetage trop simpliste des soignants de soins palliatifs. Il serait ici bien tentant d’utiliser le pronom défini, LES médecins de soins palliatifs, avec un regard commodément totalisant et même essentialisant de tout une profession : la réduction du contradicteur en une entité un peu floue évite la reconnaissance de la singularité. Si les liens sont plus que probables, et les puissances d’influence notoirement alliées entre la société savante et l’Eglise, côtoyer tous les jours des soignants de soins palliatifs parfaitement laïcs, parfois même marqués politiquement dans un camp peu suspect d’obédience à une quelconque religion, me permet d’affirmer que cette réduction mentale est insatisfaisante. Certes, il y a bien des valeurs communes – et il faut l’espérer – entre la culture judéo-chrétienne qui imprègne notre pays depuis quelque vingt siècles, et la culture du soin à autrui, de la sollicitude et de l’attention à la vulnérabilité qui est censée animer les soignants. Oui, les infirmières ont longtemps été issues des ordres religieux, les hôpitaux ont d’abord été des hôtel-Dieu, etc. Allons plus loin : il existe dans les pays ou les régions où prédomine une tradition catholique un paternalisme qu’on retrouve moins là où prévaut le protestantisme, dans lesquels le principe d’autonomie est plus fort. Et il n’est sûrement pas hasardeux que la pratique de l’aide active à mourir se soit, au moins pour l’Europe, développée en priorité aux Pays-Bas, en Suisse ou en Belgique néerlandophone, plutôt qu’en Belgique wallonne ou en France. Mais l’écoute au cas par cas des médecins confrontés à ce débat ne résiste pas à la simplification, sauf à considérer qu’un « catho qui s’ignore » sommeillerait en chacun d’eux. Si on ne cherche qu’à expliquer, la connivence soins palliatifs / croyance religieuse est sans doute pratique, et le lien statistique probable. Si on cherche vraiment à comprendre, il est utile de sortir d’une essentialisation plutôt sommaire, tout comme la réduction à une notion de sacralité de la vie décrit assez mal, en les réduisant, les valeurs de bien des soignants.
L’état et la loi
La loi résout-elle tout ? Là encore, l’examen est, des deux côtés, partiel, parfois même partial. A lire Martine Lombard, la loi définira l’acceptable et l’inacceptable, fixera des procédures (un entretien, deux entretiens…), évitera les dérives. Ne suffit-il pas en effet de voir nos amis cyclistes évitant avec soin de poser le pied au croisement, ou le portable à l’oreille de l’automobiliste, pour se persuader de la toute-puissance de la loi et de l’incongruité de chercher à la contourner ? Mais les soignants sont sans doute des êtres de pure raison… Notons ici le paradoxe de la revendication d’une assistance collective (l’Etat) à un choix personnel, dont le philosophe Eric Fourneret pose ainsi les termes10 : « D’un côté, la liberté de choisir librement entre la vie et la mort est mise en avant, soulignant par là qu’un tel choix relève uniquement de la sphère privée ; mais de l’autre, on exige que l’Etat institutionnalise les moyens techniques et juridiques rendant possibles les différentes mises en œuvre de cette mort volontaire qui implique l’intervention d’un tiers, nous faisant ainsi basculer dans la sphère publique.
» Et pourtant, pourtant, plutôt que des fonctionnements tacites amenant à la transgression, il est plus que raisonnable de penser que la loi bornerait avec davantage de sécurité et de transparence les domaines du possible et de l’interdit.
Face à cette confiance élevée dans la loi, il y a inversement à la SFAP la certitude qu’elle n’a pas sa place (« La place de l’Etat [est-elle de] promettre d’éviter « toute souffrance » à chacun de ses citoyens ?
* »). Hans Jonas, dans Le droit de mourir, indique que « la liberté d’action qui échoit [au médecin] n’ouvre pas la porte à la « mort gracieuse » et ne [lui] paraît pas requérir une législation sur l’euthanasie, mais seulement un affinement d’une notion de « faute de l’art » dans la jurisprudence.
»11 C’est l’exception d’euthanasie, telle que proposée par l’avis 63 du CCNE en 2000, puis retoquée. Dit autrement en 2021 : « Exceptions individuelles, anecdote, et rumeur ne peuvent guider la politique publique ni la pratique médicale.
»12 Non que les demandes d’aide active à mourir soient une anecdote ; mais leur prise en compte par la légalisation conduirait à détruire les fondations et renverser une ligne directrice destinées à protéger le plus grand nombre et les plus vulnérables, au risque de soumettre ces derniers à un abandon massif. Tel est, en tout cas, l’argument contre toute tentation de légiférer. Il faudrait, reprenant les mots de Claire Fourcade, « laisser à chacun […] la responsabilité de traduire au singulier ce message collectif
* » Mais selon quelle marge de manœuvre, quel degré de liberté, puisqu’il est interdit d’envisager toute aide active à mourir ? Maintenir l’interdit et fermer les yeux sur la détresse de certains ne crée-t-il pas deux poids, deux mesures entre ceux qui ont des relations et peuvent bénéficier d’une amitié médicale, et les autres ? A l’appréciation singulière de chaque cas, biaisée par les représentations individuelles, ne doit-on pas substituer un cadre établi collectivement et garant d’équité démocratique dans l’accès aux différentes modalités d’accompagnement en fin de vie ? Mais il s’agirait, nous dit-on, de s’attaquer à l’exceptionnel (« les gens forts, capables de regarder la mort venir sans ciller, sont rares, très rares
* »), et on ne légifère pas, dit-on encore, pour l’exception. Or, les demandes d’aide active à mourir ne sont pas si exceptionnelles que cela (même en se basant sur la partie basse de la fourchette du nombre observé dans les pays qui ont légalisé, et en admettant donc une précaution maximale dans l’accès donné à cette possibilité, on aboutit à 1% des décès, soit 6000 cas annuels environ). D’autre part, est-il si sûr que la loi ne puisse pas être plus inclusive, plus précise ? « Les règles […] nécessitent, dans des cas particuliers, des adaptations, que les exceptions garantissent à cette règle qui serait, le cas échéant, devenue injuste
»13, écrit le juriste Mehmet Tinc. La prise en compte d’une éventuelle demande d’aide active à mourir ne remettrait pas en cause le principe général de droit à la vie, elle confirmerait au contraire la règle en évitant que celle-ci ne soit non seulement injuste, mais de moins en moins applicable.
La loi comme accélérateur, ou simple témoin d’une société qui a déjà muté ?
Deux valeurs centrales de notre vie en société seraient en opposition, selon la vision de Claire Fourcade : « Les uns invoquent la Liberté. […] Les autres font le choix de la Fraternité*
. » D’un côté, la légalisation de l’euthanasie serait une validation de la stricte liberté individuelle, au détriment de valeurs collectives sciemment sacrifiées ; de l’autre, il n’y aurait pas d’antagonisme entre les deux valeurs, l’accès à l’aide médicale active à mourir étant fondé sur l’exercice d’une liberté individuelle, qui reçoit en retour un acte de fraternité également individuelle (la dimension collective de l’acte est, nous l’avons vu plus haut, passée ici sous silence, ce qui relève, je le répète, d’un impensé philosophique et sociologique problématique). Ce sont donc bien deux visions du monde de géométrie opposée : éminemment collective et sociale d’un côté (quitte à ne pas entendre, en toute conscience, la demande de personnes considérées très rares), pragmatique, juridico-centrée et individuelle de l’autre (quitte à oublier, voire à nier, que chaque acte personnel engage beaucoup plus que soi-même).
C’est, du côté des opposants à l’aide active à mourir, plus profond que cela encore : c’est à l’évolution-même de la société depuis au moins un demi-siècle qu’il est fait procès. Une évolution, nous dit Claire Fourcade, « individualiste
* », « ultra-libérale
* », « fondée sur le culte de la performance et le rejet des vulnérabilités
* ». Ne manque que le qualificatif utilitariste pour que la messe soit dite. Et on peut en effet comprendre le regret d’une société que l’on estimerait autrefois fondée sur un contrat social beaucoup plus fort, une culture collective et d’entraide mieux distribuée, une société dans laquelle les personnes âgées finissaient leur vie auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants (et non isolées dans un petit appartement de banlieue, une maison loin de tout en province, ou un EHPAD où personne ne vient). A titre personnel, je partage cette désolation d’un monde perdu, probablement idéalisé en partie, comme toute personne qui voit les années s’accumuler et comprend moins bien le monde qui s’offre à elle aujourd’hui. Oui, l’individualisme, oui l’ultra-libéralisme, oui l’utilitarisme, oui le culte de la performance, de l’image, etc. Mais ce monde est déjà là !
« Ce n’est pas votre vie actuelle que vous ne voulez pas quitter. C’est votre vie d’autrefois. »
Nathalie à Rémy, Les invasions barbares (film de Denys Arcand, 2003)
Car la question n’est pas, à mon sens : une éventuelle légalisation de l’aide active à mourir va-t-elle précipiter le monde vers un individualisme et un égoïsme forcenés ? Mais plutôt : nos sociétés occidentales ne sont-elles pas déjà parvenues à cette juxtaposition de droits individuels, à un patchwork de particularismes et de communautarismes de moins en moins préoccupé de la communauté voisine, virtualisé et peu soucieux du contrat social ? Une légalisation de l’aide active à mourir ne serait-elle pas, dans ce cas, le témoin, et non l’accélérateur, moins encore le déclencheur, de cette évolution ultra-libérale ? (Notons au passage l’apparent paradoxe suivant : les partisans de la légalisation sont plus souvent progressistes, de gauche, et pourtant qualifiés ici d’ultra-libéraux ; mais ce sont bien eux qui veulent qu’on légifère et norme… Les opposants sont surtout marqués à droite, conservateurs, sans même parler de leurs sensibilités religieuses, et se défendent de cette dérive libérale ; ce sont eux pourtant qui veulent laisser l’abord de la demande d’aide active à mourir à l’appréciation singulière…) La question mérite en tout cas d’être posée en dépassant le réflexe épidermique et le raccourci mental : si l’ouverture de la loi s’accompagne, non pas tant d’une pente glissante juridique qui resterait, en principe, sous contrôle des hommes (ce que l’Histoire, française, dira…), mais d’une banalisation collective et inconsciente du recours à l’euthanasie14, solution comme une autre ramenée au même niveau que la recherche prudente d’un reste-à-vivre, alors oui la légalisation aura été un accélérateur. Sinon, non. Mais peut-on, comme le propose Claire Fourcade, présumer que la défense d’une liberté individuelle se réduit à une évolution « individualiste
* » et « ultra-libérale
* », en surfant commodément sur les correspondances étymologiques ?
Deux visions, donc, également estimables, très précisément argumentées, mêlant l’intelligence et le cœur. Mais des angles de vue opposés, car le quotidien de chacun diffère radicalement. Le médecin sait que l’assistance à la personne souffrante est d’une complexité irréductible dans un texte de loi, que face à la singularité et aux multiples visages que chaque individu peut présenter, parfois d’une heure à l’autre, seuls du cousu-main, des nuits blanches, de l’humilité face à l’incertitude peuvent être proposés. Le juriste mesure la nécessité d’encadrer toute pratique où l’arbitraire, disons la subjectivité, pourraient se glisser ; la puissance des textes doit venir à bout de tous les dilemmes, fussent-ils masqués par les mille visages de la relation de soin. Tout ceci serait très recevable, surtout complémentaire, si chacun examinait le point de vue de l’autre en humanité, et répondait sans ambages : Oui, je sais que plusieurs centaines de malades ne trouvent aucune réponse satisfaisante à leur souffrance chaque année en France, et j’accepte cette forme de sacrifice au nom de l’intérêt supérieur de personnes que j’estime plus vulnérables encore et plus nombreuses. La réponse inverse devrait être : Non je n’ignore pas que tout acte individuel engage l’humanité entière, que notre regard collectif sur la mort peut avoir des conséquences non encore mesurables sur des personnes en situation de fragilité, mais j’accepte cette forme de sacrifice car la réalité mesurable du moment, ce sont ces malades qui demandent en pleine conscience l’aide à mourir, et que le reste est hypothèse.
Chacun des deux, « éligible à la mauvaise conscience », a forcément idée du sacrifice redouté par l’autre. Simplement est-il sans doute douloureux de l’avouer.