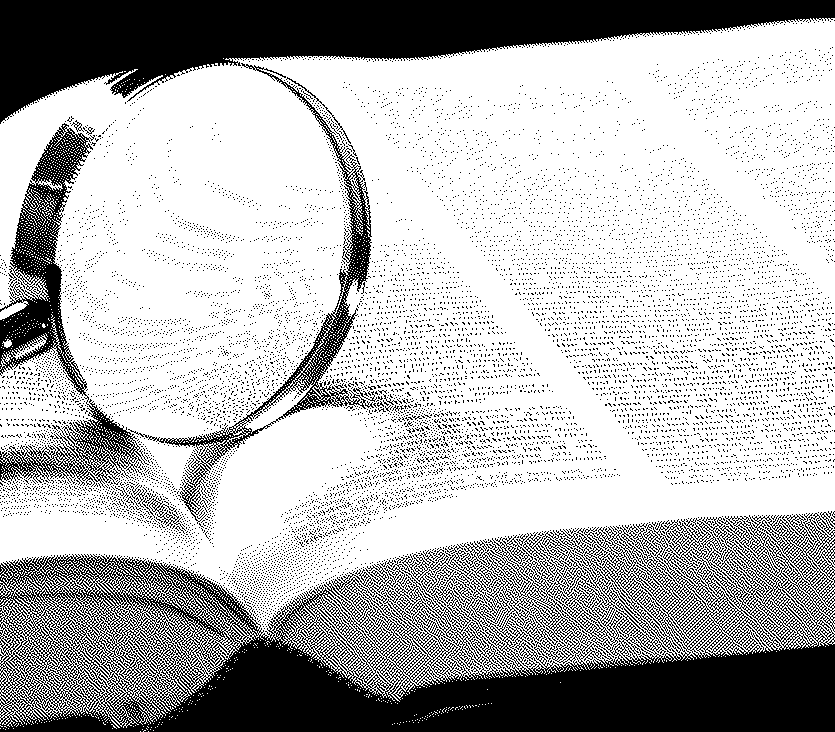Accédez au dossier complet : Fin de vie : quel cadre juridique ?
Légiférer sur la fin de vie implique une attention particulière au vocabulaire : la médicalisation contemporaine de la fin de vie mobilise un lexique technique et professionnel médical important. Symétriquement, la revendication d’une évolution des pratiques, avec la mise en débat public de l’aide active à mourir, se formule dans le vocabulaire des droits individuels (un « droit à mourir ») qui n’est cependant pas présent dans le droit positif. Engager, en parallèle de la convention citoyenne dont les travaux commencent en décembre 2022, un large débat public suppose que les termes en soient compris et partagés, au-delà des cercles des professionnels du soin et des juristes. Il faut alors se confronter à un double problème : d’une part, expliciter des termes parfois techniques ; et d’autre part, déplier les enjeux de valeur qu’ils recouvrent bien souvent. En effet, les termes de ce débat engagent, par leurs connotations, des présupposés, des biais, des sous-entendus nombreux mais pas toujours identifiés qui provoquent souvent blocages et malentendus. Les acteurs des plaidoyers en présence les connaissent, mais le public ne les maîtrise pas. Pour le public, le souci de pouvoir mourir sans (trop) souffrir obscurcit les différences conceptuelles importantes qui séparent la sédation profonde de l’euthanasie, l’accompagnement de l’aide active, ou encore le suicide assisté de l’euthanasie.
Le débat actuel oppose de fait deux options politiques pratiques (développer les soins palliatifs sans légiférer versus ouvrir dans la loi la possibilité d’une aide active à mourir) mais chaque argumentaire mobilise en réalité des valeurs, dont les contours ne sont souvent que peu explicités – soit qu’il s’agisse de concepts généraux entendus dans des sens divergents (dignité, solidarité, autonomie, liberté…), soit que les pratiques en débat elles-mêmes soient investies d’enjeux normatifs différents selon le plaidoyer qui les utilise (suicide, accompagnement, etc.).
Le propos de cet essai de lexique est de faire apparaître, pour quelques-uns des termes les plus visibles dans le débat, les tensions et controverses que recouvre leur usage dans les différents plaidoyers en présence.
Accompagnement :
Terme revendiqué à la fois par ceux qui défendent les soins palliatifs, où l’accompagnement peut désigner une forme de sollicitude et de présence quand il n’y a plus rien à faire d’un point de vue strictement médical, et par ceux qui souhaitent aller au-delà du droit actuel, en rendant possible une réponse active à la demande de mourir, en accompagnant la demande des personnes jusqu’au geste ultime de donner la mort. En pratique toutefois, le terme renvoie plutôt aux argumentaires hostiles à l’aide active à mourir, puisqu’il est le plus souvent associé aux soins palliatifs (ainsi la société savante des médecins de soins palliatifs s’appelle-t-elle la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP). En miroir, c’est le terme d’abandon qui polarise les oppositions : pour les tenants des soins palliatifs, dépénaliser l’aide active à mourir, c’est abandonnerles mourants à la solitude de leur découragement ; à l’inverse, les défenseurs de l’aide active à mourir font valoir que ne pas répondre à la demande d’aide de certains patients en fin de vie qui veulent être aidés, c’est les abandonner (voir : Devoir de non-abandon).
Aide active à mourir :
Recouvre à la fois l’assistance au suicide et l’euthanasie. L’expression évite le flou qui a longtemps prévalu sur le caractère direct ou indirect, actif ou passif, de la participation du médecin au décès du patient. Le terme d’« aide » indique qu’il ne peut s’agir que d’une réponse à une demande formulée par le patient. L’assistance au suicide consiste à donner à une personne qui en a fait la demande un produit létal qu’elle pourra s’administrer elle-même quand elle le voudra, l’intervention d’un tiers se limitant à la prescription et à la mise à disposition du produit. L’euthanasie suppose au contraire l’intervention délibérée d’un médecin ou d’une association dédiée, qui administre un produit conduisant au décès du patient. Dans tous les cas, cette aide active ne peut concerner, au terme d’un processus encadré par la loi et forcément collégial, qu’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable qui en fait la demande, de manière autonome, consciente et répétée, afin de faire cesser ou d’anticiper la survenue d’une situation qu’elle juge insupportable.
Autonomie de la personne :
La revendication d’un « droit à choisir sa mort » est développée au nom d’un principe fondamental en éthique médicale : l’autonomie individuelle, c’est-à-dire la reconnaissance de la capacité individuelle à faire des choix pour soi-même (autodétermination). Si ce principe permet clairement de contester des situations où des décisions sont imposées par exemple par le corps médical (paternalisme médical) sans l’avis du patient, il est parfois questionné dans certaines situations particulières : patients mineurs, patients atteints de pathologies psychiatriques, grand âge, déclin cognitif – où, par définition, le discernement du patient peut être jugé altéré au point que l’on interroge sa capacité à décider pour lui-même ce qu’il convient de faire. C’est pourquoi ont été mis en place par la loi de 2005 des outils permettant de recueillir à l’avance les souhaits de la personne (directives anticipées) ou de s’y substituer (personne de confiance), le tout complété par une décision collégiale côté médical. L’équilibre reste toujours complexe à établir entre une autonomie morale qu’il faut toujours respecter chez le patient, au risque de l’abandonner à sa solitude, et la nécessité de prendre des décisions pratiques dans son intérêt supérieur. Dans le débat sur l’aide active à mourir, le principe d’autonomie est mobilisé aussi bien par les opposants, qui font valoir les limites de l’autonomie des patients en fin de vie (au minimum l’hétéronomie due à la maladie) et soulignent l’importance des situations-limites (mineurs, malades atteints de pathologies psychiatriques), que par les défenseurs, qui considèrent que l’impuissance et l’illégalité dans laquelle se trouvent les patients qui demandent à être aidés à mourir constituent une entrave à leur autonomie.
Care / Cure :
Opposition entre une éthique de la sollicitude qui consiste dans l’attention consacrée à autrui et la démarche d’en prendre soin par l’écoute et la compréhension, d’un côté, et la visée de traiter un patient pour le guérir grâce à la puissance technique, de l’autre. Derrière cette opposition se jouent des références contrastées. Pour les tenants de l’aide active à mourir, les progrès de la médecine (cure) ont de fait créé des situations de fin de vie inédites il y a encore quelques décennies, et il est donc logique que les médecins intègrent désormais aussi la compétence d’y mettre un terme, comme une nouvelle composante du prendre-soin (care). A l’inverse, pour les opposants à cette aide active à mourir, qui réclament de s’en tenir à la logique du palliatif, la revendication même d’un « bien mourir » serait l’ultime avatar d’une logique presque consumériste du « cure », une demande abusive envers les médecins chargés là de techniciser la mort, alors que leur rôle serait plutôt de l’accompagner (care).
Consentement :
Afin de garantir le respect de l’autonomie des patients, la loi de 2002 sur les droits des patients a consacré l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé de tous les patients avant tout acte d’investigation ou de traitement. Dans les situations de fin de vie, faite de vulnérabilité, de dépendance, d’invalidité, de dépression, de déclin cognitif… voire de perte de conscience, le recueil du consentement est souvent impossible ou se heurte à des obstacles pratiques tels que la volonté de la personne reste incertaine ou discutable et sa prise en compte compromise. Les directives anticipées et le recueil de l’avis de la personne de confiance représentent des substituts utiles, quand elles existent, mais ne lèvent pas la contradiction de fond entre une situation de très grande vulnérabilité et la nécessité de la règle juridique présumant la capacité de chacun à décider librement ce qui est acceptable pour soi et à être acteur de sa santé.
Devoir de non-abandon :
Principe avancé par le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) dans son rapport de septembre 2022 pour préciser l’obligation de la société et du corps médical vis-à-vis des personnes en fin de vie. Mais ce principe ne change pas fondamentalement les positions en présence. D’un côté, il peut être compris comme une défense de l’action palliative qui vise la prise en charge de la douleur et l’accompagnement personnel. De l’autre, il peut être entendu comme une obligation de prendre en compte la requête des personnes qui demandent à choisir leur mort et de ne pas les abandonner dans leur dernière revendication de liberté personnelle.
Devoir de solidarité :
Désigne le sentiment d’obligation que nous éprouvons vis-à-vis de personnes en situation de vulnérabilité, malades, dépendantes, souffrantes… dans un système de soins qui défend l’égalité d’accès et l’égalité de traitement. Comme en attestent de fréquentes occurrences dans l’avis 139 du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE), ce principe affirme une priorité forte, mais le fait qu’il soit revendiqué aussi bien par les opposants de l’aide active à mourir que par ses défenseurs obscurcit le débat pratique sur la prise en charge de la fin de vie. Les premiers voient dans les soins palliatifs une traduction concrète du devoir de solidarité avec celles et ceux qui en ont besoin ; ils mettent au centre de leur plaidoyer ce concept de solidarité de la société envers les mourants, qui signifie pour eux les soutenir dans l’idée que toute vie est digne d’être vécue et accompagnée jusqu’à son terme naturel, alors qu’accélérer la mort reviendrait à abandonner les mourants à leur découragement solitaire. Inversement, les tenants de l’aide active à mourir considèrent qu’il y a rupture de solidarité lorsque l’on abandonne à leur solitude les patients qui demanderaient à être aidés à mourir, et que l’action solidaire doit aller jusqu’à répondre aux demandes d’interrompre une existence douloureuse et sans autre perspective de soulagement.
De façon frappante, l’avis 139 du CCNE prend pour problématique centrale de vouloir concilier la valeur de solidarité avec la valeur d’autonomie (et ce jusque dans son titre : « Les enjeux éthiques relatifs aux situations de fin de vie ; entre solidarité et autonomie »). Il tient pour acquis que, dans ce débat, ces deux valeurs s’opposent, et se donne pour ambition « l’impérative recherche d’un point de rencontre entre solidarité et autonomie ». En pratique, la rédaction tend à assimiler plutôt la valeur de solidarité à l’idée d’un accompagnement que la société devrait à ses mourants, dans le cadre des soins palliatifs et du « respect du droit à la vie », alors que la valeur d’autonomie, elle, paraît plutôt associée dans cet avis aux arguments favorables à l’aide active à mourir, autour d’une reconnaissance de « l’inexistence du devoir de vivre ».
Dignité :
Notre droit consacre la dignité des personnes comme un principe inaliénable. Pour autant, ce principe unanimement reconnu donne lieu à des interprétations divergentes. Pour les opposants à l’aide active à mourir, celle-ci serait une façon inacceptable de faire la distinction entre des vies qui ne mériteraient plus d’être vécues et les autres. Au contraire, les partisans de l’aide active à mourir font valoir que trop de Français connaissent des conditions de fin de vie et de mort indignes ; pour eux, la référence à la dignité signifie qu’il faut refuser des situations indignes de déchéance ou de souffrance, ainsi que les traitements indignes, et entendre la demande de patients reconnus comme seuls juges des conditions de leur propre dignité.
Droit à la vie / droit de mourir :
Le « droit à la vie » est inscrit dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). L’interdiction de l’homicide est également inscrite dans le droit et fait partie des fondamentaux de la déontologie médicale. Les partisans de l’euthanasie formulent, peut-être par esprit de symétrie, leur revendication en termes juridiques comme la reconnaissance d’un droit de mourir, appelé aussi « mort volontaire », « bonne mort »… Mais peut-il s’agir d’un « droit », même de nature nouvelle ? N’est-il pas contradictoire de revendiquer comme un droit subjectif une demande qui appelle une réponse (précisément entourée de garanties) du monde médical et, au-delà, la société toute entière ? Pourrait-on le considérer comme un droit opposable, c’est-à-dire entrainant une obligation de le satisfaire pour les pouvoirs publics, ou pour la société de manière générale ? Ne faut-il pas plutôt défendre une liberté personnelle, c’est-à-dire la liberté de disposer de soi-même ? Dans cette ligne argumentative, la vie est vue comme un droit à protéger mais il n’y a pas un devoir de subir une existence quelle qu’en soit la souffrance. Le Tribunal constitutionnel allemand a par exemple considéré en 2020 que le droit à l’autodétermination de toute personne inclut la liberté de mettre fin à ses jours.
Légalisation / Dépénalisation :
La légalisation consiste à reconnaître comme légal un acte, un usage ou une pratique, c’est-à-dire à supprimer l’interdit qui pesait jusqu’alors sur elle ou sur lui. La dépénalisation consiste à supprimer les sanctions encourues jusqu’ici par celles et ceux qui décidaient d’enfreindre cet interdit. La dépénalisation revient à créer une tolérance. La Suisse, par exemple, a dépénalisé l’assistance au suicide (pourvu que l’aide soit apportée de manière désintéressée) mais interdit toujours l’euthanasie dans son code pénal. En revanche, les Pays-Bas et la Belgique ont dépénalisé l’euthanasie (respectivement en 2001 et 2002).
Libre disposition de soi :
Cette liberté fondamentale est déduite de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui consacre un droit au respect de la vie privée, lequel ne peut pas être limité par l’ingérence de l’autorité publique en dehors de motifs précisément énumérés. Elle ne signifie cependant pas la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend puisque la loi précise les conditions de l’exercice de la liberté individuelle, dans la vie sociale bien sûr mais aussi dans le cadre de la vie privée (avec les principes de dignité, d’indisponibilité et d’inviolabilité).
Obstination déraisonnable :
Depuis la loi de 2005, l’obstination déraisonnable (longtemps appelée « acharnement thérapeutique ») est interdite par l’obligation de ne pas empêcher la mort lorsque les traitements apparaissent « inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Le caractère « disproportionné » est apprécié par rapport au bénéfice escompté pour le patient, en fonction des données acquises de la science et de l’expérience des équipes au cours d’une évaluation collégiale. On parle de « désescalade thérapeutique » quand on limite ou qu’on réduit les thérapeutiques actives afin de ne pas créer des situations médicales de survie au détriment de la qualité de vie des patients.
Sédation :
L’utilisation d’un sédatif est une pratique courante guidée par des recommandations professionnelles pour le soulagement d’un symptôme (douleur, anxiété, insomnie…). On parle de sédation symptomatique proportionnée, qui elle peut être légère ou profonde (jusqu’au coma, sans perspective de réveil) selon l’intensité du symptôme à soulager. La « sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès », elle, est un droit introduit par la loi du 2 février 2016, sous conditions. Une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, peut être endormie profondément pour soulager ou prévenir une souffrance réfractaire (souffrance perçue comme insupportable, que les soins ou les produits administrés ne parviennent pas à soulager au point que le seul moyen d’y remédier est de faire perdre conscience au malade). La décision, qui dépend d’une procédure collégiale encadrée, peut être mise en œuvre sur proposition médicale ou sur demande du patient.
Autour de la sédation profonde et continue jusqu’au décès se concentre un débat important, qui concerne le terme probable auquel le décès du patient est prévisible. Les recommandations professionnelles (Haute autorité de santé, SFAP) définissent le « court terme », condition pour qu’un patient soit éligible à une sédation profonde et continue, comme allant de « quelques heures à quelques jours ». Le plaidoyer en faveur de l’aide active à mourir a pour argument central que ce délai resserré exclut de fait des patients qui, sachant leur pronostic vital engagé dans un délai de « moyen terme » au prix de vives souffrances et atteintes à leur dignité, demandent à être aidés à mourir sans attendre de remplir ce critère restrictif d’éligibilité. Si l’on suit les législations étrangères (surtout aux Etats-Unis et en Australie) en matière d’aide active à mourir, ce « moyen terme » recouvre un délai de quelques semaines à quelques mois. Les législations étrangères les plus récentes (Pays-Bas, Belgique, Espagne, Canada) ont cependant évité toute mention de phase finale (décès à court ou moyen terme, quelle qu’en soit la définition) et simplement pris en compte la volonté du patient de mettre un terme à des souffrances irrémédiables.
Soins palliatifs :
Soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale, visant à soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi à prendre en compte la souffrance psychologique, sociale ou spirituelle du patient et de ses proches. Ces soins sont délivrés le plus souvent dans des centres spécifiquement dédiés, les unités de soins palliatifs, ainsi que dans les services non spécifiques de l’hôpital, avec au mieux le fléchage « lit identifié de soins palliatifs » (LISP) mais également par des équipes mobiles qui interviennent à domicile. Depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, cinq plans de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de la vie ont été définis et engagés. Après le Conseil d’Etat et le Conseil économique, social et environnemental en 2018, puis l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) en 2019, le CCNE déplore dans son dernier avis la modestie des moyens engagés dans ces plans et la persistance des inégalités d’accès aux soins palliatifs. Le constat partagé est que les situations territoriales demeurent inéquitables et hétérogènes, et que la mise en œuvre de la décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives, de même que la prescription d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, sont trop souvent inaccessibles. Malgré des déclarations d’intention, le déploiement d’une filière universitaire spécifique de soins palliatifs ou le développement d’une culture palliative chez l’ensemble des personnels de santé restent limités.
L’avis 139 du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) permet de saisir la variété des positions qui sont prises aujourd’hui à ce sujet. Pour les uns (la SFAP, la position minoritaire annexée à l’avis), l’urgence est d’augmenter les moyens dédiés aux soins palliatifs pour en élargir l’accès. Pour les autres, l’accès des patients qui le souhaitent aux soins palliatifs est certes essentiel et doit être massivement élargi, mais mieux répondre à leur demande d’accompagnement jusqu’au décès ne permettrait simplement toujours pas de répondre à la demande de ceux qui, eux, demandent à être aidés à mourir. L’avis du CCNE, lui, tente de dessiner une ligne médiane, d’abord en pointant que la question des soins palliatifs aujourd’hui n’est pas seulement une question de quantité d’offre, mais aussi une question de qualité de la culture médicale, qui passe par une refonte des formations à l’éthique, à l’interdisciplinarité, et aux enjeux de la fin de vie ; ensuite, en affirmant explicitement que, d’une part, « il ne serait pas éthique d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte » – mais que symétriquement d’autre part, il « ne comprendrait ni l’absence d’engagement des acteurs politiques en faveur de mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs, ni la limitation du débat à celles-ci ».