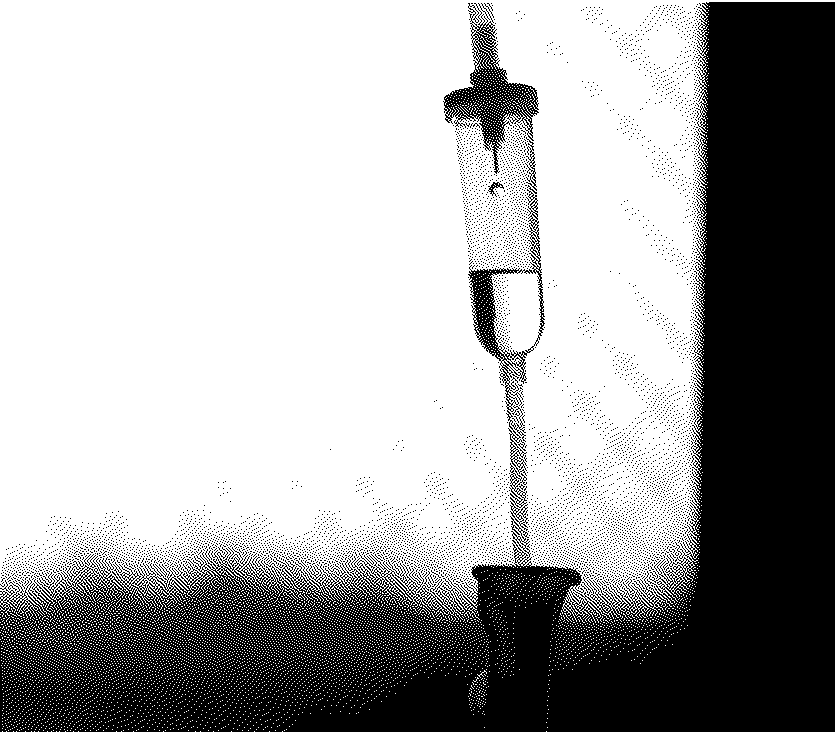Accédez au dossier complet : Fin de vie : quel cadre juridique ?
« La question n’est pas de nier le caractère tragique de la mort, de prétendre résorber celle-ci dans l’ordre des choses. Elle est de savoir comment nous habitons ensemble cette tragédie. »
O. Rey, L’idolâtrie de la vie
Une convention citoyenne sur la fin de vie vient de s’ouvrir. Et si c’était l’occasion unique d’une réflexion collective puisque nous sommes tous concernés par cette question de la vie jusqu’à sa fin, par la mort, la nôtre ou celle de nos proches, et par les conditions dans lesquelles elle surviendra ?
Comment souhaitons-nous habiter ensemble le tragique de la mort et quelle est la place de l’État dans celle-ci ? Doit-il promettre d’éviter « toute souffrance » à chacun de ses citoyens et de trouver une solution à chaque situation individuelle, bien souvent d’une redoutable complexité et dont l’impact émotionnel fort brouille la réflexion ? Le peut-il ? A quel prix ?
Ou bien, pour parvenir ensemble à penser l’impensable et le tragique, doit-il fixer le « cadre de l’accompagnement » des personnes les plus vulnérables en laissant ensuite à chacun, patient, proche, soignant ou citoyen la responsabilité de traduire au singulier ce message collectif ?
1. La loi comme réponse collective à la souffrance
La souffrance est une expérience à la fois physique, psychologique, sociale, existentielle et spirituelle. Elle demeure extrêmement subjective et singulière, tissée et construite par notre histoire, notre éducation, nos rencontres, l’instant dans lequel elle survient et notre manière d’être au monde. Elle n’est ni mesurable, ni objectivable, et personne d’autre ne peut en juger. Tout au plus pouvons-nous collectivement chercher les moyens de la soulager.
Dans les dernières décennies, notre société a délégué cette mission à la médecine conduisant à une médicalisation et une technicisation toujours plus grandes de la fin de vie et de la mort. Et parce que la médecine n’a pas pu tenir la promesse impossible d’une fin de vie sans peine et que chaque vie comporte sa part de souffrance, il peut maintenant lui être demandé de donner la mort. « Puisque la médecine n’a pas su me guérir, c’est à elle de me faire mourir
» a-t-on pu entendre récemment sur un plateau de télévision.
Si nous devions changer la loi dans ce sens, il serait vain d’essayer de mettre des limites. En effet, il se trouvera toujours une souffrance singulière vécue comme insupportable et que le cadre choisi aura exclue. C’est « la liberté à déterminer soi-même son degré de tolérance à la souffrance et les contours de son destin personnel
» dont parle le CCNE dans son avis 139. La promesse d’éviter toute souffrance est un mirage et une course à l’abîme. Le philosophe Théo Boer, longtemps membre de l’instance de contrôle des euthanasies néerlandaises, pose la question : « Si (en Hollande) le système le plus encadré et le mieux contrôlé au monde ne peut garantir que l’aide à mourir reste un dernier recours, pourquoi la France y arriverait-elle mieux ?
»
Essayons de ne jamais oublier que chacune de nos décisions vient dire à tous l’attention que notre société porte aux plus vulnérables. Nous ne sommes pas seulement une somme d’individus dont les décisions ne concerneraient qu’eux-mêmes, ou leur cercle proche. Nous vivons en société, nous faisons société. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants. Nous sommes tous impliqués. Les soins palliatifs illustrent parfaitement la dimension relationnelle de l’autonomie et la dimension de créativité et de liberté du soin pour « appeler à l’existence quelque chose qui n’existait pas auparavant
» (Hannah Arendt). Ils sont la recherche patiente de ce qui est encore possible et désirable. « La maladie est une autre allure de la vie
» disait Canguilhem… mais c’est toujours la vie.
2. Les soins palliatifs, un choix profondément politique
Les soins palliatifs sont un éloge de l’altérité : nous nous tenons aux côtés d’un Autre mais que savons-nous de l’Autre ? Ensemble nous recherchons le mieux avec cet Autre. Mais que savons-nous du bien ? Ou du mal ? Dans le doute et l’incertitude, nous tentons d’aplanir le chemin, d’être là, présents. Mais que savons-nous de la vie ? Et de la mort ? Derrière chaque porte à laquelle je frappe, c’est une nouvelle rencontre et toujours l’Inconnu. Plus je vieillis et moins je sais.
Dans une société qui valorise le contrôle, le pouvoir et la force, les soins palliatifs sont un éloge et un aveu de faiblesse et ils en sont fiers. Un service de soins palliatifs est un lieu d’observation privilégié des fragilités humaines. Nos patients sont fragiles et vulnérables comme le sont leurs proches dans ces moments de détresse. Ils évoquent la mort, la souhaitent parfois puis parlent d’autre chose, de projets et d’espoir. Ils sont ambivalents, comme nous le sommes tous souvent. Se tenir droit face à la mort jusqu’au bout, la regarder venir et même la demander est difficile et rare. Seuls des gens forts en sont capables.
Les soins palliatifs sont aussi un éloge du regard. Le regard que nous portons les uns sur les autres. Ce regard qui peut mépriser, dévaloriser ou ignorer mais qui peut aussi soigner, respecter ou humaniser.
Les soins palliatifs sont une retenue de la puissance. Travailler en soins palliatifs, c’est reconnaître que l’homme est mortel. Et savoir, donc, que la médecine n’est pas toute-puissante. Travailler en soins palliatifs, c’est souhaiter cette retenue de la puissance. C’est avoir vu le précipice de la responsabilité médicale et savoir que le vide est sous nos pieds. C’est avoir fait l’expérience du vertige du pouvoir médical et se donner les moyens de ne pas en abuser. Même en soins palliatifs, les outils de la puissance sont là. Calmer la douleur. Ou pas. Décider du niveau de conscience. Faire taire ou laisser crier. Il faut alors prendre son temps, écouter, car, comme l’écrit la philosophe Sylviane Agacinski, « là où la puissance s’exerce sans retenue, il n’y pas d’éthique possible
».
Les soins palliatifs sont une incarnation de l’alliance thérapeutique où patients et soignants s’éclairent mutuellement pour trouver la voie du meilleur possible. Les soins palliatifs sont un nouveau modèle du soin, une nouvelle façon d’envisager, de regarder, de valoriser l’être humain.
Les soins palliatifs sont un choix de société : non pas une société ultra-libérale de l’individu autonome, indépendant de tous, maîtrisant sa vie et sa mort mais une société de la solidarité et de l’interdépendance prête à secourir la fragilité, une société du « care ». Nous sommes en « care ».
3. Société individualiste ou société de la Fraternité ?
La mort est le terme de toute vie. Quels choix collectifs faisons-nous pour affronter cette réalité souvent douloureuse ? Quels moyens nous donnons-nous pour que cette mort advienne dignement ? Quelle place faisons-nous à celui qui meurt ? Face à l’imminence de la mort, chacun est confronté à des questions existentielles. Pourquoi la maladie ? Pourquoi la finitude ? Pourquoi la mort ? Pourquoi cette impuissance face à une issue inéluctable ? Aucune loi ne peut ni ne doit répondre à ces questions.
La loi peut en revanche garantir à chacun les meilleures conditions pour traverser cette épreuve constitutive de notre commune humanité. Depuis plus de 20 ans, c’est ce que législateur français s’est efforcé de faire, souvent avec difficulté, parfois avec crainte mais toujours dans le respect de l’équilibre. Trois grandes lois – Kouchner en 1999, Leonetti en 2005, Claeys-Leonetti en 2016 – ont dessiné un chemin singulier et respectueux, fondé sur la liberté du patient et le refus de l’acharnement, l’égalité des conditions d’accès aux soins palliatifs et la fraternité entre le mourant, ceux qui prennent soin de lui et son entourage qui l’accompagne.
Dans le débat récurrent sur la fin de vie, deux conceptions de la société s’affrontent, parfois durement.
Les uns invoquent la Liberté : « Je décide ce qui est bon pour moi et cela ne regarde personne d’autre.
» Dans une société ultra-libérale et individualiste, c’est un choix qui a sa logique. Une logique fondée sur le culte de la performance et le rejet des vulnérabilités. C’est une société de gens forts, capables de regarder la mort venir sans ciller. Ils sont rares, très rares.
Les autres font le choix de la Fraternité. C’est le cas de la France. « Vous n’êtes pas seul. Quoi qu’il arrive et quoi qu’il en coûte, nous serons avec vous et nous ferons ce qu’il faut pour vous soulager car demander la mort parce qu’on souffre n’est pas un choix libre.
» C’est le choix d’une société solidaire et fraternelle qui a le souci des plus fragiles qui sont les plus nombreux.
Ouvrir l’option de l’euthanasie, c’est obliger chaque patient, non pas à la choisir, mais à l’envisager, à se dire qu’il devrait y penser, que ce serait peut-être mieux pour lui ou pour ses proches. Or les personnes gravement malades sont pour la plupart fragilisées par la maladie dans ces moments de détresse. Une loi autorisant l’euthanasie est une loi pour les forts, qui ne protège pas les faibles.
La loi envoie à tous un message collectif. Soit : vous êtes libres et nous consentons à organiser votre mort en demandant aux soignants d’en être responsables. Soit : vous comptez pour nous tous et nous mettrons tout en œuvre pour vous.
L’État et la loi que nous choisirons de nous donner pourraient nous envoyer un message d’espoir dont nous, soignants, serions les porteurs : nous mettrons tout en œuvre pour vous soulager, nous n’abandonnerons pas, nous ne vous abandonnerons pas. Nous comptons les uns pour les autres et les uns sur les autres. Nous prendrons un soin tout particulier des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Ensemble.
Et peut-être alors déciderons-nous collectivement que, comme société, nous ne pouvons consentir à demander aux soignants de donner la mort à l’un d’entre nous, même à sa demande parce que « nul n’est une île » et que nous tenons à chacun de nous tous.
Quand la vie est trop dure portons là à plusieurs.
Grand Corps Malade