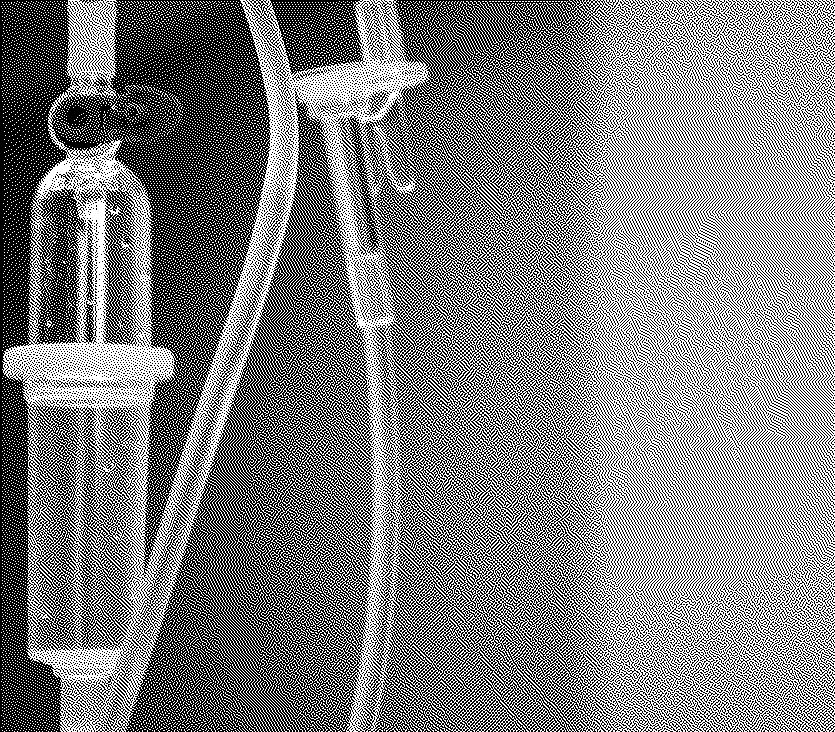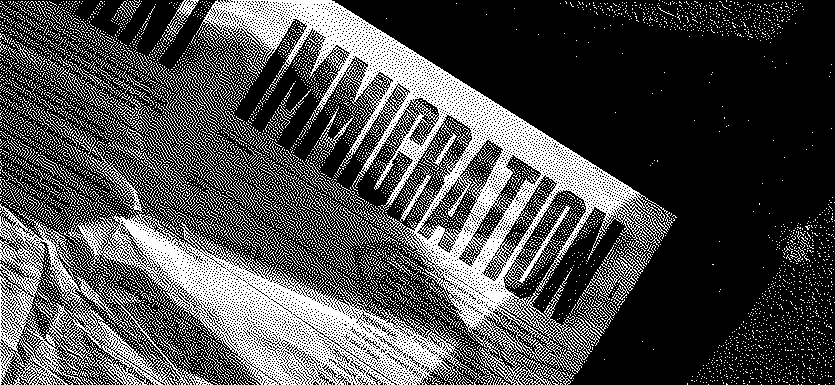La proposition de loi 1100 en vote solennel le 27 mai propose un incontestable progrès dans l’accès à l’aide à mourir de personnes porteuses d’affections graves et incurables, aux souffrances réfractaires. Nous comprenons son caractère mesuré, ses compromis destinés à créer une avancée tout en établissant des garanties et le respect des sensibilités. Pourtant, pour nous qui parlons au nom de certains soignants, patients et associations, des réserves demeurent. Nous ne voulions pas, personne ne voulait de « liste » de patients ou de pathologies éligibles à l’aide à mourir ; or, nous en avons une, celle des exclus.
Dans sa version actuelle, la proposition de loi oubliera non seulement ceux que le périmètre initial du texte ne concernait pas, mais s’y ajouteront en outre toutes les personnes malades que les amendements des quinze derniers jours se sont employés à exclure du champ de la loi. Ceci n’est pas la revendication d’un « toujours plus », mais un constat.
Les perdants de la première discussion parlementaire
Les patients porteurs de souffrances psychiques sans souffrance physique associée, qui bien qu’atteints de pathologies graves et incurables (notons que les pathologies psychiatriques potentiellement curables ont par définition été exclues d’emblée de la proposition) se verraient-ils refuser l’aide à mourir au motif d’une souffrance considérée, au stade de leur demande, comme « seulement » psychique ou existentielle ? [Amendement 1453] Comment articuler cet amendement avec la phrase précédente (point 4, article 4) qui fait était de souffrance physique ou psychique liée à cette maladie [grave et incurable] ?
Ce « ou » permettra-t-il d’apporter une réponse favorable aux personnes atteintes de maladie neuro-évolutive (maladie neurodégénérative de type Parkinson ou apparentée, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, tumeur cérébrale maligne), de tétraplégie suite à un traumatisme médullaire, de séquelle grave d’accident vasculaire cérébral ? A la lecture de la première phrase de ce point 4, on serait tenté de le penser. Mais à lire les amendements 1453 et 1455 (introduisant la notion de « constance » de la souffrance) et la réponse sur les ondes d’un des auteurs des deux amendements, qui confirme qu’une malade comme Anne Bert (atteinte de la maladie de Charcot) serait bien exclue, la question reste présente.
Les patients demandant une assistance par un tiers, en l’occurrence un médecin, et n’ayant plus droit qu’à une auto-administration (au motif d’être un meilleur garant de leur libre-arbitre) avec pour seule assistance la mise à disposition d’une substance létale [Amendement 2650] (et, certes, la présence à vue d’un médecin). L’essence même de la relation de soin consiste à laisser un médecin répondre à une demande d’accompagnement de la personne malade, de la façon qui la sécurise le plus. Rappelons que dans les pays où les deux modalités d’aide à mourir sont légalisées, les patients choisissent massivement l’assistance par un soignant.
Les personnes considérées « éligibles » mais qui, par crainte de voir leur demande devenir caduque à 3 mois [Amendement 2652] (et donc de tout devoir refaire), pourront préférer précipiter leur geste là où elles l’auraient volontiers différé encore un peu, voire suspendu.
Les soignants qui, dans des situations « d’exception d’euthanasie », qui ne manqueront pas de se produire (au motif de l’incapacité du patient à effectuer l’acte), devront in extremis et dans la plus grande solitude « juger » si, cette fois, une euthanasie ne serait pas finalement licite. [Amendement 2650] Sur quel critère ? En plus d’une mise en doute de la parole du patient, où est le respect du soignant confronté sans préparation à une telle demande, à l’opposé d’un accompagnement dans la continuité du choix de la personne ?
Les soignants qui demandaient une formation approfondie sur l’accompagnement de fin de vie (indispensable pour tous les soignants, y compris ceux qui feront valoir leur clause de conscience, et pour toutes les modalités). [Rejet de l’amendement 640 à la proposition de loi de Mme Vidal]
Les non pris en compte du début
Les patients de moins de 18 ans en fin de vie, aux souffrances réfractaires et porteurs de maladies graves et incurables (ce qui, rappelons-le, exclut les pathologies psychiatriques). Devront-ils, eux, attendre l’imminence de l’agonie et un éventuel accès à la sédation profonde et continue ?
Les personnes avec atteintes cognitives évolutives du type démence progressive, ou de comas irréversibles, et ayant rédigé des directives anticipées (mais considérées sans « discernement » au moment du geste.) Ce cadre inclut les patients pour lesquels la demande aura été validée au préalable, mais qui ne pourraient pas consentir au moment final (par exemple du fait d’une sédation pour douleur réfractaire.)
Les personnes atteintes d’une maladie non fatale, ou fatale au-delà du moyen terme. Ce vocable a finalement été abandonné au profit de « phase avancée », recentrée par les travaux de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur la notion fondamentale d’atteinte à la qualité de vie (avec le risque que l’appréciation restera à la libre interprétation du praticien, donc surtout à ses convictions). Ceci inclut les personnes, si et seulement si elles en font la demande du fait de souffrances devenues insupportables, atteintes de poly-pathologies ou de handicap.
Les proches aidants, pour lesquels aucune mesure d’envergure (aides, congés…) n’est envisagée, et dont la seule présence d’un professionnel « en vision directe » mais implique, de fait, partiellement ne permettrait pas un accompagnement solidaire.
Et plus généralement : Vingt-cinq ans de démocratie en santé et de reconnaissance de la valeur fondamentale de la parole du patient.
Resteront « éligibles » : à peu de choses près, les mêmes que ceux de la loi Claeys-Leonetti, idem pour les exclus. Par prudence et pragmatisme politique, sous l’effet peut-être de certaines pressions, cette Proposition de compromis ne serait pas, à ce stade, la grande loi d’humanité collective attendue : un pas crucial serait effectué, mais un certain nombre de patients, et avec eux leurs soignants, n’y trouveraient pas la réponse à leurs attentes. De sorte que le bornage croissant, par les amendements, des conditions de l’aide à mourir ferait le lit des « dérives » pourtant tant dénoncées, d’autant plus rapides et nombreuses à survenir que la loi aura été restrictive au départ (et non « la plus permissive »). Faudra-t-il laisser aux décrets, aux recommandations, à l’interprétation médicale la latitude, et l’aléa, de préciser ce que la Loi n’aura pas voulu ou su faire ? Enfin, si un référendum venait à suivre un (probable ?) blocage final, un peu de moelle ne devrait-elle pas au moins rester à l’os tendu alors aux citoyens ?